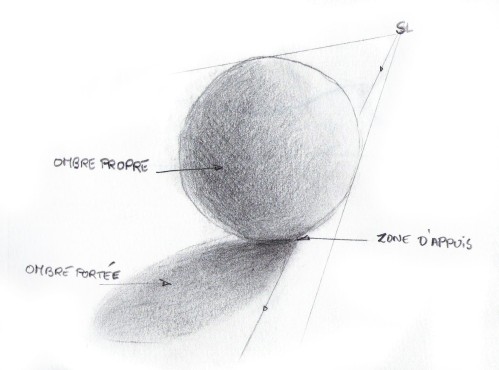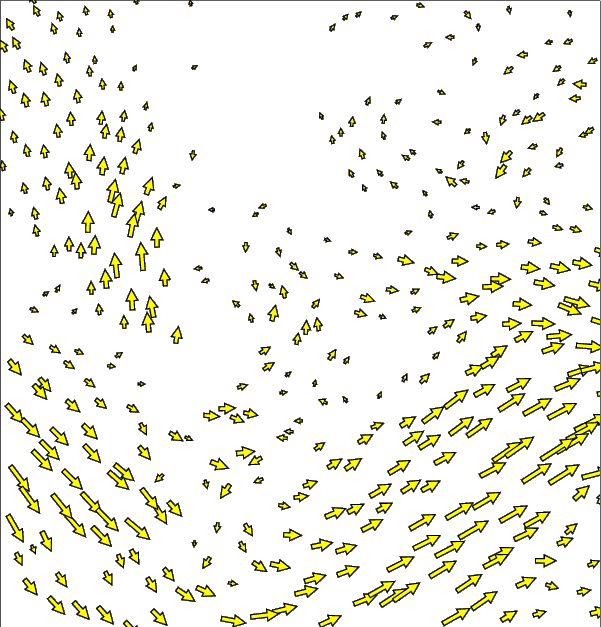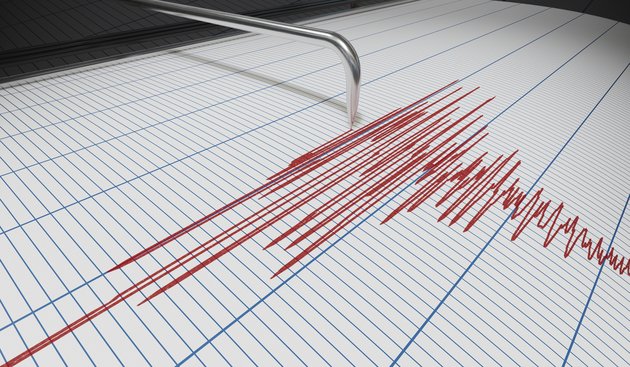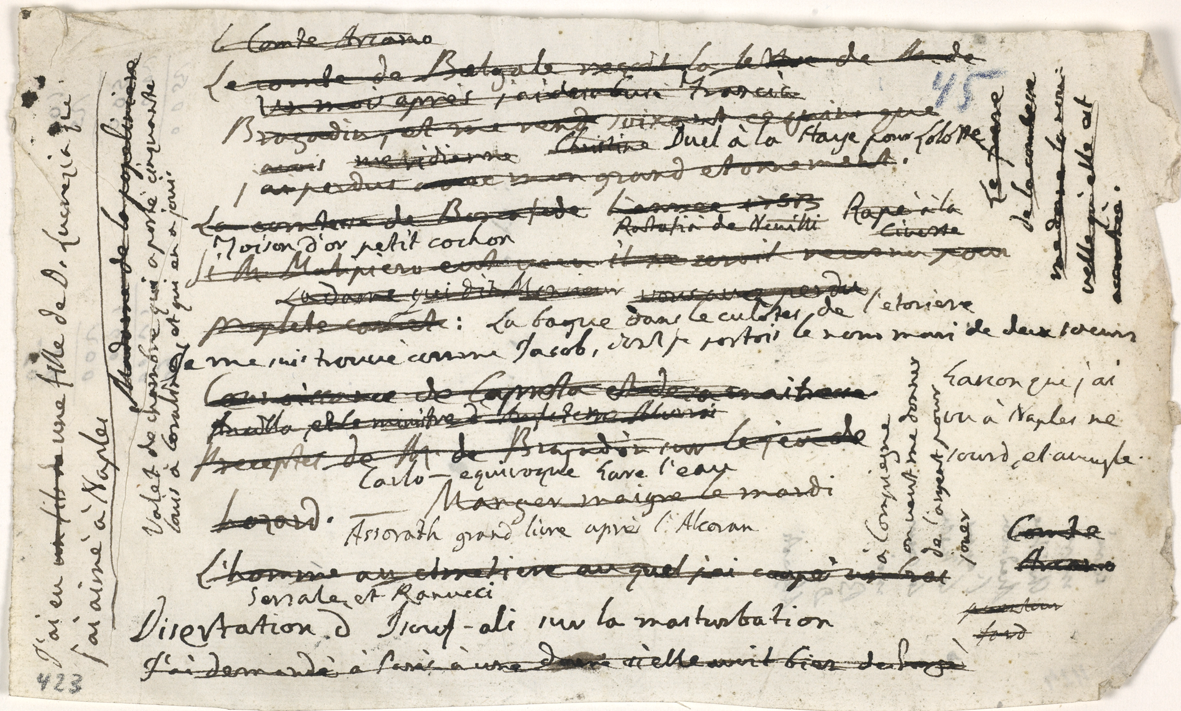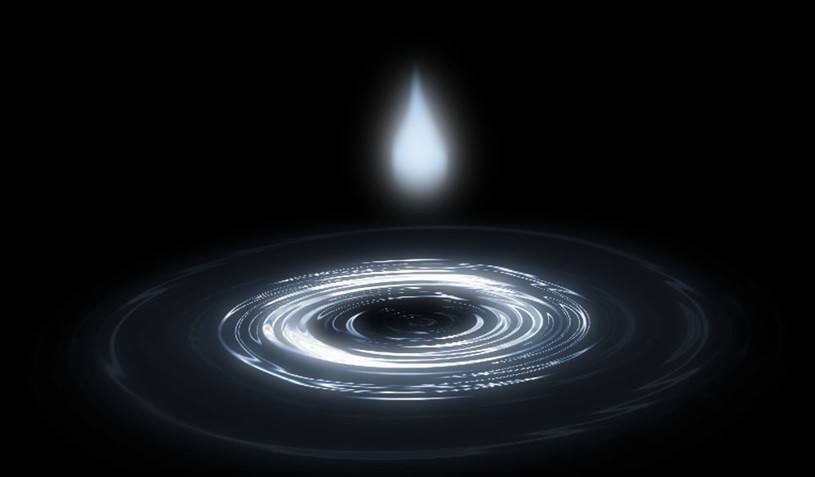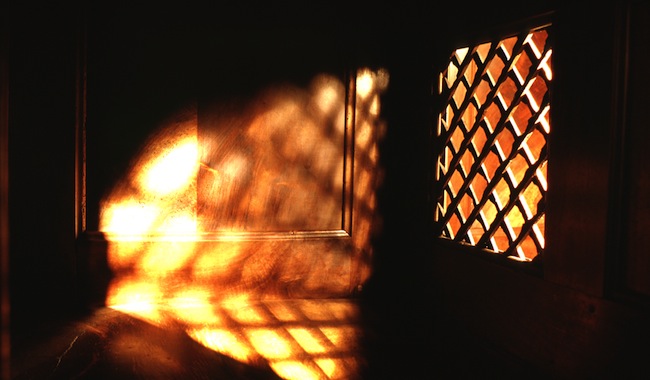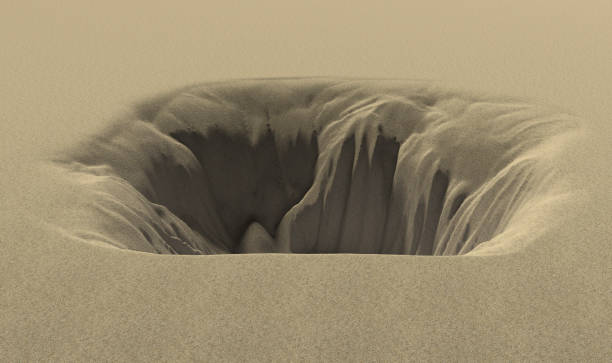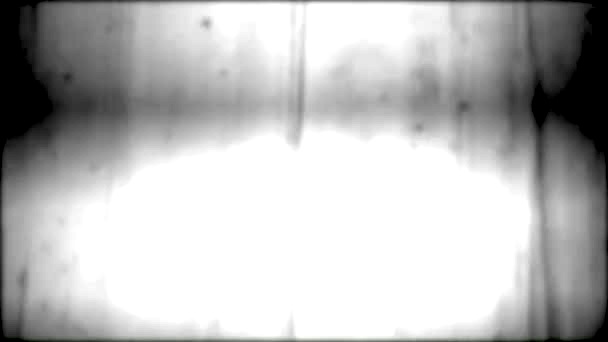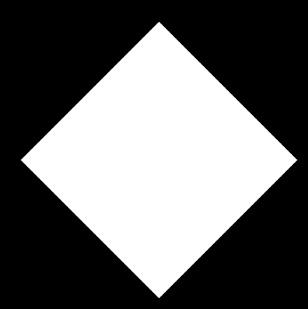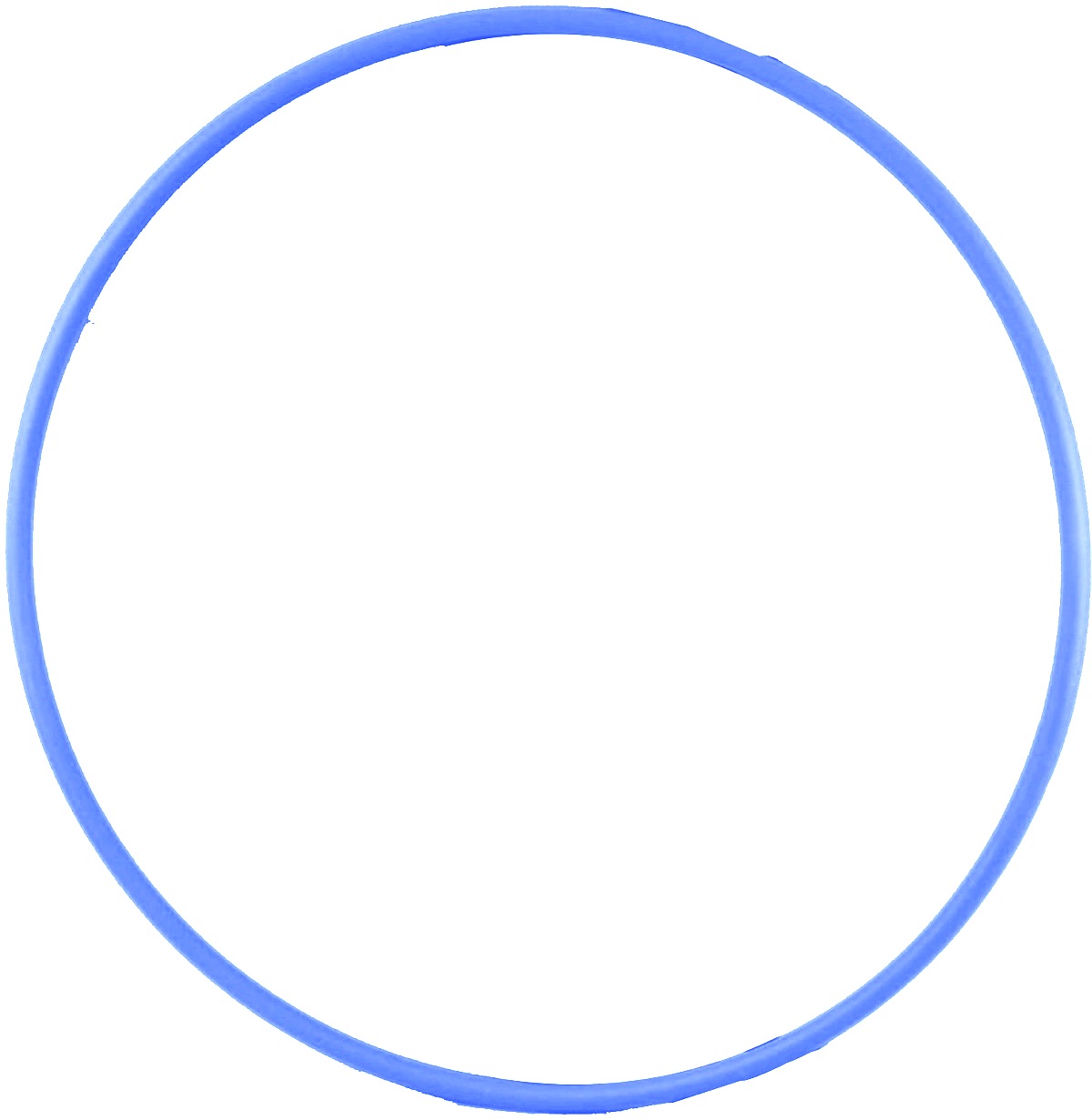L’HOMME DE CENDRES
- Au coin de la rue
…on devrait se taire, à jamais, pas se quitter au coin de la rue, se dire au-revoir et bonnes vacances, repose-toi bien, prend du bon temps, du bon air, décompresse, tu verras ça ira mieux, pense à toi d’abord, tu existes, c’est important, la vie continue, et on dit ça au coin de la rue, il est un peu tard, on en a assez d’entendre l’autre, de le regarder, en même temps quelle nostalgie de le quitter, quel soulagement, il a la parole pesante, son silence est encore pire, lui ai-je dit ce qu’il fallait, si j’ai tant parlé c’était pour ne pas l’entendre, pour ne pas l’entendre j’ai poussé ma ritournelle, cela ne m’intéressait pas de lui raconter mes histoires, d’engager un dialogue au restaurant, de lui montrer tout ce que j’avais fait pour qu’il sente bien que lui aussi pourrait s’agiter, sans compter le plaisir de se faire mousser autour d’un verre, il boit peu en public, pourtant il boit, c’est marqué sur sa figure, avec sa barbe il va ressembler à Van Gogh… Comment il était avant, sans la barbe, sans l’alcool ?… Il a de belles mains, c’est peut-être ça qu’il faudrait lui dire, pas lui demander « et toi, qu’est-ce que tu fais », le pousser dans ses retranchements pour qu’il raconte à son tour ce qu’il a bien pu faire de captivant, et lui redire combien tu aimes ce qu’il écrit, ce qu’il peint, ce n’est pas vraiment ça qui compte ce soir-là, ce n’est pas de parler des films et des textes, ce serait de supporter le silence, de ne pas se quitter au coin de la rue, sous le panneau d’interdiction de stationner, vers onze heures du soir, sous la lumière bleue des réverbères, de ne pas se quitter avec cette lâcheté au ventre, ce ouf évacué avec un pincement au cœur : il s’en va dans le mois d’août, j’ai failli lui proposer de venir me voir à la campagne, j’ai été prudent, j’ai demandé « et en août qu’est-ce que tu fais ? », il a dit qu’il travaillait en août, cela m’a donné bonne conscience, on n’invite pas en vacances quelqu’un qui travaille, on ne va pas se mouiller, des fois qu’il cesse de travailler pour venir en vacances, ça me faisait peur des vacances avec lui, ses colères, ses volte-face, ses problèmes, j’avais envie de repos, déjà bien assez de se prendre en charge sans la charge des autres, et puis il n’aurait peut-être pas accepté, on ne va pas proposer quelque chose à qui le refusera, et puis bon, j’étais fatigué ce soir-là, content de le voir mais pas trop longtemps, c’est fréquent avec ceux qu’on aime, ils s’appuient sur vous, on en a l’impression, on s’ébroue, nous voilà tranquilles, on ne va pas plonger dans le noir tout le temps, chacun sa vie, l’ennui c’est qu’en parlant ensemble, on a dit tout sauf ce qu’on devrait dire, qui est là, au creux de la joue, comme une chique, crache le morceau, crache, mais personne ne crache, on s’est vu, on s’est parlé, ce n’est déjà pas si mal, si on s’est vu c’est qu’on en avait envie, un beau résultat pour l’espèce humaine, c’est déjà magnifique de se téléphoner, mais qu’est-ce qu’il devient, je croyais l’avoir oublié, non, omis, seulement omis, c’était comme ça pour moi, pour lui comment savoir, la dernière fois c’est lui qui avait appelé, j’aurais dû prêter attention à cela, c’est lui qui appelle, alors on a pris une bière rue La Fayette, à une terrasse, au crépuscule. Il était là quand je suis arrivé, avec ce visage fiévreux qu’il avait désormais, cette barbe, cette haute silhouette, ces vaisseaux éclatés sur la face, il m’a toujours impressionné, là encore plus, le soleil rougeoyait encore, je ne sais plus de quoi nous avons parlé, nous ne nous étions pas rencontrés depuis plusieurs mois, il y avait le boucan des autobus montant vers la Gare du Nord, il buvait déjà une bière quand je suis arrivé…
- Comptine et confidence
…amour en torche torchis d’amour à coups de mouches amour sous roche amour en cendre torture d’amour tordu d’amour tendre amour tendu d’amour d’amour tancé t’en sais rien d’amour mordu d’amour mielleux d’amour amour marâtre amour et mat d’amour mateur amateur d’amour corsé d’amour à cœur d’amour à con d’amour à terre sang d’amour ongle d’amour violé d’amour voilé d’amour coupe d’amour cou d’amour court amour amour de cour crachat d’amour étouffe amour touffe d’amour toupie d’amour étoupe d’amour trace amour mourmoure d’amour où souffle amour en fuite…
- Souvenirs terribles
…Ensuite, du ventre sortent de la poudre, des verges, un
mur
le ciel d’un œil la peau retournée sur
l’os
où glisse une larme
– toi qui porte un habit bleu, sachant jouer du couteau, tu
tais cela sous ta voilette.
– chocs plus rigides qu’amant ne fut jamais sphères noires où claque ta semelle.
(Je le tourne dans mon ventre 1’auréole de mon sein le tripote de
mes doigts
il est là, en moi, m’étoffant de son suc moi, en lui, m’écartant, je piaffe)
Souviens-toi du jour qui ne dura qu’en notre bouche
et partit en fumée sitôt que nous le respirâmes.
Souviens-toi, insomniaque, attaché au remords comme un
cheval aveugle.
Souviens-toi de la coupe de salive que j’offris à ta langue
pour qu’elle chante contre mes dents.
Souviens-toi du premier coup de pioche dans mon cœur
et comme il sonne encore lorsque, levant les bras,
tu t’envoles.
Souviens-toi d’être nu, fragile et sans rêve.
4. Autre souvenir
« Il n’y a pas d’amour qui ne puisse être consolé » : il disait cela, me déchirant de ses lèvres ; dehors, la pluie tombait sur les âmes avec un bruit qui couvrait ses baisers. Parfois il pleurait, mais je n’entendais rien. Dans un coin, seul, il pleurait. Son dos était secoué de frissons. Puis il revenait vers moi et j’ouvrais les jambes. Au matin, il prenait mes doigts, s’étonnant qu’aucune goutte de sang ne s’échappe des ongles, et je devais lui rappeler que nous étions morts. « C’est vrai, j’oubliais, disait-il, nous sommes morts de nous être aimés ».
…Sa tête contre mon flanc s’enfonçait. Elle restait là si longtemps, l’oreille collée à ma peau: j’avais la sensation qu’elle me sortait du ventre – alors je la tirai par les cheveux jusqu’à mes seins. Elle tétait goulûment. Alors je la portai à mes lèvres et elle me dévora. Enfin, je la reposai sur le canapé. Nous restâmes ainsi des heures, elle de profil, avec un sourire idiot tandis que je regardais la télévision.
Le lendemain, j’ai cousu un sac en coton épais et bleu, fermé par un lacet de cuir noir. J’ai mis sa tête dedans et nous sommes allés flâner par les rues qu’il aimait. C’était un dimanche de novembre, beau et froid. Personne ne s’est aperçu que je portais la tête de mon chéri. Au retour, j’ai acheté à manger pour deux. Le dernier jour, avant de l’enterrer dans le jardin, j’ai voulu la dessiner, mais je n’arrivais pas à saisir son sourire – le front, le nez et le menton, ça allait, mais le sourire se tordait. J’ai renoncé.
- Berceuse pour l’amour mourant
Torche m’amour à coups de mouches
M’amour en cendres tordu d’amour
M’amour marâtre d’amour et mat Haut con
d’amour amer M’amour cou d’amour court
amour Crachat d’amour étouffe amour
Toupie d’amour dessine amour Mourmoure
m’amour où souffle amour en fuite
- Lamento
…J’ai ouvert le placard, j’ai jeté ses vêtements à terre, les cravates, le chapeau. J’ai grand peur qu’il ne revienne, me saisisse par l’épaule, me jette à terre, m’étreigne. Son odeur est là. J’ai grand peur qu’il reparte sans me toucher, ou qu’il tombe en miettes,
– Je te baise les pieds, mon chéri. Voici des violettes. J’ai ciré tes souliers. Viens en moi et va-t-en.
– Au delà des montagnes m’attend la charogne et j’ai grand peur de moi et t’offre ma dentelle.
– Allons virer ma belle. J’ai ôté ma cuirasse, jeté mes mains aux pierres. Viens que je t’accroche.
Soudain il n’est plus là et je pleure. Soudain le voici et j’ai peur. Plaquée contre ses os je m’effrite. Une jolie petite fumée s’élève à l’horizon ; l’odeur des champignons sous les feuilles mouillées, un parfum de terre écrasée, l’empreinte d’une semelle, une écorce fendue – mon chéri est là. Sous les bois éclatés je le prends dans mes bras, l’étouffe de baisers. Il suffoque. Le voilà mort sans m’avoir aimée.
- Autre lamento
…Quand il ouvrait les bras, respirant à peine, la terre ruisselait sur ses tempes. Je voyais bien qu’il allait s’endormir d’un sommeil injuste, qu’il était un oiseau prisonnier. Son cœur battait à peine et sûrement plus pour moi. J’ai ouvert les fenêtres mais il s’agrippait à chacune de mes veines, à chacun de mes mots. « Parle plus fort », disait-il, et aussitôt : « moins fort, tu me fais mal ». Je baissais la voix au point qu’elle n’était plus qu’un filet de sueur. Un rapace déchiquetait mon poignet, avide de ma chair, pour s’envoler, droit et haut, loin de mes caresses. Ses ailes battaient dans mon crâne – affreux bruissement.
- Chanson du rapace
L’amour est seul
La nuit est seule
L’aube est seule
L’océan est seul
Le ciel est seul
La gorge est seule
L’écume est seule
La poitrine est seule
Le souffle est seul
Le dernier souffle est seul
La pierre est seule dans la main
La main est seule dans l’écume de la nuit et seule l’aube
Le soleil est seul sur le drap et seul le drap et seule la blancheur du drap sur la face qui ne voit plus
Seul le sang qui ne coule plus dans la veine
Seule la main qui ne porte plus son poids
Seule la voix que ne porte plus le souffle
Seul le souffle d’avoir été seul à l’instant de solitude
- Au coin de la rue
…On devrait se taire, à jamais, c’est pas possible, là, dans la gorge, ses cris sont là, à la place des miens, au moment où je m’y attends le moins, et son visage, sa démarche, en désordre, avec du gris autour, pour tout noyer, il est devenu un homme gris, pas un fantôme, un homme de cendres, c’est difficile de marcher dans les cendres, elle volent, si vous respirez, elles envahissent la gorge, on est obligé de respirer, elles entravent la marche, et il faut marcher, elles vous grillent les yeux, si on garde l’œil ouvert elles vous le ferment, on aime bien voir quand même, et les oreilles pareil, la cendre dans l’oreille, sur les meubles quotidiens, le lit quotidien, le cerveau quotidien, c’est volatil la cendre, pire qu’un corps pourri sous la terre, compact, ou bien il faudrait la ville entière en cendres et moi aussi, des cendres contaminées par le souvenir, alors qu’au cimetière où je suis allé où les cendres sont là, dans le « Jardin du Souvenir », l’endroit que l’on saupoudre de grands brûlés, je cherchais la trace de ses cendres sans les trouver, ça l’aurait fait rire cette recherche, où sont ses cendres, où sont ses cendres, j’étais venu seul, après la dispersion, je m’étais d’abord perdu parmi les tombes, enfin j’y étais, il devait bien y avoir ses cendres, il y avait bien des cendres, les siennes ou d’autres, et des bouquets de fleurs données aux cendres, moi je n’avais rien amené, je lui ai parlé, j’ai fait silence, je lui ai parlé, il se taisait, je lui racontais mon rêve d’une nuit passée, où il m’apparaissait ainsi, en homme gris, cité Rougemont, à côté d’un perroquet, le perroquet disait « bonjour, bonjour », c’était décourageant d’être accueilli comme ça, même dans un rêve, le perroquet sifflait La Marseillaise dans une cage, devant l’Hôtel de Madrid, l’homme gris restait toujours silencieux, « alors, tu es venu », il disait cela enfin, gentil, enjoué presque, moi j’entendais « alors tu n’es pas venu », peut-être avait-il dit ça, venir ou pas, c’était pareil, on vient en intention, c’est l’intention qui compte, venir ou pas, je m’étais déjà expliqué avec lui après sa mort, sûr qu’il comprendrait, l’ennui c’est qu’il ne répondait rien, mais j’avais balayé mes scrupules, j’avais de bonnes raisons de n’être pas venu, d’abord d’autres étaient venus, ensuite je viendrais un autre jour, seul, sans célébration, sans pleurs, cela lui plairait, mais aujourd’hui, il me disait que j’étais venu alors que je n’étais pas venu, non, c’est lui qui était venu, c’est moi qui aurait dû lui dire « alors tu es venu » et lui aurait répondu « je suis là, à côté de toi, puisque tu n’es pas venu me voir partir en fumée », on marchait côte à côte, il avait rasé sa barbe, le timbre de sa voix, la silhouette qu’il revêtait, sa parole pendue à un fil, c’était donc pour moi, les morts n’étaient pas du côté des morts mais aux flancs des vivants, il fallait lâcher la proie pour l’ombre, il était guilleret, j’étais rassuré, s’il m’en voulait juste assez pour guider mes peurs, mes lâchetés, c’est qu’il m’aimait assez, me comprenait, me justifiait, il était mort, moi vivant et nous cheminions jusqu’au coin de la rue, lui mort, bien mort puisqu’il était là, à côté de moi, quand tous les témoins attestaient qu’il était parti en fumée, qu’une trace de cendres avait coulé, il marchait vite pour un homme en cendres et cette marche forcée m’avait réveillé avec un goût de cendres dans la bouche, et j’étais là, devant ses cendres ou celles d’un autre, de quelques autres, à ne plus pouvoir parler, juste des choses comme « cendres, descendre, dégoût », pour n’être pas venu près de lui au mois d’août, on devrait se taire dans ces cas-là, mais on ne peut pas, on cherche à se dédouaner, à ouvrir un peu ses tripes, des fois qu’un peu de cendre en tombe, des mots, c’est pareil, la cendre, les mots, moi aussi j’ai brûlé un peu, non, non, tu t’es donné en spectacle, c’est humain, pour ne pas mourir, voilà, tu tiens l’alibi, pour ne pas mourir, toujours ça de pris, pour ne pas devenir un homme de cendres, enfin, pas tout de suite, je dis tout ça pour le remord, parce que le remord brûle la mémoire, mais très lentement, tout le temps qui reste à vivre.
- Valse-prière du Non
Non arrachement non venir non baiser non partir non pas là non plus pas dit
non
Non blessure qui ne dit non seulement dire non je t’aime non qui ne fut
Non pas non non point l’aube où les mains serrant la mort non pas moi pas moi l’autre non plus Non peut plus
Non qui ne fut non ne clame non
Non de Dieu non amour non exil non lèvre qui ne dit non
Non sueur non sanglot non foutre non dégoût non fièvre non regard non ténèbres
Non d’être non je te prends dans mes bras je te prie d’être moi en toi qui est moi je suis oui peut-être oui voilà je t’enfouis dans mes bras je te crie d’être là oui je te berce oui je ne suis plus là absente enfin pour toi – non
(1992)
L’INCARCÉRATION
Lorsque, suivant mes ordres, je fus incarcéré entre quatre châtaigniers, je n’avais pas imaginé la beauté sublime du paysage. On avait hissé la cage au cœur du faîtage des arbres, non sans mal : la masse des barreaux jointe à celle de mon corps avait donné du fil à retordre aux amis chargés de la besogne – mais ils avaient promis de me percher et tenus leur promesse. L’endroit était solitaire, difficile d’accès, chargé de broussailles, de ronces et de genêts dont l’enchevêtrement rebutait : la vue et l’odeur ne gêneraient pas les promeneurs. Et si quelque chasseur s’aventurait par là, en quête de chevreuil ou de sanglier, eh bien tant pis pour lui. Au demeurant un chasseur ne doit pas être choqué par ce genre de sensations fortes. Je ne cache pas préférer d’autres visites – celles que me rendent mes petits amis de la forêt : buses ou corneilles tendant leur bec entre les barreaux, merles et rouges-gorges se glissant jusqu’à moi, belettes caressantes, rats qui ne me font pas plus horreur que les colonnes de fourmis, les tournoiements de guêpes et les myriades de mouches. Tous ces bruissements, cette agitation, cette formidable énergie me réjouissent le cœur, ce qui m’en reste s’entend. Et la nuit, viennent les chats-huant et les effraies. Rien de tel que la paix nocturne pour jouir de leurs frôlements, du chuintement de leurs ailes. Non, jamais auparavant je n’ai ressenti tant de volupté au fracas des branches sous la burle, à l’envol des feuilles, au poudroiement des gelées blanches, aux voltiges du soleil et de la lune ; jamais le silence minéral des étoiles ne m’a semblé si évident et si proche du silence qui m’envahit chaque jour davantage, à mesure que mes chairs partent en lambeaux dans les becs, les gueules et les rostres. Bientôt je n’aurai plus rien à dire. Les pensées, les songes même n’habiteront plus mes os qui, lavés par pluie et neige, éclatés, poudre de perlimpinpin, formeront, un excellent humus aux repousses de châtaignier.
LA BOÎTE À OUTILS
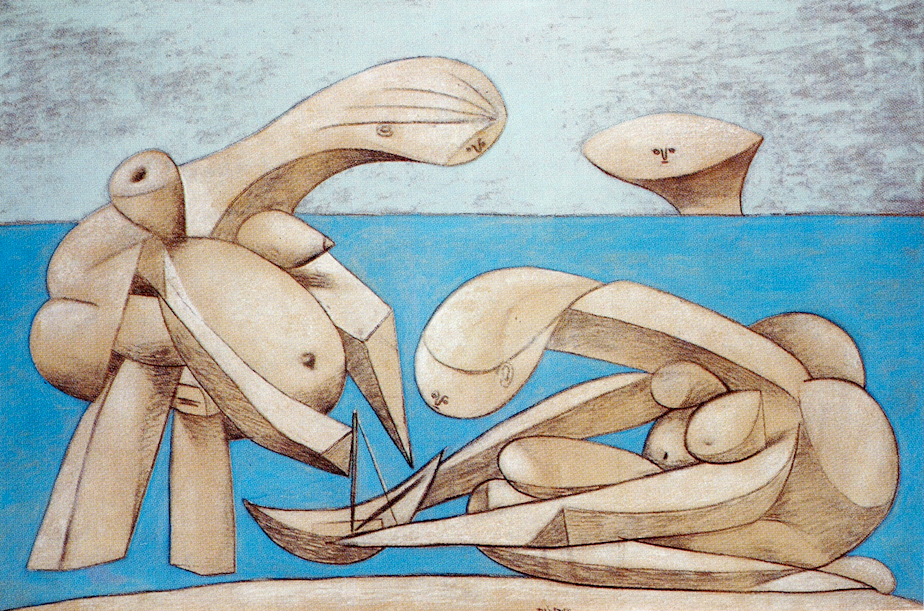
1
Le serrurier vivait en concubinage avec Madame Roussel, la concierge : aussi l’appelait-on Monsieur Roussel, sans qu’il s’en offusquât. Il portait une casquette à carreaux, une veste en coutil noir, une moustache à la gauloise et se roulait du Caporal. Son couvre-chef ne le quittait jamais sauf quand il saluait Papa, le médecin de l’immeuble. Papa auscultait Monsieur Roussel qui sortait sa boîte à outils. Sa petite taille lui permettait de raboter les portes avec facilité – c’est ainsi que je voyais les choses – : on change souvent les moquettes quand elles s’usent sous le poids des malades. Monsieur Roussel dégondait les vantaux en soufflant dans ses mains. C’était aussi un héros : pendant l’Occupation, la Kommandantur locale siégeait dans l’escalier A. Monsieur Roussel cachait des Juifs dans l’escalier B et des aviateurs anglais dans 1’escalier C. A quoi servait l’escalier D, le plus lointain, le plus sombre, le plus glacé ? Des silhouettes s’y faufilaient.
2
Quinze centimètres de haut, autant de large, vingt-sept de long – quand Monsieur Roussel mourut sa boîte à outils resta chez nous. Pour éviter les confusions. Maman, d’un coup de pinceau noir, y marqua CLOUS. L’inscription s’effaça avec le temps mais elle est encore visible, quoique le C, et surtout le L, soient à peine lisibles. Monsieur Roussel avait fabriqué la boîte, quatre planchettes de sapin patinées de crasse et de taches, de traces de coups de crayon, bleu ou rouge – de ces énormes crayons bicolores que les artisans enfouissent dans la poche de leur salopette. Le couvercle, articulé par deux grosses lanières en toile beigeasse fixées chacune par trois clous de tapissier, se renforce de petites lattes de bois. Percées transversalement, elles permettent le passage d’une poignée en ficelle dont chaque extrémité se termine par un nœud. Deux fers recourbés, tenus par des pointes au corps de la boite, permettent, en pivotant, d’ajuster le couvercle tenu hermétiquement clos. Il y aussi marqué CLOUS sur le couvercle, mais on ne distingue plus que les trois premières lettres. Maman, qui était artiste-peintre, a dû placer des tubes de couleur dans la boîte, à moins qu’elle ne l’ait manipulée, les doigts encore tachés de bleu de Prusse et de vert Véronèse : il y a des traces un peu partout.
3
Vingt-neuf ans après, la boite est pleine de femmes nues qui se dorent au soleil. Quand elles s’offrent ainsi aux ardeurs des ultra-violets, on ne peut les approcher qu’avec des désirs candides. Voulez-vous un peu de thé, ou bien une orangeade ? Encore ai-je l’impression de les sortir d’une quiétude éternelle. Elles s’offusquent d’être découvertes, là, entre elles, dans le gynécée de l’aube du monde. Bien qu’il soit quatre heures de l’après-midi (une heure honnête) et que je passe par hasard, elles me soupçonnent de les épier, alors qu’innocemment je vaquais à des banalités, ignorant tout de leur présence et de leur nudité. Elles esquissent le geste de ramener un bout de paréo sur leur ventre, en abandonnent aussitôt l’idée : je les aies déjà vues, non ? Et puis zut, la grève est à tout le monde, voilà ce que je pense. L’œil en coin, je répète : une orangeade, non ? et elles acquiescent, mollement outrées de mon insistance, de cette tentative de me réapproprier la plage. Elles estiment peut-être que je suis un cochon, mais elles ont accepté la proposition. Le résultat avant tout. Illico, je reviens avec les verres et la boisson, elles se laissent servir, sirotent en se demandant : combien de temps va-t-il rester là ? Et je reste à boire en jouissant de la beauté de leurs seins, jusqu’à ce que, faisant comme si je n’existais plus, elles se replongent dans le sable blanc, bras et jambes écartés, cambrées vers les rayons, échangeant vaguement quelques propos intimes confirmant que je suis étranger à leurs yeux : leurs corps brillent au soleil, c’est la seule chose qui compte. Et, quand l’une se retourne, offrant ses fesses au ciel, tandis que l’autre s’étire, le cou gonflé comme si elle suçait de la neige au sommet du Mont Blanc, je comprends enfin : il n’est que temps de refermer la boîte de Pandore.
4
Avant d’en arriver là, avant d’avoir ouvert la boîte à outils, j’avais totalement oublié l’objet dans l’armoire de la salle à manger. Elle y somnolait, emplie de clous rouillés. Trois fois l’an, j’y jetais un œil dans l’espoir – toujours vain – de trouver de quoi accrocher un tableau au mur. Puis j’avais prêté la maison à une amie sculpteure – une histoire de félins à nourrir en mon absence, six gaillards en pleine croissance, plus une chatte centenaire à soigner. Un mois passe, l’amie rend la maison, m’invite à dîner chez elle, et, comme je prends congé, me tend un paquet joliment ficelé : « – Je t’avais emprunté cela », dit-elle. Cela pèse plutôt lourd, bringuebale. « – C’est fragile, non ? » « – Non. » Chez moi, avant d’ouvrir le paquet, je le secoue doucement : il fait un petit bruit de hochet, à la fois doux et sec quand on l’approche de l’oreille. J’ai eu l’idée de me contenter de ça – du tintement mystérieux. Puis, brusquement, dans la nuit, j’ai déchiré le papier. La boite à outils de Monsieur Roussel ! Une sculpteure a besoin d’outils, ai-je pensé, mais je trouvais l’affaire louche. J’ai ouvert la boîte. Elle était pleine de femmes nues qui se doraient au soleil.
L’AURORE
« Cela s’appelle l’aurore, n’est-ce pas, l’aurore aux doigts de rose ? » dit-elle. « C’est un moment que je déteste. On en prend plein la gueule. Ah non merci ! C’est tout juste bon à se fourrer au fond du lit – ou à se faire fourrer ». Comme je lui fais remarquer le manque d’élégance de ses propos, elle rejette la couverture, apparaît nue, jetée en travers du drap. Elle brandit la main droite : « L’aurore, je l’ai au bout des doigts. Ce n’est pas poétique, ça ? ». Dehors, le soleil d’hiver s’ajuste entre les cheminées, vient claquer sur ses seins, ricoche contre ses ongles, rend transparentes ses phalanges où je pose mes lèvres. « Ah, tu fais de l’ombre ! ». Elle me saisit la tête, la fait glisser jusqu’à sa touffe et murmure : « J’aime l’ombre ». Cette ombre-là est salée, amère, épaisse de la nuit où j’introduis ma langue. Je ne sens rien que cette huile où se perd ma salive et le mouvement s’amplifiant de son con. Soudain elle rit : « Tu n’es qu’on cochon dans l’ombre », et son ventre tremble, ses cuisses m’enserrent d’un étau, à croire que mes tempes explosent. Elle gémit si fort que les voisins doivent entendre, puis s’apaisant : « Tu as vu le brouillard ? ». Si je l’ai vu ! A en suffoquer. C’est un nuage où perlent la transpiration et la rosée. « Tu vois le brouillard ? Tu sens le brouillard ? C’est toujours comme ça à l’aube ? » Sa main est venue frôler mon sexe : « Mais c’est une barque, non : un cargo, non : un transatlantique ! Queen Victoria ! Queen Elizabeth ! Normandie ! Lusitania ! France ! ». La diablesse oublie-t-elle que la moitié de ces paquebots ont coulé ? L’instant d’après, elle hulule : « Je suis la sirène de brume, je guide le navire », puis elle ne dit plus rien, sa bouche roulant la coque du vaisseau au point qu’il manque décharger sa cargaison. « Allons, il faut entrer au sexe », elle lance cela d’une voix si droite et si fluette – mais c’est elle dont les vagues m’enclosent et tanguent, elle me chevauchant, ménade muette, poitrine dressée dans le contrejour, dans le brouillard de ses yeux clos, dans l’aurore de son ventre, elle dont la sueur est brume et lumière d’aube m’emmenant à oublier dans un même tourbillon silencieux d’étincelles et d’étoiles filantes la nuit et le soleil levant.
LA DOUANE
Les petits morts ne sont pas d’accord : je ne suis pas allé leur rendre visite. Ils sont restés dans le brouillard et les perles de pluie, à suggérer : « Direction Nord-Nord-Ouest, orientation résurrection, pôle et vent de Travers. Hardi ! Tiens bon le cap, gabelou ! » « Douanier ? » rétorquai-je. « C’est ça, garde-frontières, garde-fou, les fougères sont cramoisies ». C’est donc ainsi : qui ne salue pas les petits morts le jour de la Nativité reste en lisière du royaume des défunts et du vif. Cela s’accomplit sans pleurs ni grincements de dents, tel le songe cristallin d’une princesse somnolente à l’estomac gavé de merles et d’arsenic. On tient le poste. Quiconque s’approche est étiqueté (empreintes, haleine, tessiture, généalogie, espérance de vie). Quiconque (à l’exclusion des mésanges, renards, punaises volantes), quiconque franchit le fil n’y coupe pas : « Qui vive ? » – mais je sais déjà à qui j’ai affaire. « Z’allez voir les petits morts ? Z’avez déraison ? D’excellentes raisons ? » – mais je connais dès avant leurs raisons. « Z’avez pas peur? » – je n’ignore rien de leur terreur. « Z’avez envie de passer ? « . Puis je leur explique, oh bien patiemment : il faut payer, se dépouiller, oui, passer nu – et j’arrache leurs vêtements. « Plus rien, c’est la règle et vos pensées vous les gardez pour vous ». Personne, jamais, ne se rebiffe ou si peu (dans ce cas, section d’un doigt). Je les accompagne un bout de chemin. Ne pas oublier, dixit le règlement, d’évoquer l’arc-en-ciel au bout du chemin. J’évoque donc, sommairement. Les passants m’avaient prévenu, les petits morts, sont d’une extrême sensibilité : un peu de ciel bleu et ils fondent, un coup de pied au cul, ils se noient dans un verre de porto et le silence les prend à l’instant où ils s’y attendent le moins.
J’étais devenu douanier assermenté. Passé le temps où j’y trouvais de la drôlerie, je découvris l’immense monotonie des passagers, leurs gueules de crépuscule, leur effarement subit : « On y est déjà ? » Un oiseau pépie et ils ne l’entendent plus. « A ce moment-là, m’avaient conseillé les petits morts, parlez-leur résurrection. » « Résurrection à des oreilles bouchées ? » « Parlez résurrection et vous serez surpris ». Je le fus : les passants frémissaient, frétillaient. S’ils l’avaient pu ils auraient ouvert les yeux. En eux, le ciel s’éloignait sans fin, sans même la lumière d’un souvenir. Ils croyaient aller vers la résurrection des corps mais l’archange du plaisir n’était pas au rendez-vous. Des fils glissant l’un sur l’autre, voilà ce qu’ils étaient devenus ; des fils s’usant l’un l’autre sans jamais se toucher. Non, je n’invente rien : ces morveux voyaient leur substantifique moelle s’effondrer sur elle-même à mesure qu’ils pensaient progresser vers leur apothéose. Leur éternité ne tenait plus qu’à un fil extraordinairement fragile et ils ne s’en doutaient pas. J’ai encore en mémoire cette réflexion d’une femme à la peau blanche et aux cheveux de jais: « Jamais je ne me suis sentie aussi légère. C’est comme si j’avais perdu tous mes malheurs ».
LA FILLE DANS LE FAUTEUIL
S’il l’avait invitée c’était pour ne pas y toucher. Le soir, elle se lovait dans le fauteuil club et tout dans ses formes avouait qu’elle était grâce alanguie, féline assoupie – carrément endormie, pensait-il. Elle était gourde sans être idiote, et ce mélange d’eau somnolente, de petit soleil embué, de hanches généreuses s’avérait plus excitant que prévu. Quand il l’avait invitée, il gardait le souvenir de doigts aux ongles bombés, de quoi le refroidir. Mais où avait-il inventé cela ? Ses doigts étaient charnus et longs, les ongles plutôt effilés. Et puis, alors qu’il l’avait connue désespérément sobre, elle buvait du gin-fizz. Un demi-verre suffisait à lui délier la langue. Elle babillait, parlant de chats, de chiens et de littérature, un mot dont elle ignorait les excès en dépit d’études de lettres encore fraîches. Lui, l’aurait bien initiée aux mystères et aux affres de la création – d’autant que, relevant ses bras longs et ronds, elle dévoilait des aisselles rasées, où les poils commençant de repousser titillaient sa vue. Il aurait bien joué à l’oncle, un rôle auquel le prédisposaient l’âge et l’embonpoint – mais il subodorait des ennuis sans fin liés aux fragilités de la fille. Ah, s’il s’était agi d’une petite bourgeoise, l’affaire aurait tourné autrement, mais l’absence totale de malice de l’héroïne ne prêtait pas au libertinage. Neuf sur dix à parier qu’elle était vierge ou presque. A moins qu’elle ne cachât son jeu ? Il la traitait en nigaude mais s’apercevait qu’elle redoutait d’être perçue comme telle. Du coup, elle en rajoutait, accentuant un accent traînant, quasiment lyonnais, et, du cœur de cette gouaille, surgissait une souffrance touchante, une barrière qui interdisait le contact. Comment franchir la barrière ? Un soir, il avait eu le culot de lui faire la morale : quel dommage qu’une fille aussi intelligente, aussi sensible, ne s’affranchisse pas des pesanteurs de la vie, ne s’élance pas (il n’avait pas précisé vers qui), tu vis très en deçà de tes capacités, tu as un potentiel formidable, etc. Sur le moment, il pensait presque à ce qu’il énonçait, il en était ému, oui, sans percevoir que cette émotion venait de son propre élan. Elle n’avait rien répondu, paraissant seulement acquiescer. Mais, dès lors, chaque dîner était devenu si pesant qu’il redoutait la suite – leur réunion digestive, chacun assis face à face dans un fauteuil, tournait, lentement, méthodiquement, au psychodrame. Elle avait des emportements subits, se lançait dans des analyses politiques sauvages, puis retombait dans des fadaises ; lui n’avait qu’une hâte : quitter la salle à manger et cette compagne aussi insatisfaite que lui. Il guettait le moment où elle lui annoncerait son départ de la maison, espérant toujours qu’un incident l’anticiperait. Un climat de langueur armée s’était installé entre eux, brusquement rompu lorsque, invités ensemble chez des amis, elle avait raconté comment il l’avait sermonnée, ajoutant qu’il la prenait pour une imbécile. Les amis avaient détourné la conversation et tourné l’incident à la blague. Il l’avait blessée ce soir-là, profondément sans doute – non seulement en fouillant une plaie, mais faute d’avoir perçu qu’à travers ses paroles maladroites il avait tenté, lui, de franchir la barrière sans se l’avouer : le plus coincé des deux n’est pas celui que l’on pense. En fait, essayant de sauter l’obstacle, il s’était en même temps arrangé pour dresser une barrière infranchissable. Il s’était empêtré et elle l’avait regardé s’empêtrer. Il lui avait manqué un peu d’humour, un peu d’audace : avouer par exemple qu’il se conduisait en cuistre pour masquer son trouble et sa timidité. Ou laisser déraper ses lèvres, le soir, au moment de la bise traditionnelle. A priori, du moins le pensait-il, elle n’aurait pas été contre. Lui avait-il seulement demandé – autrement que par politesse – ce qui l’intéressait, elle, dans la vie ? Aucun souvenir. En fait il perdait le contrôle de la situation. Plus les jours s’égrenaient avec une lenteur désespérante, moins il avait de prise sur la jeune personne. Maintenant, il redoutait d’ouvrir une porte, le timbre de sa voix le faisait sursauter, il lui conseillait vivement d’aller se promener (lui, n’est-ce pas, devait travailler) ; il lui trouvait des copains pour l’emmener visiter, sans lui, les châteaux en ruine de la région. Le pire était resté cette excursion en montagne avec le cousin, une longue marche en pleine chaleur. Il n’avait pu refuser d’être de la partie. Et le cousin les avait laissé seuls, à trotter sous le soleil, par discrétion, comme s’ils étaient un couple d’amoureux. Elle allait devant, nonchalante, couronnée de mouches ; lui ne desserrait pas les dents, refusant jusqu’au plaisir du paysage, une splendeur obscurcie par la promeneuse, apparemment indifférente à son silence, à la beauté des sommets frôlés par le couchant et au tourbillonnement des insectes. A la fin, ils s’étaient allongés dans l’herbe, à distance excessive l’un de l’autre. Il aurait aimé qu’elle parle tant la tension devenait insupportable. Mais elle n’avait pas desserré les lèvres jusqu’à ce que le cousin les ait rejoints. Le lendemain, quand, enfin, elle avait annoncé son départ, il avait fait mine de vouloir la retenir, peut-être bien même souhaitait-il vraiment qu’elle reste, elle le laissait en plan, avec ses désirs contrariés, son amour-propre blessé, elle l’abandonnait pour toujours. Brusquement, elle avait lancé : « – Ça aurait pu être pire. » « – On ne s’en est pas si mal tiré » avait-il répondu. Le silence était retombé sur cet armistice conclu au débotté – preuve qu’elle n’avait jamais été dupe des hostilités engagées sitôt qu’elle avait franchi le seuil de la demeure. Combien de temps serait-elle restée ? Ils avaient fait le compte : dix jours. Mais c’était énorme ! Maintenant, elle s’était remise à discourir, mêlant des jugements péremptoires sur les parfums à la mode aux souvenirs d’un récent voyage à Prague, mais, cette fois, il n’en était pas agacé : non, il se contentait d’écouter les murmures de sa voix, seulement bercé par leur rythme. Quand elle était allée tirer de sa valise un album consacré à la ville de Kafka, ils l’avaient feuilleté de concert sur le tapis et la pénombre allait bien aux photos des rues enneigées. Quand leurs doigts s’étaient rejoints sur une vue de la Vistule, ni l’un ni l’autre n’avaient paru surpris. Elle avait appuyé son front contre le sien, posé les mains sur ses épaules. Il avait fait de même, ensuite, lentement, ils s’étaient caressé les épaules, le dos. Il avait enfoui la tête dans l’odeur de sa chevelure et commencé de promener les lèvres dans son cou. Tout cela avait bien duré dix minutes, le temps qu’il la sente frémir. Alors, il avait effleuré sa bouche. Et là, à voix basse, elle avait dit : « – Ça me dégoûte d’embrasser quelqu’un que je ne connais pas ». Puis elle avait ajouté : « – Tu veux autre chose ? » Il avait secoué la tête, bêtement. Et elle : « – Parce qu’il y en a qui veulent autre chose ». Il s’était senti glacé. Machinalement, il avait continué à la caresser, enfin ses doigts s’étaient immobilisés. Elle ne le regardait plus, du moins était-ce son impression – mais l’obscurité était tombée, peut-être se trompait-il, en cela comme en toutes choses concernant la visiteuse. Il ne lui restait plus qu’à la reconduire vers sa chambre où elle s’éclipsait d’un « bonne nuit » lourd de sous-entendus, pensait-il, comme, le lendemain, il la ramènerait à l’autocar, restant lâchement soulagé, seul dans son fauteuil club, à la traiter de mijaurée, convenant qu’elle avait su se venger – et comment ! -, à moins qu’il n’ait rien compris du tout, ce qui paraissait possible, pas consolant mais possible. N’avait-elle pas, en le quittant, déclaré : « – Tu es un homme courtois » ?
LA GUILLOTINE
Quand j’étais dans la déchéance, j’avais vendu les meubles. Tout y était passé sauf la guillotine à cigares montée sur une tablette en acajou. Je m’étais raccroché à elle parce que mes amis continuaient à m’offrir des cigares. C’étaient des amis imperturbables et ils estimaient que je devais continuer à tenir mon rang. Je comprenais bien qu’ils m’aidaient à leur façon, leur maladresse était touchante. Puis, la guillotine était belle sous le soleil d’hiver dans la grande maison vide, et elle me servait vraiment, pas seulement pour les cigares : en aiguisant la lame avec une queue de rat, j’avais obtenu un coupe-ongles pour petit doigt. Il m’arrivait aussi de trancher dans la lunette du jambon, roulé en cigare précisément, et de faire d’une pierre deux coups : j’obtenais de minuscules rouleaux à la fois économiques et esthétiques ; je graissais la lame, préservais son fil de la rouille et obtenais un meilleur rendement pour la coupe des cheveux – travail délicat s’il en est : ceux des morts de la famille, sortis de leurs enveloppes jaunies, passe encore. Le trépas et l’armoire où ils étaient conservés les avaient rendus secs et naturellement cassants. Mais les autres, ceux des copines que je coupais dans leur sommeil, ceux récupérés en touffes dans le bac à douche, c’était une autre paire de manches. Il fallait aiguiser la lame à l’extrême, tendre les cheveux au maximum (les blonds, fragiles, plus encore), opération requérant de s’agenouiller, de pincer une extrémité du cheveu entre les dents avant de le passer dans la lunette de la guillotine et d’en saisir l’autre extrémité de la main droite, enfin, de l’index gauche, d’appuyer d’un coup très bref. Cela fonctionnait une fois sur deux, presque aussi bien que pour la ficelle à volaille, moins bien que pour les mots à qui on tranche la tête ou la queue avant qu’ils aient le temps de souffler. Pas de sang, plus de vie!… J’ai raccourci des exploits d’huissier, des vers, des pattes de mouche, des symboles et des métonymies, amputé des alexandrins. Cela, et les rognures d’ongle, et les débris de cigare, et les cheveux en beaucoup plus que quatre, remplaçait avantageusement le bureau, le dressoir, le buffet de la cuisine et la télévision. Les tas avaient fini par être si gros que j’en avais bourré des vieux tissus obtenant ainsi ce que je nomme coussins-guillotine. Depuis, chaque samedi, je les vends au marché. C’est un bon petit commerce. De semaine en semaine, je me refais une santé, encore quelques mois et je pourrai me racheter des chaises. Bien sûr, il s’agit de coussins miniatures, très pratiques pour asseoir des poupées, épingler une Légion d’Honneur ou une oreille coupée.
LA PENTE

L’autobus dévalait la pente — les autobus dévalent toujours une pente, et presque toujours la mauvaise pente. Il était donc sur la mauvaise pente : une belle pente dressée d’arbres rouges, des sortes de cyprès, mais aux feuillages effilochés à la manière des structures résultant de la collision de deux galaxies ou, si l’on préfère, des touffes de gui emmaillotant de bourrelets un tronc aussi décharné que le bras d’un rescapé des camps de la mort. Ces bras ou ces arbres, anormalement élevés, formaient des flammes sur les collines tapissées de béton rose saumon. Paysage surprenant, mais défilant à toute vitesse : le passager de l’autobus n’avait pas le temps d’en analyser une parcelle qu’elle avait déjà cédé la place à une autre – de sorte que cet emboîtement d’instantanés s’apparentait à une succession d’entonnoirs où tanguait un autobus. Le passager aurait préféré se trouver ailleurs, mais, puisqu’il était là, il profitait – mains cramponnées, pieds arc-boutés – de la situation, de la vue imprenable sur les dômes qui hérissaient la ville, les virages multipliant les points de vue et les peurs. Enfin, arrivant au bas de la pente, il se trouva au niveau d’un tas de chiffons noirs, troupeau accroupi de vieillardes, que l’autobus, dans son ultime tournant, frôla. Non, il ne les écrasa pas, mais il s’en fallut d’un cheveu. Alors le passager se souvint d’un tableau et de plusieurs fusains que sa mère avait faits presque trente ans auparavant : ces arbres-flamme y étaient, et ces femmes assises. Aujourd’hui, l’autobus dévalait du ciel où tendaient les arbres, vers la cité gardée par des sentinelles sombres et mendiantes, et le passager, crispé mais curieux, songeait que la ville avait bien changé, oui, changé au moins autant que lui. C’était même le jour et la nuit par rapport au bon vieux temps de la peinture à l’huile et du fusain né des entrailles de la terre comme tout charbon qui se respecte, et dont les mendiantes, aux portes de la cité, étaient revêtues – vêtements splendidement usés, aussi dégradés que le noir tissant le papier Canson maternel. Et dire que l’autobus, son autobus, avait failli écraser cela. En vérité, il était un mauvais fils sur la mauvaise pente, prêt à saccager les valeurs les plus sacrées sur son passage, ces femmes-fusains, mendiant son intérêt, à peine agitées par le vent – la main de sa propre mère, oui ! Voilà ce qu’il avait manqué massacrer. Et les arbres rouges étaient des signes qu’il n’avait pas su décrypter à temps, emporté par le bolide des transports en commun, c’est à dire des plaisirs les plus grossiers. Les cyprès étaient des gardiens, des phares, des cierges, des quenouilles ensanglantées, des mèches vissées dans le ciel pour éviter l’hémorragie passagère dont lui venait d’être victime – c’était ça l’autobus : son énergie, à peine contrôlée, menacée d’accident à chaque virage de sa vie. Enfin, le véhicule avait cessé sa course folle, rendant le passager à son but : on croit prendre l’autobus et on paye sept francs le destin. On débarque en plein été dans une capitale méconnue, « et c’est très bien ainsi » pensait le passager. Répéter cette phrase créait en lui une plage de silence qui s’étendait à la ville entière : le passager avançait désormais dans un monde muet – et les gens, les choses, les immeubles, les chiens, à force de n’être plus entendus, avaient fini par s’effacer à mesure que le passager marchait. Lui aussi avait fini par arrêter ses pas qui ne le menaient à rien ni à personne. Désormais, il se tenait à disposition. Un autre autobus surgirait peut-être oui ou peut-être non, mais il n’était pas sûr qu’il stoppe à la hauteur d’un passager devenu invisible à ses propres yeux. Peut-être l’autobus écraserait-il son improbable passager.
LE CHAPEAU

Une femme au chapeau décoré de violettes assiste à un enterrement. Elle ôte ce chapeau, le pose dieu sait où, troublée par la cérémonie, l’a oublié. Et voici que, pendant la messe des funérailles, son voisin de banc lui souffle : « – Dis-donc, ce n’est pas ton chapeau ? », et, de la tête, il désigne la bière : le chapeau trône sur le cercueil. Sa propriétaire ne peut réprimer un fou-rire, bientôt une partie de l’assistance se gondole mezzo vocce. Quel employé des pompes funèbres a pris le chapeau aux violettes, traînant par terre pour une couronne ? Ce qui est rond et porte végétaux mélancoliques est, pour un croque-mort, une couronne, la rareté des chapeaux – même dans les enterrements – vaut bien une distraction. Il peut aussi s’agir d’une blague. Les croque-morts ont toujours eu l’esprit farce. Bien qu’il soit d’un goût douteux de faire porter le chapeau au défunt, la chose est envisageable et pas plus saugrenue qu’une décoration épinglée sur coussinet ; puis le cher disparu adorait peut-être les violettes, voire la femme au chapeau, justement parce qu’elle avait la singularité de porter des chapeaux fleuris qu’il aimait lui ôter ou lui voir ôter ou remettre quand ils se quittaient, à moins qu’il ne l’ait supportée en dépit de cette manie des chapeaux, pour d’autres qualités. De toutes façons le chapeau marquait leurs relations, il en était l’image de ralliement : il est logique qu’il figure en hommage sur le cercueil, d’autant que la femme a pu choisir de coiffer ce jour-là le chapeau aux violettes en souvenir d’un épisode de leur amitié ou de leur amour, ou de leur première rencontre – il l’avait remarquée à cause du chapeau -, ou les premières fleurs qu’il lui avait offert avaient été des violettes. Que le chapeau passe de la tête de la femme au bois du cercueil est un clin d’œil du destin qui a réuni cet homme et cette femme ; leur alliance doit continuer par delà la mort. J’ignore comment la femme récupérera son chapeau, si elle le pourra, si elle osera le réclamer aux porteurs, si elle le raflera discrètement ou si quelqu’un de l’assistance s’en chargera pour elle, si le chapeau, enfourné dans le fourgon mortuaire, descendra dans la fosse parmi les fleurs jetées sur la bière, s’il se mêlera aux couronnes sur la terre fraîche. Il semble plus logique que la femme reprenne son bien, hésitant à replacer sur sa tête le chapeau aux violettes dans le cimetière ou sur le chemin du retour, le tenant maladroitement à la main, avant, revenue chez elle, de le placer sur l’étagère d’un placard où les violettes se décoloreront lentement. Peut-être même la femme renoncera-t-elle à porter des chapeaux, mais cela m’étonnerait.
LE JOURNAL D’UN SÉNÉGALAIS
Nous savions tous que le Sénégalais écrivait un journal mais nous n’aurions jamais imaginé qu’il s’y tînt, et pratiquement chaque jour.
Il prenait des notes pendant son service, ce qui était assez désagréable : il pouvait s’éclipser, brusquement, laisser les assiettes, l’astiquage des souliers, le jardin. Il pouvait s’absenter. Ce n’était pas forcément pour écrire son journal, mais nous y pensions – forcément. Mis à part cela, il était irréprochable : nous avons donc accepté ses lubies. Après tout, s’il avait été énurétique, ç’eût été pire.
Jamais nous n’avons vu ses cahiers. Il devait courir dans sa chambre où il les avait cachés, et griffonner, à la diable, ses impressions.
Nous avons toujours ignoré d’où lui venait ce goût pour l’écriture. Bien sûr, il avait été à l’école chez les Pères Blancs, mais cela n’explique pas tout. Du reste, il lisait aussi le journal, pas de manière régulière, mais assez fréquemment pour se tenir au courant de la Colonie.
Peut-être y avait-il un lien entre cette lecture d’un journal et la tenue de son journal ?
Sa vie était insignifiante mais il a tenu son journal durant trente-sept ans.
Il était attaché à son journal presqu’autant qu’à notre famille.
Ici, hormis les jeunes filles, personne n’écrivait son journal, sauf le Sénégalais.
C’était peut-être pour se rapprocher de nous ?
Il utilisait des cahiers de brouillon et un crayon. II a dû en noircir des pages blanches !
S’il n’avait été docile comme un agneau, nous aurions pu craindre qu’il nous espionnât – mais nous n’avions rien à cacher – et le fait qu’il soit resté à notre service si longtemps, et sans anicroche, était rassurant.
Il écrivait aussi le soir : la lampe à pétrole brillait tard dans sa chambre. C’était une attraction, lorsque nous étions enfants, d’aller l’observer par la fenêtre. Il était penché sur la grande caisse qui lui servait de table. Il écrivait debout. Nous pensions que c’était pour éviter de s’endormir.
Evidemment, nous l’avons questionné, quand nous avons vu que cela durait. Mais il se contentait de secouer la tête, négativement.
Sa femme ne savait ni lire ni écrire. Elle aussi le regardait, assise dans la chambre. C’est elle qui rangeait les cahiers : il avait aménagé plusieurs casiers à bouteille en étagères.
Si nous l’avions voulu, nous aurions pu nous introduire dans sa chambre et consulter, ou prendre, ses cahiers. Mais notre curiosité n’était pas assez forte. L’habitude l’avait émoussée. Il nous amusait avec son journal – au début. Puis, nous avons oublié, oui, oublié. Il avait bien le droit de vivre aussi pour lui, disions-nous.
LE POTAGE
« – Vous reprendrez bien un peu de potage ? » dit-elle. Et elle lui verse la soupière sur la tête. Il fait une drôle de tête. Elle rit de son rire flûté, sans pouvoir s’arrêter. Enfin, tandis qu’il s’essuie, elle ajoute : « – Heureusement c’était tiède ».
Cela faisait longtemps qu’elle en avait envie. De le voir dégoulinant, les brins d’oseille semés sur son crâne chauve, lui procure du bien-être.
Il ne dit rien. Finalement elle l’aide. « – Pauvre chou, mon pauvre chéri, votre femme n’est vraiment pas sérieuse. » Elle passe une serviette sur le nez, nettoie les paupières. La chemise aussi est trempée. Elle a l’impression de procéder à une toilette mortuaire – heureusement qu’il y a l’odeur de l’oseille, sucrée, un peu amère.
Quand il se lève, elle craint qu’il ne se mette en colère. Aussitôt, elle pense avoir affaire à un scorpion : il suffira de l’écraser de la pointe du soulier. Lui la regarde de ses yeux globuleux, bleus, toujours injectés de veinules. Non, c’est inattendu : il la désire. Alors elle recule jusqu’à la porte, criant que s’il veut de l’eau froide, un seau d’eau glacée, elle est à sa disposition. Il la maintient contre le chambranle (elle sent le bois s’enfoncer entre ses omoplates) et déboutonne son chemisier. Puis, tandis qu’elle s’apprête à cracher, brusquement, il l’écarte et sort en sifflotant Tiens, voilà du boudin.
LES BRUITS DE LA RIVIÈRE
De la prison, on entend les bruits de la rivière, le vent les porte, ils traversent le champ de blé, froissent les coquelicots, butent contre la muraille, escaladent le no man’s land planté de miradors, s’accrochent à l’enceinte intérieure avant d’agripper les barreaux des fenêtres.
Les bruits de la rivière glissent dans les couloirs jaunes et bleus, entrent dans les cellules, frémissent sous les doigts des prisonniers. Les prisonniers crachent dans leurs paumes et les bruits de la rivière restent collés à la peau.
Ils se bouchent les oreilles pour mieux entendre les bruits de la rivière, ils se caressent pour sentir les bruits de la rivière envelopper leur sexe, ils s’endorment dans le berceau de la rivière.
Quand ils rêvent, c’est aux micmacs de la rivière, à ses viols, ses couteaux, son fric, ses juges, ses avocats, ses matons, ses égorgements, ses assistantes sociales, ses doses, ses embrouilles, ses clandestins, ses putes, ses cigarettes, sa réinsertion, ses femmes, son aumônier, ses psychologues, ses rues, ses flics, ses enfants, ses fouilles, ses morts, ses casses, ses rochers, ses tourbillons, ses godasses, ses poissons, son sang, son foutre, son cul, son con.
Assis dans la rivière, ils taillent une pipe, une bavette, une prière, s’enfonçant une seringue dans la vase, envoient une carte postale, s’épongent le slip. Ah, c’était bon comme une baignade – à s’en dorer la peau comme à la télé, à se pendre dans la nuit !
MARIÉE !
La mariée était trop belle, ils l’ont pendue dans l’escalier. C’était le soir du printemps, la mariée rafistolait sa traîne. Les blancs et les noirs en tulle. Ils l’avaient allongée sur le lit grenat. Ils lui avaient sectionné les cuisses et les bras. La mariée était devenue un torse blanc. Ils trouvaient très bien qu’elle ait conservés le ventre et les seins. Ils trouvaient les seins dodus et le ventre adéquat. Avant tout ça, ils avaient traversé l’Achéron. – C’est une brave fille, une brave petite paysanne, disaient-ils. Le genre de femme qu’il nous faut. Ils avaient proposé le mariage, ils fournissaient la robe – arrachée à une morte – Autant que ça serve. Et maintenant la mariée est là, d’un côté, et les voiles, de l’autre. – C’est du tulle, ça ira avec les jarretières. Je n’ai pas encore parlé des jarretières et de leurs jolis rubans en satin rouge. Je n’ai pas non plus évoqué les amours de la mariée, ni son nom que j’ignore, ni du ciel galopant à toute berzingue, brûlant les coucous – le vent gelé. Rude printemps. Je dis ce que j’ai vu. La mariée est transportée dans une étoffe de grossier coton noir que le poids de son corps semble transformer en hamac. On la dépose sur le lit grenat. Les voiles, autour, raides comme des somnambules. On éteint la lumière. Début de soirée. La mariée, les yeux écarquillés, reste muette. Les jarretières. Des tisons. La nuit n’est pas obscure, pas vraiment. Une nuit sans protocole. Une noce bâclée. Beaucoup de prétendants. L’odeur du mariage. Les rubans voltigent. Le printemps ne se fait aucun souci, le printemps dans la boucherie. Pour chaque cérémonie, précise le mode d’emploi, prévoir deux voiles : l’un blanc, l’autre noir. Pas d’explication. La mariée est au courant. Coutume locale. Les chats viennent sentir, mais avec prudence. Prévoir de la musique. Quelque chose de sec et de répétitif. Penser à un paysage. Exotique peut-être. Intemporel, plutôt : quelque chose qui n’entrave pas les ébats, ni les découvertes. La mariée écoute. Les poutres grincent. Une bobine de fil se dévide dans la pénombre. La mariée respire. La mariée écarte les jambes. Surprise : la mariée n’a pas de jambes. Cela ne l’inquiète pas et cela n’intrigue personne.
NUIT ÉCLOSE
Oui, il avait été lâche et paresseux de n’être pas resté pour assister aux derniers moments de la morte. Du reste, c’était toujours comme ça désormais: dès que les ultimes instants se profilaient, la petite boîte se fermait dans sa tête. Il sentait que cela allait arriver, que les chers pas encore disparus risquaient de s’éclipser dans les heures à venir – et c’est lui qui, sans le faire exprès, s’éclipsait : une force invisible le poussait à l’extérieur de la chambre, de la maison, de l’hôpital. Pire : il savait qu’il allait en être ainsi, que ce n’était pas bien, et il le faisait quand même, se bâtissant un alibi auquel il ne croyait pas alors même qu’il l’énonçait – elle ne va pas mourir tout de suite, le coma va durer, elle a encore des forces, etc. – et il fuyait. La petite boite dans sa tête commettait un délit de fuite, de non assistance à personne en danger de mort. Dès qu’elle se refermait, la petite boîte devenait ingouvernable et, en prime, il devait se demander pourquoi il appelait ça une petite boîte ! Un petit cercueil ? Un petit appareil photo ? S’il fermait un cercueil dans sa tête, c’est que la mort était dans sa cervelle, qu’il la vivait, à son insu, dans son crâne – et vlan ! Un alibi de plus ? S’il s’agissait d’un appareil photo qui se refermait, quel cliché refusait-il donc de prendre, sinon celui de sa propre mort, en miroir. Terreur de sa propre mort, trouille intense ou l’impossibilité de revivre la mort de sa mère – là, bien des années avant, presque encore adolescent, il avait vécu l’affaire jusqu’à l’extinction du dernier souffle, trouvant la chose affreusement naturelle, mais il faut bien croire que la mort l’avait saisi ce jour-là, qu’elle s’était lovée dans les circonvolutions du cerveau, édifiant brutalement la petite boite noire, incapable depuis de prendre d’autre photos que de sa propre souffrance, des négatifs de sa peur qu’il faudrait bien développer, en vrac, quand il aborderait à son tour au dernier – rivage ? virage ? il hésitait. Alors, la boîte s’ouvrirait brusquement, vomissant un flot d’images, d’instantanés flous, mal cadrés, surexposés. Pouvait-il seulement espérer que, dans le tas, surgirait une belle photo de famille, où il figurerait aux côtés de tous les morts apaisés ou sévères qu’il avait raté sa vie durant ?
OMBRE
Une femme invisible m’accompagne où que j’aille. Quoique je fasse, elle est là. Ce n’est pas un ange gardien (les anges, faut-il le rappeler, n’ont pas de sexe), ni un écho inversé. Plutôt une ombre glissée à l’intérieur de moi, mais dont je doute qu’elle soit mienne. Nul amour ne nous lie – mais une curiosité réciproque et instable : « – Vous ici ? » On dirait un moineau dans un vaudeville. Elle picore ce qui me tient lieu d’âme, j’effleure son évocation. Nous sommes tranquilles un bon moment. Brusquement, elle se rebiffe : « Je n’existe pas pour toi. » Je dois alors longuement la consoler – exercice acrobatique qui revient à me persuader moi-même que j’existe. Exténuant. Puis elle ronronne, exige des caresses, me contraint d’être sentimental. Nous voici en pleine nature. Je dois la protéger de la froidure de ma vie, car, dit-elle, je lui fais de l’ombre ! Où a-t-elle pris que j’étais l’ombre de l’ombre? J’aimerais nous emmener sur une route écrasée de chaleur afin de savoir qui fait de l’ombre à l’autre, et nous réglerions nos comptes à l’ombre d’un doute. Hélas, l’ombre est une douleur tenace : à l’instant où elle s’apaise, elle irradie le corps entier, le laisse pantelant, stupéfait jusqu’à ce qu’il trouve la posture où il croit lui échapper – alors que l’ombre seulement se repose et le recouvre. Si la douleur que je lui procure est aussi vive que la mienne, il nous faut divorcer – une séparation de corps suffirait peut-être. Or voilà : unis pour le meilleur et pour le pire, depuis notre naissance nous ne formons qu’un seul être, elle, si terriblement femme, moi, si atrocement homme. Cette grandiloquence ne saurait s’achever sans une prière, commune quoique contradictoire : « Notre ombre qui es aux cieux, que ton ombre soit sanctifiée, que ton ombre vienne, que ton ombre soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd’hui notre ombre quotidienne et ne nous soumets pas à l’ombre, mais délivre-nous de l’ombre. Amen ».
RETOUR D’ARGENTINE
Ce livre, je l’ai acheté de retour d’Argentine – non que je sois allé là-bas : elle y est allée pour moi aussi, non à ma place, mais elle a emporté un peu de moi à Buenos Aires, un fragment de mon souvenir, et le souvenir, outre-mer, s’est déshydraté au point qu’il n’en restait pas même de quoi remplir une carte-postale. C’était mieux que rien, pas de quoi se plaindre. Du reste, j’avais fini par oublier qu’elle était partie en Argentine, gommant du coup mon passage à travers sa mémoire légère, dans la pampa et les canaux gelés de Patagonie. Tout s’omet en quelques jours, quelques mois, quelques années, quelques secondes, c’est pareil – nous voici libres comme l’air, gambadant, nous dégotant de nouveaux amis, aussi valables que les précédents mais plus émoustillants, célèbres parfois… Horizons neufs où je ne suis pas allé, amertumes du voyage dont je n’étais pas, vertiges douceâtres de l’abandon, et oubli, fuite définitive pensais-je. Mais soudain elle est là : cet oubli que je croyais sans remède, dû à l’inévitable papillonnement de l’être, fut une vacance fertile ; elle est là, enthousiaste, fine, chaleureuse, et le point de contact qui nous relie m’apparaît beaucoup plus fort qu’il ne l’était avant son séjour argentin, comme si ce point avait été une spirale enfouie dans son cœur, une spirale qui s’était mise à tourbillonner (quand, comment, je ne sais) pour se libérer aujourd’hui, à la table d’un restaurant russe du Quartier latin, à l’image de ces galaxies spirale surgies dans le champ des radiotélescopes, déroulant leurs bras d’étoiles avec une densité d’étoiles insoupçonnable – comment avait-on pu ne pas les déceler auparavant ?… Lorsque nous nous sommes quittés, ma flânerie, légère comme une plume, m’a amené dans une librairie où j’ai acheté pour elle un recueil du poète argentin Roberto Juarroz. A l’aveuglette, j’ai choisi ce livre, Fragments verticaux, pour la beauté du titre et, peut-être, parce que nous sommes, dans nos amours, des murs dressés, inachevés, où nos songes, l’image et le souvenir que nous portons les uns des autres, se renvoient la balle, un drôle de jeu de paume, et parfois la balle ricoche et revient dans nos mains, et parfois elle passe entre les fragments des sensations, entre les bras de la galaxie, pour venir se pelotonner en Argentine, pulsar dans la plaine glacée des sentiments inassouvis.
SI L’ÉTÉ ÉTAIT VENU
Ah, si l’été était venu, comme elle serait partie au bout du monde, loin des gredins. Elle aurait laissé le métro s’échapper dans le tunnel pour toujours. Ses pieds barboteraient dans l’eau douce et salée du Golfe du Lion, ou du Golfe du Mexique, et une flopée d’hommes vigoureux de dix-huit à trente ans tomberait à ses genoux. Elle n’aurait qu’un mot à dire pour qu’ils bougent le parasol ou aillent lui chercher un sorbet à la myrtille. Le soir, et parfois même dans l’après-midi, à l’heure où le soleil est au plus chaud, d’un index nonchalant, elle désignerait l’un de ces jeunes gens adorables pour qu’il l’accompagne au Grand Hôtel, et leurs étreintes seraient suaves et torrides, violentes et raffinées, puis gentiment, mais fermement, elle le pousserait dans le couloir, pour clore encore un peu les yeux, seule. Elle insistait beaucoup pour garder cette solitude où s’affirmait sa souveraineté. Elle se voyait en papillon butinant maintes fleurs somptueuses puis s’envolant dans la lumière d’août ; ou en colibri. C’était cela : « Je suis colibri et je débusque la rosée au cœur des orchidées ; je suis presque invisible – n’était le battement insensé de mes ailes dans le miroitement des feuilles. » Elle poserait la main sur son cœur, l’écouterait battre la chamade comme au plus fort d’une danse dans l’immense salle de bal, une valse bien sûr, résonnant sous les dorures du plafond stuqué où s’ébattent des angelots joufflus et des nudités grassouillettes. La tête renversée, les yeux humides, elle sentirait la main du cavalier serrer davantage sa taille, l’emportement du tourbillon la jetterait au creux des vagues, dans l’écume sautillante. Elle serait un poisson voluptueux qu’un pêcheur bien membré ramènerait dans son filet pour la manger crue, encore frétillante, puis elle, brusquement, se redresserait, poserait un pied sur la gorge du marin et plongerait dans la vague, ou la nue, ou une de ces robes duveteuses qui sont à la fois l’onde et la brise sur la peau. Jamais elle ne se serait sentie si jolie et si légère, si proche du paradis – si elle –, mais l’été n’était pas venu, ou pas encore, mais il viendrait demain. Il viendrait. Et si le cœur pinçait, au point qu’elle prenait la poudre d’escampette dans les rues froides de Noël, c’était juste histoire d’annoncer la saveur de l’été à venir, comme l’on déguste l’amertume sableuse d’une truffe en chocolat, ou une tartelette au citron de chez Angelina, ou un cigarillo dont les volutes chatouillent les narines – il s’agissait de se glisser dans la ferveur du monde, de retenir l’inévitable miroitement de l’être, de farder l’hiver et tout recommencerait lorsque l’été viendrait.
TREMBLEMENT DE TERRE
La maison se met à bouger, tel un corps que l’on tente de basculer sur sa couche et qui se débat dans l’inertie. Le corps est plongé dans le coma, sa chaleur est préservée, il oppose à ses manipulateurs élasticité et masse – deux qualités permettant aussi à la maison de résister au flux et au reflux et d’osciller sans effondrement. A l’intérieur de la maison (un parallélépipède blanc coiffé d’une toiture à l’identique), les corps de deux amants tanguent a contrario des mouvements de la maison, opposant d’abord au tellurisme leur propre logique : les amants, enfoncés dans leurs mouvements, n’ont perçu qu’un vertige de plus et se l’approprient. Il faut quatre à cinq secondes pour qu’ils émergent, doutent, et se prennent à lutter contre les ondes engendrées par les secousses sismiques : ce mouvement neuf a-t-il été produit par la nouveauté de leur amour, la découverte des combinaisons de leurs énergies ? Ils quittent leur couche et, dehors, sur la grève voient la maison, sa souplesse de roseau, et leurs jambes se dérober. Ils ne peuvent plus rien. S’ils se précipitent dans les bras l’un de l’autre, l’écorce terrestre, au forceps, les écarte. Alors, chacun de son côté, ils regardent la maison sous la houle, animée d’un bercement plus violent, plus constant que ne l’avait été celui de leurs chairs, pencher, tendre vers un sol menaçant de la disloquer, balancier dont le tourment s’apaise enfin. Ils échangent un coup d’œil et rejoignent la chambre. La lampe de chevet gît sur le plancher. Pas même brisée, elle éclaire d’un jet les lames blondes. Il n’y a pas d’autre dégât apparent.
UN PORTRAIT
Voulait-elle son portrait, qu’il écrive son portrait ? Elle avait convoqué l’écrivain chez elle, l’avait invité au restaurant – à la bonne franquette, sans dessert mais avec cuvée honorable, en carafe. Elle parlait d’elle, s’agitait comme si le monde entier devait entendre ce qu’elle confiait (au point qu’on se taisait parfois aux tables voisines, sans qu’elle parût s’en soucier, à moins qu’elle estimât que le fracas des voitures longeant la terrasse ait pu lui servir de paravent, alors qu’il la contraignait, sans qu’elle s’en rendît compte, à hausser la voix). Elle proclamait donc son androgynie et son goût à relire, au premier chagrin, Albertine disparue, et son enfance dans un rez-de-chaussée, un ancien café où l’enfilade des pièces semblait un couloir rouge, interminable, débouchant sur une ville de province infiniment médiocre. A cause de ce couloir, de la banalité stendhalienne des mœurs provinciales, de cette jeunesse de catacombes, l’écrivain avait repris espoir : assurément, il y avait là de quoi tailler, ciseler, faire acte de sculpteur – d’autant qu’évoquant la suite de sa vie, elle disait d’assez jolies choses sur les trains, les papillons, les milliardaires et la désinvolture (ne parlait-elle pas du suicide comme d’une forme suprême de légèreté vis à vis de soi ?) et l’art conceptuel. Au fond, en dépit du cadre peu propice de l’entretien, il gardait l’espoir de pouvoir extraire de cette logorrhée suffisamment de mensonges et d’approximations pour esquisser un appât : il fallait bien se nourrir après tout, le modèle était assez célèbre pour garantir une édition. Les interrogations qu’elle apporta à la fin du repas auraient dû mettre la puce à l’oreille de l’écrivain : le quittant, elle s’inquiétait – oh, fugitivement ! – de s’être montrée trop narcissique. Lui, l’assurait du contraire, et qu’il fallait se revoir, creuser davantage, tandis qu’elle le flattait d’avoir su lui faire avouer, en si peu de temps, de l’inavouable.
Leur seconde entrevue se déroula non pas dans le salon du Grand Hôtel où elle avait convié l’écrivain (ce qu’il caressait, songeant aux fantômes littéraires qui avaient cultivé et cultivaient encore ces lieux rococos) mais dans le restaurant attenant, très laid, garni de tableautins abstraits et de rares convives. Bien qu’elle usât du maître d’hôtel comme d’une vieille connaissance, elle proposa un repas aussi fragile que le précédent, servi par un novice à peine aimable. Elle semblait perturbée – peut-être parce qu’elle venait de subir, expliquait-elle, un massage effectué par un thérapeute tibétain pratiquant l’anglais et de faibles honoraires, malaxation qui secouait la moelle épinière, et qu’elle recommandait à l’écrivain. Lui cherchait à savoir comment il pourrait utiliser les gerbes de confidences qu’elle lui octroyait ou son désir de faire habiller par un grand couturier tous les gens qu’elle avait aidé, de leur écrire un hymne puis de les faire défiler, sous ses ordres, en rang par deux sur les Champs-Elysées. La vie, disait-elle, est un jokari : la balle vous revient en pleine poire. Elle affirmait, de surcroît, jouer avec plusieurs balles, et que les personnages importants qu’elle côtoyait, hommes politiques, chefs d’entreprises, tous se gavaient de Prozac. Les détails qu’elle rajoutait étaient un miel pour l’écrivain. Il en oubliait la cuisson incertaine de la tranche de saumon dans son assiette. Le modèle, avec ses gaudrioles, ses sauts de puce dans les sphères dirigeantes, se révélait, décidément, une mine à exploiter d’urgence, avant que le flot de l’actualité n’use le filon, bousculant les interprètes dans l’oubli ou la mort.
Leur troisième et dernière rencontre – semblait-il à l’écrivain – évita les restaurants. Le modèle reçut à domicile. Ce qui était de bon augure se révéla désastreux : d’attaque, tandis qu’on lui servait un verre d’eau froide, il souhaita donner un exemple de ce qu’il pourrait développer si le modèle consentait à poursuivre leur collaboration. Il lut un texte, bref, où le couloir rouge, la sous-préfecture natale, la versatilité et les relations du modèle se combinaient, offrant, jugeait-il, les ingrédients d’une esquisse alléchante, fine, fidèle au fond aux propos entendus, rehaussée ça et là de silences, de crispations d’humeur où il avait trouvé un bonheur de plume, la sensation de son indépendance. Ce qu’il avait souhaité – la participation du modèle à son portrait, un jeu de séduction réciproque, avec, au terme, un livre où chacun trouverait ses billes – était en germe dans ces trois pages. Tous deux, l’écrivain et son modèle, allaient vivre quelques mois sur un fil, garder leurs distances pour mieux se rejoindre, inaugurer, qui sait, un nouveau genre littéraire qui aurait beaucoup à voir avec la peinture. Pourquoi même (il s’exaltait à cette idée), n’interviendrait-elle pas, séance après séance, réagissant à l’écoute de l’épisode précédent, ce dont il tirerait profit pour épurer, ciseler, exploitant à l’infini presque les facettes du modèle, s’aventurant si loin dans le prisme que le jeu des miroirs finirait par lui renvoyer son propre visage – le portrait serait aussi un autoportrait dont le modèle pourrait, avec l’écrivain, revendiquer la signature.
– « Non, dit-elle, cela ne me convient pas ».
L’écriture, à entendre les trois pages, lui plaisait, elle appréciait le style, la précision, envisageait volontiers la poursuite de l’expérience – seulement elle craignait de se décevoir elle-même par un exercice trop narcissique. Puis, une chose était de dire, l’autre d’écrire. Lui avait-elle vraiment confié tout ça ? A parler franchement, la femme publique qu’elle était – l’écrivain avait pressenti qu’elle serait ministre, ce qu’elle ne refuserait pas si les circonstances l’y poussaient, non la politique – risquait d’être gênée par la femme privée qui s’était laissée aller à tant d’aveux en si peu de temps – au point qu’elle se demandait sérieusement, reconduisant l’écrivain dans la cour de son hôtel particulier, si elle ne devrait pas, à son âge, envisager une analyse. Du reste, demandait-elle, l’écrivain n’était-il pas psychanalyste ? Non. Elle l’aurait pourtant bien revu tant il avait une écoute exceptionnelle, tant elle avait été, à chaque fois, charmée de leur rendez-vous – et elle avait insisté pour garder les trois pages, l’avait embrassé alors qu’il avait déjà un pied dans la rue.
UNE AUTRE DISPARITION
J’ai toujours cru que les femmes ne mouraient pas. J’ai vu des noms féminins gravés sur des tombes, lu des rubriques nécrologiques. J’ai observé des mortes – ces poupées n’ont rien à faire avec les femmes qui peuplent les bureaux et les autocars, se dandinent, s’esclaffent, se jettent au cou des types ou me téléphonent. Ni la jeune ni la vieille ne meurent, ni la musicienne, ni la vendeuse, ni la malade. D’avoir assisté à l’agonie de ma mère n’a rien changé à mon intime conviction : aucune femme n’était capable de mourir. Cadavres, elles ne sont plus femmes mais viande ou ectoplasme – cette hésitation entre viscères et abstraction me turlupine, comme si je sentais là une des clés de ma sensation. Mais, en dépit de mes efforts d’imagination, les femmes ne trépassent jamais. Je m’étais donc accoutumé à ce que je nommais une évidence par l’absurde quand Olga et moi eûmes des rapports sexuels. Je connais Olga depuis longtemps et l’idée que nous pourrions coucher ensemble ne m’avait guère effleuré, pas plus qu’elle je crois. Un coup de chaleur nous fit basculer. Ce qui n’aurait dû n’être qu’un lapsus, fruit peut-être d’une curiosité jusque là occultée, se révéla pour moi un vertige. A quel moment, après ce qu’il est convenu d’appeler la jouissance, ai-je eu la certitude d’une dérive incontrôlable – qu’Olga me pressant en douceur m’expédiait non au septième ciel mais dans un univers sidérant où je me perdais ? A quel moment ai-je été sûr de toucher une mort qui n’avait rien à voir avec la petite mort mais avec une morte qui me gardait tendrement en elle, chaude, odorante, agile comme un cerf dans la forêt, sans que je puisse rien dire ni faire – sinon toucher ce paradoxe : Olga, vivante, m’entraînant dans sa mort, m’apprenait que les femmes mouraient enfin en moi.
UNE CIGARETTE
Il y a des journalistes et des femmes. De son propre aveu le prisonnier n’a pas vu autant de monde depuis longtemps – et il s’étonne d’être si à l’aise, de répondre aux questions, de glisser d’un groupe à l’autre avec l’à-propos d’un maître des lieux, recevant les remerciements et les félicitations qui lui sont dus avec 1’émousti1lement d’un peintre à son vernissage. On l’a autorisé à venir dans le gymnase de la maison d’arrêt où sont exposés les textes qu’il a écrit – lui et une trentaine d’autres détenus : des poèmes apportant la preuve que la pénitentiaire pratique la réinsertion à bonne dose. Mieux, les portraits, des photos de chacun de ces prisonniers, jouxtent les écrits qu’une soixantaine de visiteurs lisent avec l’attention requise. La bonne conduite qui a autorisé la présence du prisonnier trouve son apogée dans le gymnase dont le sol serait immaculé sans les brindilles tombant de la verrière : des moineaux s’y agitent dans un nid. Des fétus, une pincée de poussière tachent donc le sol. Une prison doit avoir la clarté d’un couloir de clinique. Deux minutes suffisent au prisonnier, nanti d’un balai et d’une pelle pour effacer les souillures. Comme il passe entre les groupes avec l’aisance d’un majordome proposant des petits fours ! Comme il officie, les yeux baissés, avec la modestie d’un poète ! En un rien de temps, vraiment, le gymnase est à nouveau digne de la prison et des invités qui ont eu le tact de ne pas s’étonner, se retournant, hochant la tête après son passage seulement, échangeant des propos furtifs sur cette incongruité, ignorant qu’un détenu, tout exposé qu’il soit, est toujours un détenu – comme le souligne d’un sourire le surveillant-chef, récupérant dans une salle voisine pelle et balai : n’avait-il pas promis une cigarette au prisonnier s’il ramassait, sans faire d’histoire, les poussières de moineau. Comment le prisonnier aurait-il pu refuser un ordre assorti d’une telle récompense pour une vulgaire question d’amour-propre ?
UNE NUIT AVEC LA PANTHÈRE
Quand elle m’a attrapé le crâne, je ne me suis pas rendu compte tout de suite de quoi il s’agissait. Il faut dire qu’il faisait nuit, les lampadaires éclairaient imparfaitement le parc : des buissons où j’étais, on distinguait seulement des halos ; ailleurs, une pellicule grise et pâle recouvrait les pentes, comme un film de brume collé au sol, aplanissant les reliefs. L’œil s’attardait à deviner ce qui pouvait bien se passer dans le parc – cet effort de concentration explique que je n’ai pas senti venir l’haleine et les crocs qui, maintenant, m’enserraient. Pour la panthère, il s’agissait d’un jeu, sans doute habituel : tenir entre ses mâchoires une proie, la serrer sans la broyer, mais faire comprendre à la proie que le moindre mouvement lui serait fatal, qu’il déclencherait un réflexe – les crocs broieraient mes os. Pourtant j’étendis la main, touchai le flanc de l’animal : son pelage était poisseux de sang. La panthère était blessée, elle souffrait, voulait partager cette souffrance avec moi, le frémissement qui courait sur mes doigts en était la preuve. Echappée d’un cirque ou d’un zoo, traquée, elle s’était réfugiée autour du premier bonhomme venu. Il naît des évidences quand on est en danger de mort ; à mesure que sa gueule s’habituait à la mienne, la panthère devenait ma complice. Mes doigts essuyaient son sang, caressaient sa fourrure ; elle-même contractait puis relâchait avec une infinie subtilité, une infinie douceur, ses babines sur ma tête – pour la première fois de ma vie je ressentais l’élasticité des os de ma boîte crânienne. J’avais la sensation qu’au delà de sa gueule, son corps – noir, à cause de la nuit, de ma cécité provisoire, à moins que son poil fût vraiment noir ? – se lovait en fourreau autour de mon corps tout entier, avant de m’expulser dans la nature, le parc où l’aube se levait enfin, où la panthère blessée et moi pourrions marcher, elle acceptant la laisse et le collier, moi de la tenir ainsi, pour que, de concert, nous regagnions la vie civilisée.
UNE SOIRÉE AVEC VIRGINIA WOOLF
Lorsque Maman et moi sommes entrés, le stade était déjà comble – de grandes masses noires collaient aux gradins, tandis qu’un chœur féminin entonnait une polyphonie, un de ces canons qui font froid dans le dos, très incongru ici et à cette heure nocturne, à Issoire et en ces tristes années d’Occupation. A vrai dire, on cherchait Papa, l’étranger qui avait fui de l’autre côté de la ligne de démarcation. J’avais déjà un peu fureté en ville, mais hormis des dames patronnesses, un pauvre bordel et des hommes chapeautés, plutôt louches, il n’y avait pas grand chose à flairer dans l’agglomération, sauf la noirceur ci-devant évoquée, présente dans les couvre-chef, les murs, les bas, les nuages, les complet-vestons et la pluie léchant les murs. Papa était-il au stade, perdu dans la foule, lui qui aimait tant l’athlétisme? Peut-être s’agissait-il seulement pour Maman de répondre à l’invitation des notables qui lui tournaient autour. Notamment le Commissaire. Cela expliquerait sa nervosité : à peine avais-je marqué de l’étonnement – ces chants, pardi ! -, demandant bêtement : « Qu’est-ce que c’est que ça ? », elle m’avait tiré par la main: « C’est un concert, voyons ». La question, du reste, n’était pas là, mais dans ce que nous cherchions vraiment : plus les secondes passaient, moins j’étais sûr que nous enquêtions sur la même personne ; mais j’étais petit et captif de ses beaux doigts, même si, les jours d’avant, des escapades m’avaient révélé bien des choses sur la vie de Maman à Issoire, sur les drôles de cocos qu’elle y fréquentait, qui s’étaient montrés beaucoup trop gentils avec moi : j’avais bien senti leur commisération, ils n’avaient pas la pitié brillante – enfin, cela m’avait permis de me coller dans certaines jupes et de me faire peloter les cuisses.
En définitive, ce concert c’était bien, le Maréchal était sans doute déjà là, dans les poitrines sinon dans les tribunes. D’ici – l’entrée, derrière la falaise des gradins -, on voyait surtout l’océan noir des spectateurs et la réverbération de la lumière sur les pelouses. Nous guettions une place. Maman hésitait, nous piétinions, quand je découvris la tribune nord : incroyable, elle était aux trois quarts vide ! La foule, massée en bas, libérait un vaste U, un concentré de lumière blanche, et là-haut, au sommet du trône éblouissant, Virginia Woolf se tenait assise, adossée au mur d’enceinte. Virginia Woolf était très maquillée, contrairement à ses habitudes ; elle avait les joues légèrement affaissées, mais c’était bien elle, très droite comme à l’accoutumée, l’air d’avoir avalé sa canne avec grande élégance. J’en croyais à peine mes yeux et j’ai aussitôt signalé l’événement à Maman : » – Tu as vu ? C’est Virginia Woolf, mais elle a du rouge aux pommettes et du bleu sur les paupières”. » – Oui, elle n’a pas son air éthéré, ce n’est pas plus mal ». J’avais eu très peur que Maman me réponde que je me moquais du monde, que Virginia Woolf, dans le stade d’Issoire, et même en nocturne, ce n’était pas vraiment sérieux. Pas du tout, elle m’a encouragé : » – Va t’asseoir près de Virginia, moi je me débrouillerai ». En fait, elle avait repéré le Commissaire, juste devant, et ses genoux battaient déjà la chamade, en mesure avec ceux du Commissaire – mais lui, c’était un tic, à croire qu’il avait tout le temps envie de faire pipi.
Maman m’a lâché la main et j’ai escaladé les gradins sous les projecteurs. Enfin, je, me suis arrêté à la lisière de l’ombre et de la lumière, à distance respectueuse du grand écrivain. Je voyais ses chaussures, et, au dessus, la tête et les joues fardées, leur chair un peu molle. J’ai commencé à lui parler tout bas. Je me disais : « si c’est bien Virginia Woolf, ça va marcher”. Aussitôt, elle m’a répondu. Vu le brouhaha, la polyphonie et la distance qui nous séparait, il fallait vraiment être Virginia Woolf pour que ça marche. Ensuite, nous avons longuement évoqué Papa : souvent, elle le croisait dans la rivière anglaise où elle s’était noyée. Parfois, si je l’en croyais, ils coulaient ensemble pour ramasser des cailloux dans la vase. Le soleil tapait au fond de l’eau et c’était plutôt joyeux. Virginia Woolf était gentille de me souffler ces fredaines, et je faisais mine d’être dupe. Pauvre Papa, pauvre Virginia, tout ça c’était du cinéma : je sentais bien qu’ils étaient morts, et les quémandages de Maman auprès du Commissaire étaient vains – n’empêche, c’était rudement chic à Virginia de s’être dérangée, d’être obligée d’écouter le discours du Maréchal et la polyphonie, à Issoire, en pleine nuit, pour essayer de me consoler. Et puis, elle avait été obligée de se maquiller, ce qui l’enlaidissait : elle ressemblait presque à Simone de Beauvoir. J’aurais dû prendre garde à ce que je pensais : Virginia Woolf n’a pas apprécié ma comparaison. Elle a sorti un mouchoir en dentelle blanche, a essuyé le fard et le khôl. Ainsi, elle était livide. Elle s’est levée, a disparu avant que j’aie eu le temps de faire ouf. Comme dit Maman, j’avais encore gaffé avec les femmes. Virginia était partie rejoindre Papa. Lui au moins, était en bonne compagnie. Elle devait lui lire des extraits des Vagues, peut-être même des inédits. Ou La Promenade au Phare – je dis cela à cause de la lumière violente du stade, qui me tapait dans l’œil.
A QUOI ALLONS-NOUS JOUER AUJOURD’HUI ?
A quoi allons-nous jouer aujourd’hui, se demandaient les enfants pâles vêtus de noir ? A touche-papa disait l’un, à tue-maman disait l’autre. Ils étaient dans la lumière d’automne égale et blonde, assis dans la grande pièce nue. Ils se penchaient par la fenêtre : les arbres noirs perdaient leurs feuilles. Vite, ils revenaient au centre de la chambre à coucher. Le premier gamin était grand et costaud, le second mince et pas trop grand. L’air de famille habitait surtout leurs vestes longues et râpées, et, malgré leur jeune âge, ils possédaient beaucoup de souvenirs en commun – celui qui revenait le plus souvent les tourmenter c’était d’attendre les parents. Les parents allaient au cinéma, et eux, les enfants, en raison de leur extrême jeunesse, demeuraient dans la chambre à coucher. On avait bien essayé de leur trouver une baby-sister comme ils disaient, mais ça n’avait jamais marché. Ils restaient donc entre garçons : ainsi aujourd’hui, mercredi 13 octobre, et ce ne serait pas le dernier jour.
De temps à autre, un arbre s’abattait dans le jardin, sans qu’il y eût la moindre tempête et cela constituait déjà une excellente occupation. Eux-mêmes doutaient de l’existence du jardin : peut-être y avait-il seulement l’océan – on entendait très distinctement les vagues envahir la chambre – ou simplement le ciel sans rien d’autre que le ciel. La maison n’avait aucune racines, ni rien autour : il était donc logique que les arbres tombent, fracassant parfois les baies vitrées pour venir atterrir dans la pièce avec un épouvantable bruit de chair et d’os.
« Je me souviens », disait le plus petit des gamins – et l’autre aussitôt disposait sur le plancher les chaussures noires des parents. Celles du père étaient plus grandes, forcément, mais celles de la mère n’étaient pas mal non plus, avec leurs talons aiguille. « Je me souviens », disaient-ils encore, de concert cette fois, et, aussitôt ils lançaient les chaussures. Elles ricochaient sur les murs, retombaient au sol, ils s’en emparaient à nouveau et les relançaient plus loin, plus fort, en criant qu’ils se souvenaient. A peine avaient-ils le temps de sentir sous leurs doigts la beauté des cuirs, déjà les chaussures bondissaient et chutaient avec un bruit de verre brisé ou de clapotis. Etait-ce cela le bruit du souvenir ? En ce cas c’était bien fatigant. Ils s’essoufflaient, s’accoudaient à la fenêtre, ou cherchaient la porte – mais il n’y avait aucune porte : une fois qu’on était dans la chambre, elle se refermait pour toujours. On pouvait renifler dans les coins : pas de porte, pas de trappe, seulement les fenêtres à guillotine, avec de l’autre côté le danger et l’incertitude, la chute des feuilles, des troncs, les vagues, le ciel nu avec cette brutalité des changements de couleur : impossible de savoir l’heure ou la saison, fût-ce à un mois près, et s’il se mettait à pleuvoir, à tonner, cela n’avait pas d’autre sens que le crépitement sur les ardoises ou l’éclair jaune et bleu, et si la neige ensevelissait l’horizon, la blancheur ne rimait à rien d’autre que sa présence – les éléments se déchaînaient avec une grande innocence et dans le plus parfait désordre. Dans ces conditions, s’accouder à la fenêtre faisait parti du superflu – alors le plus grand des enfants s’allongeait sur le parquet, et l’autre venait sur lui, et ils restaient si longtemps immobiles que leurs vêtements se confondaient jusqu’à ne plus former qu’une masse noire d’où surgissaient quatre pieds blancs tandis que la lumière déclinait dans là chambre, dessinant à la fin un ver luisant au plafond jusqu’à ce que les parents rentrent du cinéma.
AU BORD DU CANAL

Une flopée de barques bleues, parallèles oscillantes amarrées au ponton du grand canal de Versailles, comme des touches de pinceau sur l’eau grise, moins grise que le ciel – barques presque immobiles et vides, flottille attendant d’embarquer les âmes des touristes, mais ils ne le savent pas, dégustent des crêpes et prennent des photos, ignorant que ce sera peut-être leur dernier cliché avant qu’ils ne voguent sur l’immensité plate de l’onde, taches encore agitées par les soubresauts de leurs chemises et de leurs robes, tant ils rament vers l’autre bord, falaise verte d’arbres taillés au cordeau qui, à l’instant inattendu, refermeront leurs branches sur eux.
Une jeune femme, cheveux éployés sur son dos très droit, assise sur le rebord du bassin, écoute le clapotis de l’eau. On dirait un tableau de Friedrich, un de ces personnages perchés, en contemplation au-dessus d’un ravin ou d’un océan. Ici, l’abîme est à fleur d’eau, elle le frôle du pied, pourrait y glisser et l’envie me prend de lui saisir la main et de lui dire : « On y va », en même temps qu’un vertige, aussi puissant que si j’étais au sommet d’un pic, me contraint de reculer tandis qu’elle évoque Venise hivernale sous la brume et l’humidité, puis montre ses dessins, si fragiles sur le papier pelure que le courant d’air les dispute aux doigts, qu’il faut lutter pour les feuilleter, pour feuilleter la vie si légère que le moindre frisson de vent l’arrime ou l’arrache.
AUSSI LOIN QUE POSSIBLE
Aussi loin que possible, je l’ai suivie – jusqu’à cette marche nocturne dans un Paris défoncé par la bruine et les souvenirs. Le destin nous a fait rencontrer l’Oncle Nie du côté de la rue Saint-Lazare. L’Oncle Nie était furieux : il avait été chargé de me décorer, et si le rendez-vous initialement prévu avait échoué c’est que j’en ignorais tout bonnement l’existence. L’Oncle n’en croyait rien et j’avais dû, sur les mânes de mes parents, jurer de ma sincérité pour obtenir le Mérite qui me revenait, avec grade d’officier s’il vous plaît – le tout expédié au coin de Notre-Dame de Lorette, alors que la cérémonie aurait dû se dérouler dans un de ces restaurants dont les rideaux bonne-femme annoncent des plats en sauce goûteux et indigestes. Encore heureux d’être tombé sur l’Oncle Nie par hasard – si tant est qu’Olga n’ait provoqué ce hasard pour que je reçoive quand même le Mérite, mais au débotté, en porte-à-faux. C’est cela : elle a mijoté une nuit entière de porte-à-faux pour que je me sente mal à l’aise jusqu’au bout. Maintenant que nous avons laissé l’Oncle Nie, elle m’entraîne dans une chambre d’hôtel et se déshabille avec infiniment de regrets (comment interpréter autrement le soin pris à plier ses vêtements et la pose au centre du lit d’une serviette éponge, afin de n’en point salir la cretonne immaculée ?). Pourtant, elle se déshabille et sa poitrine offerte, son regard même, annoncent des plaisirs que j’attends depuis des mois. Mais, au moment précis où elle va s’allonger, son joli corps blanc opère une révolution à trois-cent-soixante degrés : la robe et le reste s’envolent dans l’escalier. Olga reprend sa course folle dans la ville, et moi, langue pendante et cœur en vrille, je lui file au train. J’allais lui dire que je l’aimais, peut-être même lui ai-je dit au bord du sommier, avec cette précipitation je ne suis plus sûr de rien. En courant comme ça, en tout cas je ne pourrai plus prononcer un seul mot. Soudain, à Barbès, sous le métro aérien, elle ralentit, s’arrête, me laissant la rejoindre, et ses yeux, comme tout à l’heure au pied du lit, annoncent qu’elle me veut, me désire de toute son âme, de tout son corps odorant et léger. Je m’apprête à la serrer entre mes bras, elle tend les lèvres, et son regard, que ne ferais-je pas pour son regard… mais le premier métro fait trembler les poutrelles d’acier au-dessus de nos têtes presque rejointes – et voici qu’elle s’éclipse, escaladant les marches de la station. Olga disparaît à l’angle d’un palier. Je la rattraperai vite, au moins je la verrai à nouveau dans trois ou quatre secondes, l’important est de ne pas la perdre de vue. Une rame démarre, et moi, inexplicablement sur le quai d’en face, je l’aperçois dans un wagon. Elle me salue d’un signe encourageant de la main, mais ses yeux fuient une déclaration d’amour que j’arriverai à lui prodiguer une autre fois – encore cette nuit n’a-t-elle pas été tout à fait perdue : non seulement nos relations ont imperceptiblement évolué, non seulement le malaise régnant a dû nous rapprocher (sa fuite éperdue en apporte la preuve), mais j’ai, grâce à elle et fût-ce en porte-à-faux, été décoré du Mérite, avec grade d’officier, ce qui est loin d’être négligeable.
CENTAURE
Sans torts, devrais-je écrire, ou, à tort et à travers, sang tors, sans Thor et cent torts. Pourtant je n’ai pas tort, moi qui ne fait de tort à personne, ni ne tord le kiki de personne, d’imaginer la rencontre fratricide entre Nessus et le dieu au marteau et le fragment de cheval, l’un frappant l’autre hennissant, crachant des injures grecques que le Scandinave ni son bouc ne savaient. Quelles ruades, quels fracas de ferraille sur l’encolure, quels galops où le bouc tirait à dia tandis que, tête et panne cognaient à hue. Les rocs célestes en étaient estourbis – qui du tonnerre nordique, des éclairs de sabots frappaient le plus dru ? L’averse tombait des nues sur le torse où la sueur coulait à la robe chevaline, poissant la poussière du corral guerrier – et le thorax de Thor, zébré de crachats, semblait une cuirasse de bave, et l’écume grimpait aux lèvres néssiennes, et le bouc fonçait comme un tank, et le marteau dardait son œil sur l’œil du Centaure. Et pan ! Et pan ! Non pas Pan, quoiqu’il y eût poils, panique et boucan dans cette joute, mais détonations, fumées de terre, pets, etc., qui, réveillant le berger, lui firent entendre la vérité : le taureau enfilait la vache si vertement qu’elle rageait dans l’enclos.
CES PETITS MORTS
Les petits riens dont s’accable notre mémoire frappent vingt-quatre heures sur vingt-quatre. On boit un verre, on pousse une porte, on regarde la fumée s’épandre à l’horizon et les petits morts en profitent pour vous taper dans un œil qui, désormais, contient les larmes et la source des larmes. Puis, le sel des pleurs dépose sa légère croûte sur les pommettes – le souvenir des morts dessèche un épiderme déjà maltraité par les intempéries, l’eau calcaire et les baisers râpeux. Dieu soit loué, les crèmes hydratantes ont vite raison de ces dépôts mortuaires. Un bref massage en remontant vers les tempes et on passe à autre chose. Hélas, à force de temps et d’obstination, l’incessant va-et-vient des petits morts creuse des rides – sillons, failles, vallées où ils s’allongent, se démènent, forniquent, bâfrent. Cette agitation (source par ailleurs de picotis, tavelures, boutons de fièvre, en attendant pire) apporte au moins une preuve : les petits riens nous sucent jusqu’à l’os. A force de s’essuyer les larmes à la moindre nostalgie, le regard rougit – une braise à l’instant de s’éteindre. Un dernier clignotement dans le noir, on est soi-même un petit rien enfin amnésique, le sel de la terre pour des survivants dont la mémoire enchevêtrée vient frotter les paupières. Engloutis par leurs glandes lacrymales au détour d’un chemin, cet homme, cette femme-là, proies de tant de petits riens, ignorent qu’ils sont déjà morts.
CRAMOISIES
Les cramoisies sont une faveur du septentrion. On voit surgir ces fleurs de gel entre deux frémissements solaires. Leur croissance, aussi fugitive que leur déclin, est presque insaisissable. Le mieux est de se laisser surprendre à la faveur d’une marche ordinaire – une de ces marches accomplies un mardi, pour l’hygiène, et qui s’accompagnent d’un regard somnolent sur la campagne. L’on vaque et soudain le chiffon se transforme en marionnette. La cramoisie surgit du fond de la rétine comme chevelure d’Irlandaise assassinée par le crépuscule, ou paume s’ouvrant pour recevoir un baiser rouge de kermès – graines d’écarlates, non point cochenilles élevées sur le chêne nain (quercus coccifera) ; non point la poudre des chartreux, sulfure d’antimoine mêlée de pyroantimoniate de sodium pour faire cracher et vomir, encore que cette violence réflexe traduise la stupéfaction de l’œil croisant une levée de cramoisies tandis que l’atmosphère vibre de jappements (salauds de chiens de chasse) avant de faire silence pendant l’éclosion, la défloraison, le recroquevi1lement et la mort du végétal.
DE L’AUTRE MONDE
Je t’écris de l’autre monde – ici-bas comme on dit où le vent continue à beugler, où les insectes butinent les lavandes, où le linge se tord sous la tempête. Toi qui n’as plus faim ni soif, je ne peux m’empêcher de penser que tu as faim et soif, d’une pensée s’infiltrant entre les cailloux, jusqu’à ton gisant lentement dépouillé. Ta main, ta tête, ton sang, ta vie tournent dans la solitude des astres et je ne sais si tu es plus seul ou moins seul qu’avant, ou si la matière éparse caresse l’argent de tes cheveux, tandis que tu lui adresses l’ironie d’un sourire.
Jamais, presque, je ne rêve de toi, et c’est un grand mystère – mais je prends le café à tes côtés, et je t’offre un bouquet d’anémones, violentes et tranquilles.
Rien, ici-bas, ne se passe de mémorable, hors cette chose a la terrible douceur: ton absence présente et ta présence absente, sensation qui est peut-être d’éternité, et qu’il me faut accueillir, m’effaçant en toi. Ainsi, je le crois, je le crois aujourd’hui, en sera-t-il jusqu’à ma disparition de la terre des passions.
ET NOS AMIS DE L’AU-DELÀ
Et nos amis de l’au-delà, ceux que nous ne voyons plus, qui ne nous attendent plus, ceux que le souvenir oublie, et les fenêtres ouvertes dans le sommeil, mon Cœur, quand nous somnolons si peu qu’un frisson de peau éveille le vent tendre et furieux, doux et furieux, le vent de nos baisers – et nos amis de l’au-delà ?
Sont-ils entre nos cuisses, nuages que nous broyons. Sont-ils nos lèvres d’enfants vifs ? Sont-ils meurtris, assassins peut-être qui nous aveuglent ? Tant aimer, voir plus loin, tordre terre et mots, et l’oscillation, sans défaite ni victoire, voir plus loin. Mon cœur glisse vers l’Achéron. Le tien, mon Cœur ? Sans peur ni reproche.
Un lit de feuilles de chêne, la brume, aux lèvres du soleil le ventre, l’argile, la peau greffée de rides (tant de douleur, de rires), enfin repos ? Non. Fracas, escalader la muraille de Chine, nourrir le songe avant qu’il nous dévore – ô l’insolente rumeur : quand on entre au paradis, est-ce pour l’éternité ?
(14 octobre 1997)
DE LA TÊTE AU CIEL
De la tête au ciel, assise. Nuages : jonchés d’étoiles et de retour de flammes – puis la croupe s’enfonce dans l’humus. Ouvre la bouche, écarquille l’œil. Une jambe dans les sillons, l’autre, se pliant, happée par le mouvement des astres. Dieu. Violemment se creuse, se cambre, s’offre et se recule (mouvement tenu et souple dans un seul instant). Croupe, torse, moignons, ça vient en arrière soudain – pourtant, je me tiens droite. Face Dieu. Grotte de chair où je suis. Ventre, sexe, malaxés, quelque chose de la droiture du monde. Tête bourrée de coups de poings, comme une cage thoracique enfoncée. Oiseau sans aile, va basculer. Larges lèvres, large cou : ma gangue, ma bille trouée. Le ciel lèche ma poitrine. Jamais d’apaisement – blessure vive, douleur de prison. N’apercevoir jamais ce qui saille en moi. Navigation là-haut, torture, là. Jamais trouvé le paradis. Ou ce mystère, je sais, qui vaque où je suis, partout (travail des anges sous le fouet ?). Partout absent l’amour qui m’enserre. Tout va venir demain ? Qui va venir demain ? Labeur d’une plaie vaut plénitude. Chimère de la cuisse. La taille, presque, tiendrait dans une main. Quelle ? Torse. Tiens-toi droite ma fille. La lumière vient du haut, sauf les volcans, ces bouses de feu. Vive la caresse de la lumière. Dieu-Tout-Silence mon cul s’enfonce. Méfaits de la dignité. Se tenir dans la vie. S’y tenir. Grand théâtre de terre. Le corps se gorge, le voilà dur, lourd, mais il lui faut, gardant les pieds sur terre, tendre au but dans le tumulte du monde – lequel, jour après nuit, on sait bien quoi. Beaucoup d’étoiles cette nuit. Persèdes. Tout se resserre, s’achève. Trop de silence. Difficultés de l’actrice. Essentielle difficulté : l’actrice. Le corps une bonne fois pour toutes. Cru. Coque de noisette. Grise sous la torture. Deuxième difficulté : le temps qui passe est sans remède. Troisièmement : peut pas regarder derrière. Etoiles. Vertèbres. Coulée de lave dépourvue de signification. L’effort de l’athlète ne pèse pas lourd. Son axe. Peut pas bouger. Pas bouger. Détente dans le capharnaüm. Coup de crayon. Saisir les doigts. Aucun bruit évidemment. Abandon du genou droit vers la droite. Stop. En août, manie la bêche et le sablier. Fugitive derrière les barreaux. La bêche et le sablier, fable. Creuser un trou, s’étendre. Une fois debout l’empreinte couchée. Hein ? Fossile. Datation. Concrétion. Cette molle dureté qui tombe des étoiles. Tombe. Marquage des événements essentiels de la vie par Dieu. Tiens-toi droit. Toujours pas de son. Grincement des cervicales. Radiographies de l’armature. Sous le regard du dieu muet. Sec. Prisonnière des archanges : épaules à hue à dia. La vermine, la mousse, le sommeil, le gel. De larmes, jamais. La vie par Dieu sur terre. Malaxage de l’argile. Sec. Traces de mains serrant, serrant. Pas de témoin. La vie par terre. Tâtonnements de l’anthropos Dieudieu. Mouillée et froide enfin la terre. Si souvent seule dans la nuit seule. Tirer violemment en arrière afin de vérifier si l’être va de l’avant. Mais bien assise. Chaque année il est replanté plus de (femmes ?) qu’il n’en est consommé. Sous le plaisir silencieux la pâle Hécube ploie. Polaires et démons, planètes et chutes – plus haut ton regard, chérie (photo). Sinon, exacerbée. Madame, pas de témoin, pas de bruit, pas. Mame Miracle est de retour, qui, ici, dans le nid, voit le coucou pondre (souffrances). Une coque de terre. Le maintien qui tient. L’abandon parle au sublime. Voûte céleste qui clôt la langue. Puis des choses : chaise paillée, un tabouret, table de bistro, ampoule électrique au bout d’un fil, plusieurs autres choses pour les doigts. Dieu concupiscent (tableautin, parfois urne funéraire), sa giclée. L’urne du vent oui. Et le retour subit des guignols – armada pied en cap pour des prunes : torture anonyme. Plus haut : les gogues (vomir, sanies, éventration, excréments, odeurs !). Gogues du haut Dieu (sa mutation génétique). Plus bas, moi. Nu de femme. Saison morte mais pas désespérée. L’Eternel est ma demeure. Allô ? Etoiles filantes, pas de vœux. Se concentrer sur. Pas de vœux. Machine à fabriquer du froid, (mode d’emploi incompréhensible) dans un monde sans volume. Le four à feu m’attend (Jeanne d’Arc). Illisible la version complète du calvaire. Intouchable. Cette vision de l’histoire d’une femme. Ou tâtonnements. Pas caresses : tâter, pincer, mordre, plier. Sans date (absence aussi de nationalité). Substance de la vie dans un univers aveugle. Tiens-toi droite. Si je suis une montagne en formation. Dieu. Brûler. Pierre. Plante aux cuisses reposant. Pas d’embrouille mais se couvrir un instant d’un manteau d’hermine payé par le bourreau. Ou encore : sac (étude de femme assise). Proximité des hommes incertains. Incertaine proximité des ? Femme, la même, sans bras une tête. Cocon sous voûte. Le rêve de Judith. Evoquer avec Dieu le thème de la résurrection des corps (tiens-toi droite !), de la profusion des membres, du silence des chairs (succion, déglutissement, flatulence, pression artérielle, grognements stomacaux, sans compter l’arthrose). Doigt de Dieu dans le. Ou le. Les sucs. Désir des arbres : pousser vers le ciel, ah ! Terrible timide torture de l’agonie des anges. Rien ne vaut une femme seule dans la nuit (ce que disent les hommes de Dieu). Une confession d’argile. Et l’affect dans ça ? Pas de vent, pas de pluie. Le corps du modèle se modèle, petite fille. Femme sans titre pas de souvenir.
(2 août 1998)
LA FORCE DU VENT
Quand Bob longe le bord de mer, il se souvient parfaitement du jour de ses sept ans : rue Bleue, une femme l’avait arrêté. Elle lui avait tendu, sans motif apparent, un billet de la Loterie Nationale. Il se souvient de son regard et de la somme coquette qu’il avait gagnée.
Bob longe la rue de Paradis et ses cristalleries, il se dit qu’entre deux séances de recyclage, un pactole sur ordinateur ferait son affaire. Introduisez votre carte. Tâtez l’écran et vous saurez combien vous avez gagné. Machinalement, il entre dans une cristallerie, et dans l’éblouissement des reflets, distingue une vendeuse. Pour attirer son attention, il fait tinter les pendeloques d’un lustre. « A quoi jouez-vous ? » lui demande-t-elle. Il reste sous le charme. « Je joue à tout ».
Quand Bob longe les champs d’œillets sauvages en montagne, il repère d’emblée les kiosques de la Française des Jeux – les capteurs et leurs mini-caméras, antennes dressées comme des ajoncs dans le ciel. Et le jeu des Prévisions. Celui des Cumulus. Celui des Oiseaux. Jouez Nature. L’état du ciel répercuté sur écran. Introduisez votre carte. Touchez le nuage. S’il pleut vous avez gagné… Combien d’alouettes passent au-dessus du Montfol ? Tapez un chiffre. Et, quand les oiseaux survolent la montagne blanche, leur image apparaît à l’écran, leur nombre s’incruste …6, 7, 8, 9, 10, 11, 11, 10. Tout semble se bloquer. Les chiffres clignotent sans s’arrêter. 10/11. 11/10. Et les alouettes ont fait place à un drôle d’oiseau qui trouble le jeu, envahit l’écran, avant de s’ébrouer à coté de Bob : une adepte du parapente venue atterrir là. « – A quoi jouez-vous ? ». Il reconnaît la voix. La fille de la cristallerie. Et vous ? ». « – A la Force du Vent » (A quelle vitesse souffle le vent ? Inscrivez un chiffre. Bravo/ Vous avez gagné)… Ce montant est immédiatement porté au crédit de votre carte de La Française des Jeux). « Mais, continue la fille en repliant ses ailes, j’ai oublié ma carte. » Et quand Bob donne sa carte à la jeune fille, il lui semble retrouver le regard de la femme de ses sept ans. Bien sûr elle introduit la carte, joue 110 kms/heure : à l’instant une formidable rafale la précipite dans les bras de Bob. Elle vient de gagner L’Hyper-Cagnotte du Vent.
PETITE FANTAISIE POUR NIÈCE DE CHANOINE
L’enfant de cœur : …Oui je rêve d’être son ventre !
Le sacristain (il fait semblant de rien entendre) : J’ai préparé les œufs de Pâques.
Le chanoine (idem, illico) : J’ai posé les petits pains blancs sur l’autel – deux bien chauds et ronds, blancs, dodus, exquis.
L’enfant de cœur (obstiné) : Je rêve d’être son ventre.
Le chanoine et le sacristain (exaltés et ensemble) : Que l’enfant de cœur agite sa clochette, un point c’est tout, alleluia !
L’enfant de cœur : Un peu de cœur au ventre, comme le temps passe aux champs de colza ! Cimetières d’angéliques, raides montées aux charrois, soudain le buisson flambe, et l’azur de mai retourné, à sec, et la phalange mouillée, et la bouche que langent les nuages – la pénétrant ! Vous qui comptez les œufs, crainte de les casser, vous qui multipliez le pain d’habitude…
(Le chanoine et le sacristain bâillonnent l’enfant de cœur. L’enfant de cœur se débat et casse les œufs qui tombent à terre, les pains suivent le même chemin. Tout au fond de l’église, cachée dans le confessionnal, la nièce du chanoine observe la scène. Elle se hisse sur la pointe de ses mules et cet effort dégage un coin de son ventre, tout rose, du côté de l’ombilic. Elle sourit.)
SEXY
Au rayon lingerie du grand magasin, une jeune femme au minois sexy brandit une petite culotte noire, un string dont elle examine la pseudo dentelle à la lumière : déculottade où elle révèle publiquement ses dessous, et qui permet d’imaginer ses goûts privés et son intimité. Comment ne pas chercher à connaître la forme de ses fesses, 1’affleurement de son pubis sous le tissu, la manière dont elle portera ses dessous et dans quelles circonstances. Pour qui examine-t-elle si passionnément la culotte ? Quel scandale pourtant, si là, comme l’envie m’en prend, l’on soulevait sa jupe jusqu’à la taille, pour qu’elle essaye la culotte. Non ? On se contentera de la proximité du visage et du string – leur rapprochement, l’œil brillant de l’acheteuse, la séduction qu’elle suggère – pour ne pas se voiler la face.
SOUFFLE COUPÉ
1 – Le calcaire, deux lapins de garenne. Traversons le Tison. C’est la Grèce. C’est la Corse. Recherche de la comète chinoise dans le ciel. Elle est orange et ne scintille pas. Une femme de terre ocre est attachée au poteau. Bibi au pays des lucioles. J’ai le cœur qui bat. Le Tison, ce n’est pas 1’Achéron : un torrent couleur de rouille. Me voici très bizarre à mon âge. Avons croisé des kayaks vert pomme. Pierres et sarments : qui est plus brûlant ? L’étincelle dans le crâne. Le frôlement d’une paume. Buvons du thé. Le vent chaud vient du Nord. Toujours garder le cap. Tilleul-menthe. Pas d’affolement. Les garennes sont minuscules.
2 – Cette incision, non : cet engourdissement. Non : ce mouvement violent, tourbillonnant. Un trou aux lèvres. Une certaine simplicité ne nuit pas aux relations humaines. Le souvenir du torrent sur des pierres plates et inclinées. Le souvenir d’une respiration. Les éléments : un épineux vert sombre dont chaque fruit évoque un cristal de glace ; une pièce où sonne un rire.
3 – Un dialogue sur le vent du nord, mais secret, particulier aux protagonistes. Ne pas dire: « j’aimerais me serrer contre toi », mais : « cela souffle fort ». Ne pas dire : « l’idée que tu partes m’est insupportable », mais : les oiseaux se cachent ». Ne pas dire : « j’aime ton sourire, mais : « il fera froid demain ».
4 – Une paire de socquettes sur le fil à linge.
5 – Tout va si lentement très vite que je ne sais pas comment m’y prendre. Affaire de rythmes.
6 – L’affolement provoqué par la bonté. Le sentiment ne sautille pas.
7 – Le désir s’installe. Les nuages passent. L’est toujours là.
8 – Une après-midi de souffle coupé.
9 – Le chatoiement d’une joue rosie par la chaleur, l’entrée silencieuse, la surprise d’une sensation heureuse. Souffle coupé.
LE JEU DES SEPT SUPPLICES
Ce jeu, très ancien, se pratique à deux, de préférence au coin du lit, mais, par beau temps, un bout de pré convient. On bat les cartes, chaque joueur en tire une. Dans le pot, il reste donc cinq cartes. Chaque joueur lit à haute voix ce qui est écrit sur sa carte. Il peut alors soit accepter la carte, soit déclarer : « je passe ». Dans ce dernier cas il garde la carte en réserve. S’il accepte la carte il met en pratique la situation décrite sur sa carte. Puis les joueurs tirent à nouveau chacun une carte. Trois cartes sont encore dans le pot. Même principe et re-tirage. Il ne reste plus qu’une carte dans le pot. Mais un seul joueur a le droit de la prendre : celui qui a accepté de mettre en pratique le plus grand nombre de situations décrites dans les cartes. Le perdant doit alors subir l’épreuve de la dernière carte ainsi que celles contenues dans les cartes en réserve (celles qui ont été « passées »). Le gagnant, s’il désire jouer une autre partie, devra trouver un nouveau partenaire.
Voici le texte écrit sur chaque carte :
- Lutteurs enlacés, immobiles. L’un va faire basculer l’autre, le jeter au sol. Pour l’instant, ils s’équilibrent. Derrière eux, un coucher de soleil.
- Amants enlacés et non moins immobiles. Assis tête contre tête. Ils se caressent le dos. Lequel fera ployer l’autre, lui couchera les épaules sur le plancher ? Au loin, les lumières de la ville.
- Un homme dans un fauteuil regarde son vis à vis, debout et prisonnier, lentement englouti par les sables mouvants. La tête du prisonnier atteint le niveau du sable. Il garde les yeux ouverts et disparaît à l’instant précis où l’homme assis a fermé les paupières.
- Chaque fois que le sacripant couche avec elle, il pense à une autre femme. Elle, ne pense qu’à lui. Ils jouissent ensemble. Au chevet du lit, un réveil fait entendre son tic- tac.
- Tu as marché sur l’ombre d’un homme enchaîné. L’instant d’après cette ombre avait disparu.
- Elle disait brûler d’amour. Il avait peur de se brûler. Leur vie a passé.
- « Soudain », dit-il, « plus rien », conclut-elle.
(1990)
VENDREDI SAINT
Quand je suis tombé dans le métro, c’était le Vendredi Saint. Je suis tombé à genoux de tout mon gros poids sur le nez de la marche. J’ai cru pouvoir me relever. Mais non. Mon pied gauche glissa sur le nez et je restai à genoux. Un jeune homme tendit vers moi une main secourable, carrément, pour que je mette la main dans la sienne, et il me demandait si je m’étais fait mal. Bien sûr, par fierté, je refusai sa main et finalement me mis debout solitairement, remerciant chaleureusement le jeune homme au bon sourire, mais j’étais bien gêné, de la chute que je n’avais pas pu contrôler, de la main secourable tendue, comme si, vu mon âge et mes cheveux blancs et ma masse, je méritais le secours de la jeunesse. Puis j’avais dû montrer mon cul à la foule en glissant et tombant, c’est bien vexant d’être gras et à quatre pattes publiquement. Et quand la patte se dérobe au moment où tu tentes un rétablissement en dernier recours, c’est un signe néfaste de santé. Surtout quand tu vois le pied rater son coup comme au cinéma ralenti. Mais enfin, me dis-je dans le wagon, c’est le Vendredi Saint et j’ai vécu la station Châtelet du Chemin de Croix où une foule de pauvres bougres ont péri en prison et sous la torture pour des crimes plus ou moins innocents. J’avais pris le métro à la station Château-Rouge où le sang coula sûrement à flots déraisonnables des créneaux au point d’engoncer les murs. J’allais à la station Saint-Paul (je ne fais pas de croquis d’apôtre) assister à la répétition d’un monologue joué par une certaine Marie (pas besoin de schéma). Le spectacle s’appelle Le Dédale du Silence. Je n’ai rien inventé de tout ça. Juré craché à la face de Dieu.
ESQUISSES POUR UN COEUR
(Dans ces esquisses, seul le cœur s’entend)
- On entend battre son cœur puis on voit les falaises de craie grise. Le soleil s’arrête sur sa main et sa main caresse le dos d’un homme. Ensuite un peu de terre s’effrite. L’homme et la femme marchent dans la neige. Ils remontent un vallon vers une crête dominée par un ciel bleu. Soudain, ils sont dans un lit-bateau et ils font l’amour dans la pénombre. La femme caresse le dos de l’homme comme si elle le sculptait.
- L’homme est endormi. La femme l’enjambe, se lève et s’enfuit. On entend son cœur battre. Elle court le long d’un ruisseau. Elle s’arrête près d’un bosquet de fayards, presse la main droite sur sa poitrine. On n’entend plus les battements du cœur.
- La femme dessine. On voit ses doigts esquisser une « Eve chassée du paradis ». L’homme se penche, embrasse les doigts de la femme.
- La femme brosse sa chevelure déployée devant un miroir. En silhouette et de dos : l’homme qui regarde.
- La femme et l’homme ont presque atteint la crête neigeuse. On les distingue de très loin.
- Côte à côte sur la crête, ils contemplent le soleil qui se couche derrière les montagnes, à l’horizon.
- La femme est allongée sur le lit. La tête de l’homme repose sur sa poitrine nue. Toujours la pénombre. Elle lui caresse la tête.
- Blanc. Battements de cœur.
- Depuis la crête, l’homme et la femme regardent le versant opposé. La neige est balayée par un vent violent. Ils ont peine à se tenir debout. La femme a saisi la main de l’homme. Elle l’entraîne vers un promontoire. Le vent est de plus en plus terrible. Entre chaque rafale, on entend battre le cœur de la femme. Elle désigne à l’homme ce qu’elle souhaitait lui montrer : un sarcophage de granit gris sombre émergeant de la neige. Ouvert et vide, creusé à même la montagne, le sarcophage est dressé en direction du soleil.
- L’yeuse oscillante. L’yeuse, sa respiration. La comète glisse entre les noisetiers sa chevelure. Climat de haute perturbation. Redescendez sur terre. Pas question. Préfère la houle. Tous les trois mille ans la comète, seulement. La chevelure tremble et l’yeuse oscille. Les mots sont incapables de traduire le trouble du sujet. Le sujet bascule dans le cou de l’yeuse. C’est le printemps qui nous fait ça ? L’odeur du lilas blanc, au crépuscule, sous le vent du nord. L’yeuse sa respiration. Le soleil se planque derrière les volets. Longues jambes de la comète, longues douces jambes. Fais moi voir ta comète. Chaque fil, chaque ressac. Le vent s’enroule et pince la peau jusqu’au vertige. Un beau charivari. C’est le printemps qui nous vaut ça ? Puis le tumulte s’apaise. Mon cher lilas, mon lilas chéri, j’ai toujours cru que l’yeuse était le féminin de l’œil.
- Vient la ligne de nuit blanche. Vous avez eu un accident de peau ? Oh oui ! Le point lumineux le plus vulnérable. Et vous avez pleuré ? Oui. La respiration se tourne, où je rêve de toi dormant sur ma poitrine, si fort nichée. Météore mouillé – s’abat. Les lueurs dans la chambre, le traversin chuchote aussi. Et traverses d’écheveau : cheveux dans l’embrassement, résine dressée. Je ne savais pas. Savait pas qui. Muette. Contrejour. Pas assez de paupières pour les baisers, et l’aile du nez, les hanches, chaque doigt, haleine où caracolent les cuirassiers. Image intérieure, amour.
- La dame posée sur le miroir de pierre, sa poitrine semble la tienne. J’ai failli y poser mes lèvres.
- Le numéro treize est brûlure, odeur de cheveux ; le cerneau se resserre. Et foulées. Gravitation de neige. Herbes coupées. L’herbe coupe.
- Les grandes forêts balancent leurs torses. Dans l’ombre, les racines, la mousse fugitive, rouge, ronces dénouées, pâleur du ventre entrevu. Je baise les pieds des grandes forêts au cirque rose et jaune – la ligne des funambules, du blé en herbe, l’embrassade. Torsion d’écorces sans jarretière, roulées sur la cuisse. Le buisson noir scellé par la joute, rivé aux bruines : une lande tendue, mouillée de gelée blanche, aux traverses, aux falaises de craie, aux rives sans échelles, suantes, surgies du frottement de l’aubier. Aussi : légère cime, avec ou sans voûte, avec ou sans frondaisons. Encore : frimousse acrobate entre branches de genêt. De même : un nid d’épaule rayonnant, la respiration. La main où navigue le fleuve, en boire chaque goutte.
L’HUILE ET LE SABLE
A cet ami posant des vitres en redoutant de les casser, et résumant ainsi la situation : « si j’avais eu des olives entre les fesses, j’aurais fait de l’huile, si j’avais eu des cailloux j’aurais fait du sable », que répondre ? Il est toujours délicat de placer un écran – fût-il transparent – entre l’intérieur et l’extérieur. Un coup de marteau, un clou de traviole, le carreau se fend, se brise peu ou prou ; la transparence devient dangereuse quand une étoile se mue en dague. Puis le vent siffle, la pluie, le froid, toutes ces réalités vous infestent. Si l’angoisse de ces risques provoque la fabrication d’huile d’olive ou de sable, il faut s’en féliciter. Outre l’utilisation de l’huile (plutôt pour des fricassées que pour la salade) et du sable pour des finitions délicates au ciment par exemple, la valeur symbolique, voire métonymique, de ces éléments semble évidente. L’huile de coude bien sûr – quoiqu’il s’agisse ici d’huile de cul –, l’huile pacifiante (l’olivier est le symbole d’Athéna) est de celles qui met de l’huile dans les rouages ; l’huile qui huile avantageusement les muscles du lutteur, lui permettant d’échapper aux prises de l’adversaire n’est pas à négliger non plus. Je passe sous silence l’huile de vidange tant son évocation paraîtrait, dans ce cas, scatologiquement implicite. Quant au sable, en dehors du ciment auquel un grossier tamisage suffit, notre ami pourra, s’il a serré les fesses avec suffisamment de force, transmuer sa peur de briser la glace en angoisse existentielle, glissant le minéral quasi poudreux dans un sablier, ustensile efficace pour aller se faire cuire un œuf et s’approcher de la mort en toute lucidité. Mais je suggère au briseur de vitres (qui est aussi le poseur des vitres, songeons-y toujours) de s’interroger sur l’hypothèse d’une utilisation simultanée de caillou ET d’olive : le caillou broiera l’olive dont le noyau, si dur soit-il, ne pourra jamais remplacer l’absence du caillou numéro 2 ; et notre ami chiera donc un caillou intact, facilité dans cette tâche par la production simultanée d’huile. Je ne peux m’empêcher de penser, symboliquement, voire métonynimiquement, que ce caillou, bloc d’angoisse intacte dont l’expulsion aura été facilitée par l’huile de la sagesse, est une pierre philosophale que notre ami saura utiliser à bon escient – par exemple pour briser, sciemment cette fois, le carreau qu’il vient de poser à la fenêtre de la galerie sud de sa maison, là où le vent et l’eau du ciel soufflent en rafales.
LE GISANT
Sitôt le gisant relevé, ils l’installent dans Un fauteuil. Ils le moquent : Quoi ! Tu ne sais pas même pas t’asseoir. Et le gisant se ploie – lui si raidi par l’habitude de la mort -. Eux ne s’en étonnent pas : la torture aura assoupli ses vertèbres. Voici qu’il les regarde. Il se penche et il les regarde. Sans doute un effet d’optique, pensent-ils, les ongles repoussent bien après le trépas, même si on les a arrachés. Puis voici qu’il leur parle, à chacun une parole de bienvenue. Il ne leur en veut pas, ils vont crever aussi. Ils entendent cela, oui, mais ils le mettent sur le coup de la fatigue – hallucinations auditives – : ils l’ont tant travaillé. Puis ils lui crachent à la gueule. Bel outrage ! Quand il se dresse, personne ne s’effare : c’est l’effet de la torpeur qui les saisit, où nagent des remugles : Tu ne vas pas ressusciter quand même ? Ressusciter des morts ? Quelle gabegie : on le roue, on le tue, on arrache ses dents, et il vient vous chatouiller ! Un fjord, des coupes d’arbres noirs et le plus grand silence : ils le voient encore, ce bougre dont ils connaissent chaque recoin, chaque muscle, chaque tendon, chaque évanouissement, ils le voient plonger dans l’eau verte, se retourner, nager et s’éloigner dans l’onde, les laissant, fantoches recroquevillés. Aucune parole ne franchit leurs lèvres. Ils ne peuvent crier au secours. Quand, à l’instant dernier, les bourreaux implorent enfin leur victime – Dis, ne nous laisse pas seuls, ne nous abandonne pas -, elle pirouette et sourit aux anges.
(16 octobre 1997)
LE CHEVAL EMBALLÉ APRÈS LA PLUIE

Tu sais l’heure qu’il est ? Il pleut, il a plu toute la nuit. C’est le soleil, le grand soleil du matin, un grand soleil. Il pleut. Neuf heures. De mauvaise foi pour la vie. Bien dormi ? Très mal. La télé ? Quoi de neuf ? Rien. Je ferme. Dommage, c’était la guerre. De beaux rêves ? Pas de variation. Le même. Pas le plus petit changement – tu as changé, toi ? Tu n’es pas un rêve, ça non. Tartine ? Des forces pour l’Ordre. A l’Ordre ? Pas si fort. Dis-moi : tu as rêvé ? Tu t’en fiches. La fille ? La même ? Tu regardes trop le poste. Elle fait quoi ? Elle te lacère les cuisses. Le temps qu’il fait ? Treize degrés. Minimum dix. Ou quinze-douze. Bon temps pour l’Ordre, l’heure est à l’Ordre. Je m’en grille une. Peigne-toi. C’est vrai qu’il pleut. L’Ordre doit éclater en plein soleil. Merde, il y a des éclairs. Tu pues le tabac. Je m’en grille une. La suite. Ponçage, tonte, relevage, discours, accrochage des tableaux. Trop chargé. C’est l’Ordre. Excessivement urgent. La fille du rêve, à quoi elle ressemble ? Pompe la caisse, s’achète (colifichets, dessous, dentelles, canons). Couche. Seins, cheveux longs, pas de poils presque. Tu es sectaire. A l’Ordre. A l’Ordre. Numéro douze : Cheval emballé après la pluie. Pas de cheval. Emballé. Reste la pluie. Belle pluie. Qui a peint le Cheval ? Je vais m’en griller une. Toujours respecter l’Ordre, je ne demande que ça. Des crottes de mouche. La pluie, le cheval, les crottes de mouche, les mouches dans les naseaux. Hennissements, ruades. Le cheval s’emballe. Il bondit hors du tableau. La guerre, sauf dans le tableau. Le tableau est une zone pacifique. La preuve ? Il pleut. L’artiste peint avec la pluie. C’est l’orage. Ou la télé. Encore mis la télé. Le fracas du monde. Envie de pisser. L’incident est clos. Seul devant tableau. Peur ? Drôle de bruit. Femme du rêve ? Télé ? Canonnade ? Bombardement ? Coupe, coupe. C’était des cadavres. L’Ordre ? En rade. Gazon ? Relevage ? Discours ? Sept pages ou synthèse ? Une visite. La Femme du rêve, inspectrice au nom de Dieu. Il se passe, Madame, en province, des choses capitales : cul, pulsations, bris, brisure, brisement, brisouillis. Le cheval emballé, beau comme un segment. Fragment. Pense à ton discours. Segment, saignement, sémantique, vertige, hitchcockien. Tu en fais trop. Jamais assez. Met le son. Coupe. Exécution. Palpation. Rythme. Et pan. Il me reste combien de temps ? Pas longtemps. Je vais m’en griller une. Et qui paye ? Va y avoir du monde. Pense à ton discours. Je les entends venir. Je travaille. Piétinent derrière la porte. Quatre évanouissements. Le cheval emballé après la pluie le beau temps. Emballé déballé ! Qu’est-ce que tu as ? J’étouffe. Tu vas crever. Chapeau tu t’es surpassé. Au poste. Bombardements etc. Coupe-moi ça. Ma guerre. Soulève ton bras, ça fera de la lumière. Chantage. La femme du rêve et chute de reins. Le cheval emballé drapeau déchiré, révolution. Erotique. Pièce unique. Le cheval emballé après la pluie descend de ses montagnes à Pâques. C’est un mystique. Un de ces êtres qui a la simplicité des espaces vierges. Trop lyrique. La femme du rêve. Penser palper poitrine. Elle a un regard émouvant. Gare au psychodrame. L’ai-je bien descendue. Je m’en grille une. Pense qu’à ça. Télé. C’est pas le bagne ici. Déjà à sec ? Laisse-moi penser. Son petit galop, ses petits hennissements, le craquement des fougères grillées sous ses sabots, le glissement de la sueur sur sa robe. Branches mortes. Couper ce prunier. Monte le son. La pluie n’arrête pas. Cette pluie qui dégouline dans le cou, cette pluie froide, ordinaire, automnale, elle te rince, elle t’affole, elle te flotte dans les naseaux, elle te fouette la croupe. Le dada s’emballe, décampe. La branche craque sous le poids de l’eau. Le craquement du bois mort est l’élan du cheval. La femme du rêve est dans ma chambre, dans mon lit, dans mes galaxies, dans mes chiottes. Dieu est un cheval emballé après la pluie. Pousse le bouton. Tu dégazes ou quoi. Plus de jambes, plus de bras, plus de tête, plus de tronc. Gros plan. Gros plan virtuel. Tu n’entends rien ? C’est là, un gros bruit, un vrai bruit de sabot, de feuilles froissées, le rythme impénitent de la pluie sur les crosses, un bruit de croûte de peau. Faut pas avoir peur, ça se termine toujours bien. Aujourd’hui ça pète ? C’est dans la tête alors ? C’est le cheval ? Tu es écolo ? Zen ? Crypto ? Le cheval se bat sur tous les fronts. L’Ordre du Jour est sans lendemain. Ton sang froid. Au poste. Je vais m’en griller une. Une bouffée. Une sans fumée. Tu connais un réparateur ?
LES AILES DE LA MAISON CARRÉE
Les ailes de la Maison Carrée sont rouges. Les ailes se déploient au-dessus des visiteurs, puis, dans l’instant, se referment, en sorte que les hôtes ne perçoivent rien – juste un frémissement qu’ils mettent sur le compte des brutalités lointaines du mistral. Dans ce cocon, ils se souviennent de ce qui les a menés ici – alcôve drue de l’azur hérissé de cyprès, d’ifs, d’araucarias, amours de pierre trônant sur l’hypogée aquatique des fontaines, ventre d’une nymphe vrillé vers l’onde, puis, au-delà des oliviers et des pins parasols, le pain de sucre étouffant dressé sur la colline, vestige romain où l’on grimpe sans trêve. Dire que les visiteurs se souviennent est excessif : ils ressentent des caresses, des vaguelettes de caresses. Et cet invisible horizon vient battre les murailles sang de bœuf de la Maison Carrée, qui palpitent, s’effacent, propulsent leurs pas dans des ruelles froides trouées d’atlantes. Tout défile très vite, la violence du vent, l’éclair des regards, l’éclair de la mélancolie, la violence des regards. Si la terre s’ouvrait à l’instant même, ce serait peut-être bien, entre les marchands de gaufres et les poneys couverts de mômes (promenades en famille d’un après-midi) ; ce serait peut-être bien. Ils fileraient dans l’odeur des résines et des micocouliers, la soif ils l’étancheraient d’un verre de vin en attendant mieux. Ils ont faim de couleurs quand un nuage dégringole. Il pleut. Ils sont sur un banc. Le soleil revient. Le vent du Nord. Un palmier. Bimbeloterie. Ville et la foule. Choisir l’égarement des venelles désertes. Courir, ou l’illusion de vivre lentement – Frôler. Glisser –. Moulure d’un porche. Ecaille d’une voûte. Palissade enduite de ciel. Tags. Se sourire. S’abandonner ? Abandonner ? Le coup de l’aile dans le cou de l’autre. Les ailes rouges de la Maison Carrée. Passer les doigts sur l’aile. De curieux gymnastes tentent un saut périlleux. Les plumes s’envolent pour venir peindre les murailles antiques, mais cela prend un temps infini, un temps silencieux, un drôle de temps.
MADELAINE FULCONIS
NUL DEMON EN CES LIEUX N’ELUT SON DOMICILE, TOUTE
CRAINTE A MON BRAS EST D’AILLEURS INUTILE
N’oublier pas celui qui pensse à vous pour toujours R
Mademoiselle Madelaine Fulconîs rue Vendôme 204 Lyon Rhône
Un d’ailleurs (« Toute crainte à mon bras est d’ailleurs inutile ») abolît ce que R, expédiant la carte postale, prétend. Le démon gîte bien là, où R cherche à entraîner Madelaine Fulconîs, Qu’il pensse à elle pour toujours en apporte la preuve éclatante. Qu’il pense à elle si fort qu’il lui faille redoubler une consonne, l’écrasant d’un redoublement de sifflantes – allusion au reptile biblique – renforce le toujours : comment s’aimer à jamais sinon en Belzébuth si le paradis terrestre a filé ? Quant à l’emploi de l’infinitif Noublier, en place d’impératif et privé d’apostrophe, il provoque déjà la fusion où R veut coucher Madelaine Fulconîs. On s’oublie en nous non ? Ce n’est plus une supplique mais déjà un constat. L’oubli voilà le but.
Tournons la carte. R s’identifie à l’homme en bleu. Il fait de Madelaine Fulconîs la femme en rose – côté coloris, la tradition est respectée par le retoucheur de la photo, à l’origine en noir et blanc -. La semeuse républicaine du timbre à 10 centimes ouvre une fenêtre rouge dans la muraille désossée du château. R a collé la semeuse tête en bas : elle gigote les jambes au ciel. Une posture qui, outre 1’anti-républicanisme de l’expéditeur, sert de miroir fou à la femme en rose. Si Madelaine Fulconîs savait y voir, elle y verrait son destin scellé. Elle s’apprête à pénétrer dans le monde d’en bas, celui du Prince des Ténèbres (on comprend mieux le mépris souverain de R pour la république), où les jambes féminines s’agitent à l’envers. Mais Madelaine Fulconîs ne lève pas les yeux vers la fenêtre rouge : elle regarde S, Ou plutôt, elle paraît le regarder. Son regard glisse le long de l’épaule gauche de l’homme en bleu pour se perdre dans le feuillage évanescent qui le ceinture. Feuillage qui pour n’être pas de feuilles de vignes (ronces ? sureau ?) vient lui masquer le sexe.
Selon le cachet de la poste, R a expédié la carte de Grenoble (Isère) le 2-4-3-07. Sept ans avant le début de la Grande Boucherie, il y a du piou-piou d’opérette dans l’ersatz de R : les chaussettes noires anticipent les bandes molletières ; la veste-tunique à col d’officier bleu-horizon taché d’un jaune brunâtre annonce la boue des tranchées ; jusqu’au galurin du même bleu ; déjeté sur la partie droite du crâne, il tient davantage du troufion en goguette que du chevalier servant.
Invitant, doucement, mais fermement. Madelaine Fulconîs à gravir les marches et, bientôt, à franchir l’ogive du seuil, R lui masque son dessein. A-t-elle vu le donjon dressé à l’horizon des ruines, dont elle pourrait bien devenir la prisonnière ? Son hésitation porte-t-elle sur l’heure insolite de la visite – nuit de carte-postale, une lumière blafarde, lunaire, fige l’aigrette du chapeau de la femme en rose ? R a déjà un pied sur la marche supérieure du perron. Le pli de la robe au long de la cuisse droite de Madelaine Fulconîs atteste qu’elle esquisse un mouvement pour rejoindre R. Lui la soutient, la tire presque, tandis qu’elle mime de son bras gauche ganté un embryon de refus, de perte d’équilibre.
Madelaine Fulconîs, en dépit de son nom, est une femme qui se tient presque bien. Selon la carte postale. Mademoiselle Madelaine n’a pas encore franchi le Rubicon. Mais il faut que l’expéditeur lui soit bien familier pour signer d’un seul R. Raymond, René, Renaud, Régnier, Régis, Robert, Raoul, Raphaël, Roger, Rodolphe ? Ou R comme reviens. Et si la scène s’était déjà jouée ? Si la carte faisait allusion à une exploration noctambule déjà acquise, dans des ruines romantiques cernées de bosquets, abritant une tour encore intacte et pourquoi pas douillette. Séduction achevée. R comme rebours. Nul démon en ces lieux n’élut… Ce passé-là n’est peut-être pas si simple. Ce que, chère Madelaine, vous aviez pris pour l’assaut du démon, c’était un moment de plaisir. Souvenez-vous. R comme recommençons. La femme rouge, la femme timbrée, la semeuse à tous vents, c’était vous. Mademoiselle ? Votre geste de l’avant-bras, ce mouvement de funambule sans ombrelle, est l’écho inversé, dérisoire, de l’énergie dépensée par la République, là-haut, à sa fenêtre. Energie que vous dépensâtes follement. Res publica, Madelaine, la chose publique que fut votre sainte patronne avant d’oindre de son parfum le type célèbre qu’elle aimait – et, puisque nous en sommes aux parfums, celui qui s’exhale de votre peau chauffée par l’émotion titille la moustache impeccable de R. Cette sensation lui procure un air faraud. Il paraît assuré de sa victoire, comme Madelaine Fulconîs d’une défaite consentie. R est aux avant-postes, Madelaine ôtera bientôt, son chapeau, elle commettra tout à l’heure, et sans doute à nouveau, le péché capital de l’abandon. Madelaine s’était jurée de ne plus faillir, pourtant voici qu’elle défaille, ou pire : feint de défaillir. Et R le sait, qui a déjà exploré la faille. Son regard guilleret vous déshabille, Madelaine. Il ôte votre chaste manteau rose et vous le suppliez de continuer, votre cœur s’accélère, une fragrance de tubéreuse se répand à travers les ruines de pacotille, imbibant vos doigts qui caressent la carte postale jaillie de la boite aux lettres, dans votre corridor du 204, rue Vendôme, à Lyon, aux confins humides du Rhône et de la Saône. Sur la carte où vous serrez vos lèvres, une tache s’épanouit ; à la seconde où R pensse à vous, vous penssez à lui, vous escaladez les marches, vos cuisses vous tiennent à peine, vos narines palpitent, et, lorsque vous passez la porte, vous demeurez muette, certaine qu’en ces lieux nul démon n’élut son domicile, puisque, chuchote R à votre oreille coiffée d’un bandeau vacillant : toute crainte, à mon bras, est d’ailleurs inutile.
QUELQUES COULEURS DE LA VIE
Rousseurs de la campagne cramée par le gels, gris et violets des nuages lancés par le vent de Travers – le vent d’Ouest. Dans le chemin creux, une châtaigne nue, déshabillée de sa bogue et de sa peau, ronde et ridée, surgie comme un champignon, crème, non, presque orange pâle, mordorée et mate : sa coque et son épiderme ont pourri sous l’hiver. La chair, durcie, est devenue l’os de la châtaigne, elle a éclos dans l’humus en même temps que les violettes parme, les boutons d’or, les jonquilles à l’insolente nostalgie. Le vent continue de souffler et, par moments, crache du ciel bleu. Au-delà des branches enchevêtrées, les montagnes, plissées, froissées de mauve, de rouille, poudrées de neige. Cette blancheur lointaine, portée par le froid, durcit le regard – celui qui voit cela est un insecte, un caillou. Il s’arrête, suffoque. Sa respiration se mêle aux raclements de la bise, aux trilles des mésanges, à l’aboiement d’un chien dans la vallée. Il reprend sa marche, l’humidité roule dans ses poumons. Il tombe, face dans les feuilles mortes, et ses vêtements, le vent de Travers les fait à peine frémir
LA BAIGNOIRE
Ce que nous appelons baignoire au théâtre n’a rien à voir avec la baignoire habituelle. La baignoire ordinaire sert à se laver, à laver du menu linge en se cassant l’échine, ou des draps. Les assassins y découpent leurs victimes à la tronçonneuse. La baignoire théâtrale, ainsi nommée pour la forme de ses balustres, pour leur panse arrondie, est passée de mode. De nos jours, le théâtre est un ring, ou un écran. Pourtant, messieurs-dames, la baignoire théâtrale est exquisement pratique : elle permet au spectateur emporté par l’horaire de la représentation de casser discrètement une petite graine : sous le programme, il dissimule un sandwich. Profitant de la concentration de ses voisins, tendus vers la scène où les héros se débattent avec un texte rébarbatif, il se penche et, mine de rien, croque son jambon-beurre-cornichon. J’en ai vu, trompés par la pénombre, mordre la cheville du spectateur de droite. J’ai faim ! Le cri qui s’ensuit perturbe agréablement la pièce de théâtre. Des idylles naissent pour moins que ça. Oh ! Je vous ai fait mal ! Excusez-moi, je me suis gouré. Puis-je vous panser ? Vous avez bobo ? Etc. J’ai faim. Cette entrée en matière en vaut une autre. Personnellement, dès que je suis dans une baignoire, j’ai faim. Vous avez faim ? Oui j’ai faim. Je dévorerais ma chemise, et la serviette-éponge. Cette baignoire aux griffes de lion, cette baignoire en fonte écaillée, je m’y repais. Les gargouillis de mon ventre gênent la perception de la pièce de théâtre, mais ils l’enrichissent peut-être. Apportez-moi un plateau-repas ! Le supermarket est à deux pas. Faites cela, pour moi, pour le spectacle. Nourrir le spectateur dans sa baignoire, c’est nourrir la scène. J’ai faim. Les comédiens nourrissent leur âme des spectateurs, leurs vivats les abreuvent. Il faut donc nourrir le spectateur dans sa baignoire. Un spectateur alimenté applaudit à tout rompre. Il faut absolument nourrir le spectateur. Je ne vais quand même pas lécher le savon ! Les comédiens, là-bas, attendent le rot du spectateur. J’ai faim. Son rototo tonique. Ne ratons pas ça. Souvent, de la baignoire, je dévore les comédiens des yeux. Expérience troublante ! Ils se dépouillent et je les gobe. Mais quel esclavage! Mais quelle goinfrerie! La question est : jusqu’à quel point faut-il nourrir le spectateur qui, simultanément, nourrit le comédien ? Les excès alimentaires débouchent sur du théâtre qui traîne en longueur et laisse, le spectateur exsangue. A l’inverse, le jeûne entraîne un jeu abstrait, éthéré, anorexique. Le théâtre requiert un régime équilibré qui rend le plaisir comestible. J’ai faim. Qu’est-ce que je déguste ! Pas vous ? Je goberais la pierre-ponce. Oublions un instant les comédiens. Qu’ils se débrouillent. Digérons tranquille, loin de la scène. Voulez-vous me rejoindre dans la baignoire, je vous prêterai mes jumelles. Quand on a faim, il faut multiplier les points de vue extérieurs. Le visage d’une comédienne en gros plan, cette vision imprévue, sa portion de visage est un morceau de choix. Parfois un morceau de bravoure. Le renflement de la baignoire dissimule les genoux. Ils peuvent s’y appuyer de toutes leurs forces. Parfois, dans la baignoire, le spectateur fuit hors du temps théâtral : tandis qu’il contemple les acteurs, il fait des bulles. Quand ces bulles explosent, il est heureux, sans les comédiens. Quel ennui pour eux. A leur tour, ils crient famine. Ils ne disent pas crûment j‘ai faim, mais leurs attitudes le suggèrent. Ils sont dans le schwartz. Et nous, calmement assis dans la baignoire, savourons l’instant. Enfin nous pouvons nous passer d’eux. Peuvent-ils se passer de nous ? Qui mange la laine sur le dos de l’autre ? Un décorum minimum et l’on déguste sa pièce de théâtre. J’ai faim. Vous êtes bon en théâtre ? J’ai vu des spectateurs mordre la baignoire de rage. Quand le théâtre est avarié les comédiens mordent la poussière. Magnifique. Sublime. Il arrive que des acteurs investissent la baignoire. Il arrive que des spectateurs, depuis la baignoire, lancent des tartes sur scène. Oui ! Depuis la baignoire. Parfois le spectacle coule, la baignoire se vide. Les comédiens enjambent la baignoire. Les grenouilles s’en mêlent. Des couacs épouvantables. J’ai faim. Couac. Le spectateur, parfois, mange le morceau : “je n’aime pas le spectacle !”. Le spectateur hurle : “je n’aime pas le spectacle !”. Si tous les spectateurs braillent ensemble “je n’aime pas le spectacle !”, le comédien s’inquiète. Que mangera-t-il demain ? Le spectateur est une furieuse nourriture. Le comédien a mal au ventre. Le trac. La colique. La diarrhée profuse. Si le spectateur a mal au bide, il quitte sa baignoire pour rejoindre les waters closets. Quand le comédien fait un bide, il doit rester sur le plateau et recevoir des tomates, des œufs pourris, des vieux chapeaux. J’ai faim. Ouais. Faim. Faim. Encore faim. Faim de théâtre. Ça ne mange pas de pain, ça, le théâtre. Le spectacle est servi sur un plateau. J’ai faim. Plein la bonde de baignoire du théâtre. J’ai faim. Je quitte la baignoire. Le fin du fin c’est de quitter la pièce avec une légère faim. La baignoire se vide. Glou glou. Glougoute. Glout. Glout. J’ai faim. Fin. C’est le trac. Pas vous ?
AMORCE 2
…s’écroule quand on ouvre le mot, quand le mot s’ouvre et que s’amorce – en vain. S’écroule et ce qui s’amorce en vain s’ouvre quand même, même un peu en vain, puis s’écroule. S’ouvre un peu, juste un peu, c’est à dire s’amorce. Là, on prend la photo, on vient derrière l’objectif, on dit qu’on va prendre la photo: tu veux ma photo ? dit-on en vain – non ! Je vois ta gueule tous les jours. On écarte les jambes, on se campe devant l’objectif et non. C’est en vain qu’on ouvre les jambes, par contre on ne serait pas contre une photo souvenir, toutes les photos c’est comme ça, des souvenirs s’amorcent, l’ouverture du souvenir amorce la photo – construire le souvenir en vain est une chose naturelle, quelque chose comme un paysage sans fin, des champs, la montagne, du vivant – du vivant s’amorce, la montagne s’écroule mais du vivant s’amorce qui ensevelit le vif, souhaiter janvier en février par exemple parce que la photo c’est pas pour les portraits, vu que les gens tu t’en souviens, un peu, encore, différents mais encore, si tu les ouvres encore, si tu les zipes, si tu amorces la pompe à cœur, tu t’en souviens, pas besoin de photo si tu les portes dans ton cœur, ou alors quelques unes, sauf celles-là que tu portes dans ton cœur, sans fin – donc tu allonges l’amorce, tu repères le défaut, tu t’allonges pour prendre la photo, une dernière photo avant l’amorce – tu amorces en vain parce que le dernier mot s’écroule avant le déclic. Non. Pas besoin de prendre ma photo debout non plus, ni assise dans le paysage qui se dessine derrière l’amorce, avant qu’elle même se désamorce – puisque, avant même, je t’allèche. Pas besoin, presque pas, j’entends cela dans le mot qui s’ouvre, se ferme en même temps, le mot photo peut faire l’affaire, seul, au seuil, dès que s’ouvre le paysage, le seuil suffit, un seul mot de passe – Babel – s’écroule quand tu ouvres la bouche du mot, bien entendu, dès que tu ouvres la bouche, dès que la langue passe par ta bouche, pas besoin de prendre une photo de ça, l’intensité du mot, le seuil de la réponse, plus fort, plus bas, le seuil puis la réponse, la réponse adéquate, la main devant la bouche, aussitôt les doigts dans la bouche, une sommation en somme franchit le seuil jusqu’à ce que le paysage s’ouvre, se ferme. Te voici allumée, enflammée sous l’action du mot transmis par la langue. Une charge d’allumage est nécessaire au mot avant qu’il ne s’enflamme, un choc suffit, une petite percussion engloutit le paysage. Il n’y a pas de mot pour dire cela, l’amorce est ce qui s’écroule quand on ouvre le mot, le mot dans son étui n’est pas étanche : donc fissurer le mot – bien entendu le mot est comprimé jusqu’à ce qu’il explose, plus il est comprimé plus il fait mal, plus il fait mal plus vite il s’écroule, peut-être qu’il s’éboule seulement, s’effrite, amorçant le mot d’après, en vain, d’après, le mot d’ensuite, sans fin, celui qui ouvre le paysage pour la photo-tu-veux-ma-photo.
Y’a pas photo.
Où ça le mot, en vain, qui s’écroule sitôt amorcé, avant de. Autre mot. Commencer à ouvrir les dents. Commencer à ouvrir les dents du peigne. La langue sort largement de la bouche, y amorce un retour, puis replonge. Je crois qu’elle amorce le paysage. L’appareil sort de la bouche. Il s’agit d’une bouche en terre, une bouche cuite, un bloc de bouche tire la langue, c’est le bon moment. La terre est gloutonne. Il faut ouvrir les dents du peigne maintenant. Le peigne dénude les cheveux. Il y a de la terre sur les dents du peigne. C’est une terre emmêlée. Une amorce de terre. Le mot est un bon amorçoir. Le souvenir est un bon amorçoir. Malaxer les mots en terre est un bon souvenir. Viens dans ma terre est un mauvais souvenir, un paysage mort. Faire venir la terre des mots avant qu’ils ne s’effondrent. Venir dans la terre des morts avant, en vain, tant pis. Je ne sais plus où est le paysage – pas dans la photo. Une maison en terre pour abriter les mots de la pluie des mots est une excellente idée. Toujours cette voix, celle d’une fille accidentée, recousue de partout, criblée de tics, qui, soudain, marche vers nous comme vers un paysage, puis freine sec : tu veux ma photo ? Le fard recouvre ses cicatrices. Elle prend dans son sac – elle n’a jamais de sac, elle oublie son sac, il faut toujours lui donner un sac – un appareil photo jetable, elle nous photographie. Non ! Je vois ta gueule tous les jours ! Elle reste, bras ballants, avec l’appareil. Elle amorce la photo. Bruit. Photo. Clic. Flash. Elle entre dans la maison du mot mais elle oublie le mot à dire, on lui souffle le mot, elle le répète en vain, il s’écroule aussitôt. Une matière inerte, façonnée comme un leurre, pénètre dans la bouche de la fille, imaginons, exécute un mouvement uniforme, un mot en travers de la gorge. La fille suit un stage photo mais elle oublie le mot de passe, elle pénètre dans la maison de terre sans dire le mot de passe, on souffle le mot en vain, elle oublie le souvenir qui l’amène là, jambes écartées, l’amorce d’un stage photo c’est pas assez, il faudrait développer, mais en vain, ne peut qu’avancer dans la maison de terre – théâtre du leurre. Elle dit : quatre jours c’est pas beaucoup, par contre je peux te montrer une photo de paysage, c’est naturel, un paysage éternel, un paysage sans fin, toutes les photos c’est comme ça, un souvenir, les gens tu peux t’en souvenir, le paysage c’est pas construit par les gens, les photos c’est pas pour les portraits. Le cercle sombre se referme sur le mot d’après, on lui souffle le mot, en vain, qui s’amorce, s’écroule dès qu’elle ouvre la bouche le cercle se ferme – c’est comme ça depuis l’accident.
(2004)
PHOTOS
Elles veulent se faire photographier dans la nature, ou au pied de la tour cassée, ou à côté de la Vierge Marie allaitant. Touchez la statue. Elle est humide. Je fais pas des photos d’art, hein ! Juste des souvenirs pour toi. Les petites filles penchent la tête, se campent, se débarrassent de leur sac à dos, de leur calepin, de leur crayon. La mer. La poussière. Les pigeons dont les roucoulades résonnent sous les voûtes. Les petites passent la main sur les pierres entaillées. Oh c’est rouge, vert, rose saumon. Il y a des toiles d’araignée. Il y a des araignées. Il fait doux, avec de la pluie dans l’air. Photo ? Non ? Faut se décider. Tu as choisi ton endroit préféré. Ou celui que tu détestes ? Cette statue. Les plis de la statue. Elle est venue exprès pour une photographie devant la Vierge allaitant. Tête du petit Jésus ! Un avion ronchonne. Les petites traînent un peu. Alors ? Photo ? Secouent la tête. Non. Et là, qu’est-ce que tu en penses ? Oui ? Bien cadrer la petite. Tu veux t’asseoir ? Debout. Debout devant le labyrinthe de buis minuscule. Brusquement la petite se tourne. Un trois-quarts. La seule. Toutes de face sauf elle. Un défi. Tu oses me photographier ? Encore un hiver qui s’annonce. Qui a déposé un marron, énorme, luisant sur le piédestal de la statue? La pluie, quelques gouttes. Lumière fade. Cette manière sucrée des petites. Acide et sucrée. Et l’adolescente qui marche à l’écart, l’air pas vraiment concernée. Treize ans. Grande perche, secrets. S’assurer de sa complicité, qu’elle se sente hors concours. On s’est déjà rencontrés quelque part ? Elle ne mettra pas le souk. Veut bien être photographiée, mais tout à l’heure. A déjà été photographiée, l’an passé dans les mêmes lieux. A déjà repéré l’endroit idoine. Le problème c’est que les petites s’égayent. Sans compter celles qui reluquent. Ah ! Photo ! Devant le jet d’eau. Il fait de la musique ? Poétesse. Jambes écartées. Un sourire ? Pas de sourire. Si : minuscule. Le pigeon mort sous un banc. Les petites ne disent rien. Et la porte, là ? Exposée dans le cloître, croisillons de bois archi-usé. Qui veut être photographié devant la vieille porte bouffée aux mites ? Les petites secouent la tête. Insistons, pour la blonde, angélique. Elle caresse la porte… Non. Mais, dans la pièce voisine, la sacristie, oui. Il y a du monde ? On s’écarte. Une photo pour la star. Ça lui plaît. Clic. Bras ballants. Les petites ont les bras ballants. Maintenant, toutes voudraient un cliché, illico, dans la nature. Ruines de l’église. Sur une colonne tronquée. Elles ont vu le rideau en pierre qui ouvre sur le vide. Il y a de la mousse, du rouge. Ou avec les ifs en cône. Ou accoudée sur la balustrade. Très romantique, avec le canal derrière, les jeunes cygnes beiges. Au fond, la photo leur plaît, surtout ces Polaroïd où elles apparaissent lentement, progressivement, tandis qu’elles éventent le cliché pincé entre leurs doigts. Gris d’abord, le jaune, du bleuté, les formes et les rouges. En grappe, elles se voient naître des limbes de la chimie – et cette trace pisseuse sur le rebord inférieur du cliché. Bavures au développement. Cafouillage. Le mot leur plaît. Du cafouillage. Prenez-moi en photo, il y a du cafouillage. Cafouillage. Cafouillage. Elles trottinent sous le cloître. Cafouillage. Elles rient. Vous avez vu le carrelage. Vous avez un zoom dans les yeux, qu’est-ce que vous voyez. Des crottes d’oiseau ! Un mégot ! L’usure. Du gris, du noir, du rouge. Penchées, à genoux. Sauf celle qui regarde le ciel à travers l’oeil de boeuf, au loin, et le feuillage. Oui une photo. Oui. Ça ne se déclenche pas. Plus de pellicule. Recharger l’appareil. Quelque chose d’interrompu. Panique. Un ratage. Un cafouillage. Et si elle allait s’enfuir ? Non : elle se lisse les cheveux. Et la porte, là, qui ouvre sur un mur. C’est pas normal. Pas de poignée de porte. Les pierres du mur, visibles à travers les quadrillages de la porte. Porte. Cliché devant la porte. Les petites refusaient, maintenant elles sautillent. Porte ! Les petits doigts s’accrochent. Là. Du bois léché par la pluie, raviné, des siècles d’eau. Je fais la photo. Rires, des gloussements. Vous savez, ces corridors léchés par la pluie. Photo. Photo. Qui n’a pas sa photo ? Tout le monde a été photographié ? Toi oui ? Il en reste trois, désignées par les autres. Elles ont pas été photographiées. Alors ? Où ? Faut faire vite, on n’a pas beaucoup de temps. Alors ? Ici ? Elle, fataliste : pourquoi pas. Et sur le muret ? Elle veut bien. L’autre, derrière le muret, dans le labyrinthe. Clic. Clic. Cadrer le buste, la tête. Refuse de sourire, bouche légèrement ouverte, étonnée. Merci. Elle agrippe le cliché, comme si elle allait tomber. Puis à reculons. L’amertume de la photographie. C’est fini. Plus de photos ? Les petites en voudraient d’autres, au moins une autre. Plus de photos. Plus de temps. Plus de pellicule. Plus rien. Vous pouvez partir avec vos photos. Plus de traces. Les couleurs restent un moment, la moue de l’une, des yeux profonds, bruns, des yeux photo, décolorés, des yeux qui passent, un voile, la pluie tiens.
(2008)
PAINTING-BALL
1
– Deux tireurs vêtus de combinaisons blanches, deux mannequins souples, armés chacun d’un revolver et placés à distance réglementaire.
– Se tuer, s’atteindre, se blesser ?
– A distance idéale pour tuer.
– Faut-il un arbitre ?
– Chacun sait ce qu’il fait.
– Pas d’arbitre.
– Le problème d’un arbitrage nécessaire pour tuer, tenons-le à distance.
– S’agit-il de mannequins animés ? D’automates ? De robots ?
– D’hommes à vendre.
– S’agit de tuer.
– Ces mannequins seraient des hommes. On peut disposer des hommes vivants, pensants, souffrants, exiger des mannequins à duel…
– Des hommes frits d’avance.
– Sans jamais se prononcer sur un point : sont-ils victimes ?
– Victimes de quoi ? Voilà des mannequins blancs.
– Autre problème : spectateurs ? Non-spectateurs ?
– Ils payent.
– Ils sont invités.
Pour lire l’intégralité du texte, cliquer sur ce lien : Painting-ball
INOMMÉE
Quel joli prénom. Il a un p’tit air d’Egypte, d’xième dynastie. Trouvée dans l’Orient-Hasard, Inommée fut princesse : sa blancheur le prouve. Dans le couchant son nom est beau à lancer contre les falaises édentées et ocres. Elle a une bouille ronde de cousine, l’Inommée, celle que l’on n’ose jamais nommer. Inommée. Son règne. Sa maladie. Sa mort très jeune… Inommée tape le tarot dans le salon – à moins que le bridge ? Inommée porte sur le monde le regard de celles qui l’ont quitté sans atterrir nulle part. Inommée, pas de nom particulier. Inommée des Limbes serait un peu snob… Inommée bébé ne suçait jamais son pouce. Tétant le sein maternel, elle possédait déjà cet air de dignité naturelle qui faisait chuchoter aux foules au passage de son landau : C’est Inommée, c’est (et la rumeur brûlait comme un sarment dans la nuit), c’est Inommée… Dès qu’elle fut pubère… Oui on sait bien ce que parler veut dire… Dès qu’elle fut promise… Toute jeune et tentée par le diable, elle rêva de baisers fougueux qu’elle ne reçut jamais… Inommée est potelée. Inommée est une jonquille d’altitude – de celles qu’on ne cueille pas, mais les moutons l’arrachent d’une babine distraite… Inommée au ventre froid regardait l’azur qui se teignait de pourpre. Le soleil s’accordait à son sexe. Il trancha la ligne de crête, laissant du sable sous ses yeux… Prise d’un grand tremblement, fièvre, nausées, chaque muscle en saccade, Inommée promise à la main de l’artiste sculptant sa chair, s’apaise, se lisse. Fructidor – le fruit est présent, aussitôt sacrifié : Inommée tombe. Elle se brise. La tête. Le tronc. Les jambes. On n’a pas retrouvé les bras. Le soleil poursuivit sa chute au delà des pics ; il ne laissa que des ombres calcinées où surnageaient des plaques vertes et la dentelle d’un prunellier en fleurs. Les fleurs essaimèrent sur la minijupe d’Inommée… Inommée portait une ?… Les pétales tressèrent des boutons au chemisier d’Inommée, un chemisier haut serré à son cou, au col aussi étouffant qu’une minerve d’airain – mais celle-ci est plus tendre qu’il ne paraît, offrant la bouche d’Inommée, pulpe de terre.
(11 mars 1997)
L’ÉNIGME RESTE ENTIÈRE

– L’énigme reste entière : femmes en armures et casques, elles-mêmes nefs, gisantes que les vagues et les remous célestes déposèrent sur les canapés. Ce sont des guerrières à peine rosies, très jeunes, expédiées sur l’océan, consentantes mais ignorantes des combats, sauf pour la lutte des rêves.
– Soit. Poitrines. Cuirasses. Arbres. Ecailles. Charpentes. Machines. Lisses.
– Qu’est-ce vous racontez ?
– Epaulières. Faudes. Sanglières . « Rien d’humain ne battait sous ton épaisse armure », dixit Lamartine, vous saisissez ?
– Antigone fut langoureuse et son poitrail semé de myosotis. Ses filles s’en souviennent. Elles croisaient chaîne et trame pour la soie de leur ventre. C’était avant de s’embarquer.
– Il y eut donc naufrage. Le claquement des pierres sur le rivage et l’argile mouillé, l’ardeur du soleil et du sel.
– Puis la mémoire. Maille après maille, sans caresses, sans amour, la cotte se défit.
– Personne ne courait après ces filles-là. C’est pour ça qu’elles sont parties. On leur a dit « bon vent ! », elles ont abandonné le pays natal. Elles abordent, muettes. Inertes. Plus de sensations. Plus de sentiments. Plus d’âme. Rien. Un canapé, et sans coussins, usé par des générations de chats et de fesses, du reps couleur de sang caillé, triste repos des guerrières.
– L’énigme reste entière : un serpent orne leur cuirasse, il y a des yeux, des lèvres, un nez. Il se love ici peu après le naufrage, il voit, respire, lui seul reconnaît l’odeur de la vie. Elles, pupilles dilatées comptent les poutres du plafond, les toiles d’araignée. Couchées, tête-bêche, elles blasphèment. Dans l’ordre : la terre natale, la terre silencieuse, Maman, l’ardeur des combats, la justice, le scintillement des étoiles, le lit conjugal. Et voici que leur armure s’aimante, qu’elles attirent les regards, les doigts. Elles ont un sexe. Voici qu’elles séduisent. Entre la vie et la mort, il se passe quelque chose dont l’énigme reste entière, entre la force des vagues et le bris de la terre, entre la cuirasse et la peau…
– Falbalas ! Roides. Quasi romanes. Pompéiennes. Vésuviennes. Les fumerolles ont refroidi. Jetées sur un méchant tissu, les statues sont furibondes d’avoir été exhumées, envoyées sur les roses.
– Sous. Sous les roses. Et le grand bal des roses, leurs tourbillons et leurs corolles.
Ici, baisser la lumière. Le crépuscule rejoint le visage des gisantes. Le crépuscule les maquille.
La lumière baisse encore. Une narine palpite.
On peut également préférer l’aube : une clarté soudaine inonde les corps qui tressaillent.
(12 mars 1997)
L’ODEUR DES VIOLETTES
1 – LE JOUR
L’odeur des violettes sied aux femmes. On ouvre la fenêtre, elles escaladent les murs. Il y a des violettes entre les pierres. Sans les violettes elles n’entreraient pas dans la maison. Il y aussi un parfum de vanille – les pierres chauffées par le soleil de mars et les violettes qui poussent entre les pierres ? Le cou des femmes, oui. Elles portent des cœurs à la taille et s’arrêtent au mitan d’une paroi. Elles courent un bon moment. Elles s’arrêtent à nouveau. Elles regardent ce qui se passe dans la maison : non par curiosité, simplement pour voir – grands yeux grands ouverts. Puis elles s’asseyent dans les embrasures. Ainsi elles peuvent s’envoler. Ou recevoir des caresses. Elles peuvent s’envoler avant ou après ou pendant les caresses. Ce sont des femmes silencieuses, ceci expliquant presque cela surtout quand elles marchent si vite dans l’odeur des violettes, cherchant l’endroit exact où leur peau accroche le mieux la lumière – leur peau tantôt brillante, tantôt sablée -, là, précisément sur le mur ouest battu par le chant des mésanges. Du talon, elles apprécient la qualité de la muraille. Du regard elles tâtent le ciel. Elles sautent à terre, souples et droites, livrées à l’espace d’une pièce de la maison. La pièce est nue et ronde. C’est un lieu propice à l’odeur des violettes de mars, accueillant aux longues jambes, aux poitrines menues, aux hanches, aux becs de piafs.
– Mais aux souffrances ? demandent-elles.
– Mais aux souffrances, répondent les pierres.
– Mais aux douleurs ?
– Mais oui.
– Mais aux plaisirs ?
– Aux prières ?
– Oui oui, aux prières debout.
– Aux péchés capitaux ?
– En bloc.
Alors les femmes sourient. Elles frissonnent. Leur peau sent de plus en plus la violette. Elles éclatent de rire. Le soleil, vous savez bien, l’eau mordorée, tout ce qui tangue au printemps précoce, l’ourlet des lèvres, l’impatience de la patience, l’épiderme émaillé d’un rêve, et les doigts précis, fins et fluides comme l’argile, chauds à cœur comme un four.
2 – MADAME MARGUERITE ET LE FAUTEUIL BORDEAUX
A seize heures Madame Marguerite découvre le fauteuil bordeaux. Quelle différence y-a-t-il entre une pervenche et une mésange ? Juste avant de s’asseoir, telle était la question. Admettons que c’est pareil. Elle essaye de se caler dans le siège faussement Louis XIV. Elle se contentera du bord. Mais, avec le poids du fessier, plus le tronc, le cou, les épaules, la tête et la cuirasse, cela ira : elle tient. Suffit de ne pas la bousculer. Ni chat, ni chien (l’horreur jappant) ; même un élégant cheval cabriolant serait malvenu. Je me tiens droite comme dans mon enfance, se dit-elle. Madame Marguerite ne par1e jamais de son enfance, pourtant elle en sait long – longs souvenirs qui la prennent au lasso (une liane d’ellébore par exemple. Aujourd’hui elle est une femme sur un fauteuil bordeaux. Le fauteuil lui a tendu les bras. Elle s’est assise, les bras lui sont tombés. L’ellébore passe pour guérir la folie. On croque de l’ellébore et on devient normale. L’ellébore est un produit toxique. J’en prendrai un doigt, seulement un doigt. Les pruniers sont en fleurs. L’ombre des pruniers se dessine sur la terre. Une ombre torturée. Privée de bras. Comment, sans bras, embrasser ? Elle veut dire prendre dans ses bras, étreindre, réconforter, chouchouter. La cuirasse, c’est la guerre. Tu enlaces, ôte ta cuirasse. Les bras ont été perdus au combat. Arrachés. Sectionnés. Ou pas mis du tout. On a oublié de lui poser les bras. Elle est née en état de guerre. Avec la colère chaque jour plus forte, le lait de la colère est devenu 1e sang de la colère, puis le sang a giclé à travers la peau, la laissant blanche. Une colère blanche de Madame Marguerite, tout le monde sait ce que cela signifie. Les membres absents font atrocement souffrir. Impossible de se déshabiller. L’armure colle à la peau. Les fleurs de prunier sont blanches. Elles ont l’odeur du miel mais en plus frais. Ceux qui traitent Madame Marguerite de Gorgone se trompent : plus ils la regardent, plus ELLE se change en pierre, là, sur le fauteuil bordeaux. Et c’est pour ELLE un moment intact. Elle fait peur. Tant mieux elle fait peur. On pourrait la casser. Elle pourrait tomber et se briser. Un mouvement des reins, ce serait vite fait bien fait. Madame Marguerite et ses contradictions. Les fenêtres sont fermées mais une porte qui claque et c’est la chute peut-être. Sans bras ni mains au bout l’ennemi est partout. Sans bras sans mains, sans doigts sans ongles, ça vient les ailes ?
3 – HÔTESSE DE L’AIR
Mon premier amour s’appelait Silvianne – avec un i -. Elle était hôtesse de l’air sur les lignes africaines. Jamais je n’aurais imaginé la retrouver ici, son joli cou penché vers la lumière. Elle n’a pas changé. Sa poitrine est intacte, menue, pleine d’un charme qui s’accorde à son tendre regard. Elle n’a pas changé – à première vue -. Car Silvianne a perdu les bras. – Votre amour, votre premier amour a perdu les bras et ça ne vous saute pas aux yeux ? – C’est qu’elle semble vivre sans. Elle se tient bien. Silvianne, que j’ai connue sur les bancs du lycée, s’est toujours très bien tenue. Après, elle est devenue mannequin, avant elle était l’amante de son professeur de philosophie ; après ce parcours initiatique, elle est entrée à l’école des hôtesses de l’air parce qu’elle se tenait bien, naturellement bien. Son maintien était son atout. J’étais vraiment très amoureux d’elle. Je me demande si je ne le suis pas toujours. Qu’elle soit dépourvue de bras ne me gêne pas. Je suis peut-être même à nouveau amoureux parce qu’elle est privée de bras. Non que cela m’excite – je ne suis pas pervers -, mais une femme sans bras, un homme peut la protéger, la tourner, la retourner sans problèmes majeurs. C’est fou : Silvianne n’a pas vieilli. Silvianne est intemporelle. Silvianne est éternelle… Je lui offrais souvent des narcisses, à cause de son regard interrogateur. Jamais elle ne m’a demandé : pourquoi des narcisses (ou pourquoi le coin du feu, pourquoi le creux du cosy). Non : le regard interrogateur, le cou penché, la jeunesse, cette attirance pour la lumière venue d’ailleurs, l’envol vers Bamako, l’escale d’Antsirabé dont elle avait ramené un maki makako, l’atterrissage ici des années plus tard, sa peau si douce sur une chaise berbère, son gilet ouvert sur des seins gourmets, tout en elle est mystère, les hommes aiment le mystère mystérieux, le silence et le « rêve de pierre ». Les hommes aiment les pierres. Les hommes aiment rêver. Les hommes aiment les hôtesses de l’air dont les bras ont déserté. Patatrac. Sans parachute. Ou le fauteuil éjectable n’a pas fonctionné ? Comme d’habitude, Silvianne demeure muette.
C’est là que Madame Marguerite intervient. Un bon moment qu’elle était aux aguets. – Et je t’aime et je te retrouve, rien n’a changé entre nous, le maki makako est toujours frétillant ! Ma fille, lance-t-elle à Silvianne, ma fille, tu t’es encore fait avoir. Là-dessus, Madame Marguerite pousse un cri. Il est onze heures trente-sept. Le cri atteint Silvianne en même temps qu’une lueur délicatement ocrée lui cerne le torse. Le cri, donc, ricoche, tourbillonne. Silvianne penche la tête, ses macarons oscillent : le cri en profite et se love à la jointure du cou et de l’épaule (un endroit fameux pour les baisers). C’est l’instant précis où Silvianne se tient moins bien. – Toi aussi tu as perdu tes bras ? lance Madame Marguerite. Silvianne ne répond pas. Son cou la démange. Si elle possédait ne serait-ce qu’un seul bras, elle se gratterait et elle découvrirait ceci : une tête d’homme, petite mais d’homme, fichée où le cri s’est posé.
(4, 5, 6 mars 1997)
SHÉHÉRAZADE

Sa langue fourchue, d’hôpital, face aux messieurs, dont le veuf (manteau de feutre noir, croisé sur un ventre maigre, licol). Ses ultimes volontés, farouches, que tous écoutent au Théâtre d’Empoignes. Donc, dans son pieu de cantatrice, face aux fistons, leur tête sur le velours lie-de-vin des sièges râpés, chéris auxquels elle se confie une dernière fois. “Après moi, ferez ce que vous voudrez. Mais je veux ceci. Cela.” Elle dit ainsi pour abréger : la famille connaît le code sur le bout des lèvres, qui fera ceci, qui cela. Le soleil de mars accroche la gaze répandue sur le lit. Dehors, jonquilles, violettes. Un torrent coule de sa gorge, plus large chaque fois qu’elle l’ouvre. Ruisseau rouge, à moins qu’il ne s’agisse de sa chère vieille écharpe. On lui a relevé le crâne : on la voit depuis l’autre bout du salon – si elle dort, elle surplombera son monde. Ce matelas où elle a traîné ses amants, dormi vierge sous les poutres couleur de suie. Son portrait d’elle enfant toujours au-dessus du lit. Elle donnera encore des ordres. Excepté le veuf, les fistons écoutent son discours (“la force, pour continuer à vivre quand elle n’y sera plus”). La maudite leur ordonne de se battre : demeurer fidèle à sa mémoire, raconter des faits à la hauteur des nuits où elle les engendra, coït après coït. Elle disparaît, les fleurettes poussent aux pruniers. Ils essaieront de l’oublier, croiront y parvenir. Elle reviendra heurter son crâne aux leurs, tant que la terre ne les aura pas cuits et gelés. Pas de résurrection. Ils sont de la même terre qu’elle, ça peut les consoler, triturés par la chtouille, rouillés par la peur. Elle leur a coupé la tête pour les tenir à sa botte, avec une compassion qu’ils ne peuvent concevoir. Le pivert cognera leur front à coups redoublés. Son bec martèlera leurs orbites, y compris celles du veuf, tant qu’ils ne seront pas réduits en poudre.
Le soleil s’agite. La nuit. Au matin sa tête s’amenuise. La gaze vire au gris. Rouge sang caillé. Plus de souffle. Lèvres ouvertes, sans proférer. Ses yeux ne dardent plus. Les fistons n’y voient goutte (hors les plis d’une gaze déchirée), pauvres canards. Sauf le veuf, casqué, tronche en visière, tenu raide par son manteau. Le chagrin d’amour les a réunis, comme en classe on zieute sous les jupes de la maîtresse. Le veuf prend la parole, veut la prendre, la prend pas. Se fera taper sur les doigts. Il songe boutons de rose, bourgeons de frêne, iris précoces, sexe de Shéhérazade (ce manteau noir qui l’enveloppe quand la chatte ramène au foyer une taupe). Songe à la convocation – “d’extrême urgence – Shéhérazade – plumard”. Bien dans ses manières. Vitriol, porosité. Une veillée. Que du languide. Rose aux joues de Shéhérazade – coup de sang -. Du traversin, elle l’inspecte. Il dort, tête basculée. Double menton à vif sur le col du manteau. Pas pu tenir jusqu’au bout. Doit ronfler. Mort peut-être. Lui aussi : de la terre qu’elle modèle. Veuf – Outragé ? Outré ? – abusif. Les crânes des fistons, invisibles depuis les draps, au théâtre pas neuf. On vit comme on meurt : répétition. On redresse l’argile, on l’adosse, on l’arme, on le sèche, on le cuit, il se fend.
(27 mars 1998)
LES AMOUREUX
…Elle l’avait emmené au jardin – un jardin clos de hautes voûtes à la manière d’un cloître, sauf qu’ici les voûtes abritaient quantité de magasins de luxe, quelques restaurants et l’entrée d’un théâtre. Le jardin, lui, gardait sa sévérité : un enclos de buis et de rosiers où l’eau jaillissait d’un bassin circulaire entouré de chaises vertes. L’orme de jadis, au tronc énorme et creux, habillé d’un fouillis de lierre avait été abattu, les kiosques où l’on vendait sucreries et cerceaux avaient disparu, mais il s’agissait bien du même jardin – celui de l’enfance où il promenait son chat siamois tenu en laisse, et le voilier à coque rouge largué sur le bassin, celui, plus tard, de ses amourettes (il y attendit des heures la fille à longue tresse qui posait des lapins)… Elle était donc là, tenant sa main, joyeuse et volubile. Le mois de mai était joli et le souvenir de leurs premiers baisers, de leurs premières étreintes si vivace qu’il leur suffisait de se tourner l’un vers l’autre pour que leurs âmes se rencontrent – un contact doux et fugace, juste rogné par leur prochaine séparation : elle devait partir, c’était inéluctable et, pour lui, d’une parfaite abstraction. Le cœur de ce chagrin à venir saignait déjà, à l’instar des cœurs christiques des églises rococo où elle aimait s’asseoir, lui caresser les doigts et, brusquement, au moment où l’orgue tonnait, l’attirer, lui mordiller les lèvres… De lents nuages gris pâle s’étiraient dans le ciel et le jardin s’animait : la sortie des bureaux et des ministères jetait dans les allées, au milieu d’une poussière soudaine, une petite foule sautillante – des livraisons saccadées, un genre de film muet dont les séquences s’affolaient puis viraient au ralenti. « Ils ont le hoquet », disait-elle en passant la main dans ses cheveux, exactement comme elle l’avait fait dans la soupente, avant d’ôter son chemisier vert, d’attirer son visage entre ses seins. Il gardait la sensation de cette peau mate, embuée de sueur – comme celle de ses yeux aux paillettes tilleul, infiniment proches, le pointillisme de l’iris, le tremblement qui les avaient saisis et, soudain, les coups de plus en plus violents contre la porte, la voix de l’homme, de plus en plus forte. « Je sais que tu es là ! ». Il criait qu’on devait lui ouvrir, qu’il savait qu’elle n’était pas seule. Elle avait posé la main contre sa bouche, le temps que l’homme abandonne. Ils avaient entendu ses pas décroître dans le couloir puis s’étaient rhabillés. Elle lui avait expliqué que cet homme l’avait d’abord aidée dans sa solitude. Maintenant, il la harcelait. Comment le persuader que c’était fini, il ne voulait rien comprendre. Elle ne l’aimait pas, c’est tout… Le jardin, maintenant, retrouvait son quant-à-soi : les passants s’estompaient, les globes s’allumaient sous la voussure des arcades, une lumière jaune sale, d’un autre temps – celui, presque, des becs de gaz. Les vitrines émettaient des halos blancs et, du côté du théâtre, le rouge d’un néon clignotait avant de se stabiliser, affichant le titre d’une pièce et, sans doute, les noms de l’auteur, du metteur en scène – mais, d’où ils étaient, ils ne pouvaient déchiffrer qu’une suite de signaux plus mystérieux que le titre de la pièce de boulevard, spécialité du lieu. Main dans la main, ils en avaient longé le foyer, garni de velours cramoisis et de lustres à pendeloques – encore éteints, en sorte qu’il semblait l’antichambre d’un bordel 1900 et dont les cendriers, perchés sur des pieds d’inox, débordaient de mégots.
L’ADIEU AU CRÉTOIS
Flash. Moi. Arc-bouté au volet Résistance. Pénombre. Flash. Rompue. Battant gauche ; ça vient. M’apercevoir, baissé, cassé, saisi par l’objectif. Spatule, ébauchoir, couteau avec manche plastique, bâton magique, heureusement que Martine est là. Me voir, forçant le bois humide ! Grince sur le carrelage. Je m’agrippe. Persienne. L’ouverture. Ligne bleue, verticale, d’éclat : réverbération, adoucie (l’automne), encore violente, dans la maison du Crétois. Balcon. En face, ce fut consulat italien, boîte sélect de nos jours. A gauche, la mer. L’angle de la rue. Perforation. Rade. La ville, en courbe. Au fin fond, blanc laiteux. Amas de rochers au premier plan. Entrés dans la maison par l’arrière ? Ou par la façade décrépie : coulures, barre d’acier. Rouille, dénudée, au dessus fenêtre droite. Du jardin – huit mètres sur cinquante, pente douce, jetée vers la montagne – ne reste pas figuier, aucun olivier. L’herbe est sous gravats blanchâtres, qui butent sur une route, en haut, sur le béton : immeuble, médiocre l’immeuble, pas fini. C’est la mer qui prime. Ecran. Avec, derrière la maison, l’hibiscus. L’odeur. Celle de la mer. La maison ne sent pas le moisi. Les nippes, les meubles entassés tiennent le coup. Même si tout a valdingué. C’est la valdingue. Le décès. Terrain vague. Il y avait une treille. Les figues noires grosses comme le poing : du miel. Une camionnette campe. La maison, très petit labyrinthe, tuiles déchaussées, que jouxte une citerne poupette. Cube. Une pièce côté rue ; derrière, la cuisine, côté jardin, avec évier en marbre blanc, brut. Gros bac. Le couloir, bref. A l’extrémité l’escalier. A sa droite une pièce, toujours côté rue ; derrière, chambre, avec deux planches en étagère, fatras, livres de poche. Disposition identique à l’étage. Six enfants, les parents. Atelier de couture de mère-grand de moi. Antre du chausseur – père-grand de moi, souliers sur mesure. Leurs enfants tous nés là. Quelle chambre ? Nicolas, Antoine, Agapie, Hélène, Elie. Et petite Madeleine, venue mourir à Paris (si fort, le chagrin du Crétois-grand : muet un an, sauf les sanglots, dès qu’il ouvrait, la bouche, et ses cheveux : blancs, d’une nuit). Et les orangers ? Une maison ouverte. Clientes de mère-grand, leurs robes ; odeur des cuirs. Tous essayages. Marins, oncle-grand, œil de verre qu’il ôte, dandy, Français. Ah plaisir des gosses. Spatule, ébauchoir, couteau avec manche plastique, bâton magique, heureusement que Martine est là : a trouvé trace ancêtres : deux figurines – photos noir et blanc, vingtaine de centimètres, sur contreplaqué, collées, découpé : silhouettes. Guignol. Karageorgis. Chanfrein biseauté vers l’arrière en sorte que les silhouettes : une feuille ! Presque. Deux enfants sages, fille, gars, debout, cinq sept ans. Pas identifiables ? Mais les regards, un air de famille. Paraît que la maison risque de s’effondrer – enfin la façade sur mer, plus attaquée. Atmosphère saline, qui laisse des briques à vif, sans enduit, l’écaille. Moi j’en crois rien. Qui fabriqua figurines ? Ultimes habitants? Maria, la Hongroise (dansait czarda sur les tables) ? Antoine, mari. Comptable : ça détoure un portrait. Heureusement que Martine est là : elle a découvert une poupée : paysanne crétoise, fagot sur ses épaules. Du plastique qui ressemble à du bois. On entend peu la mer pourtant si proche, là, portée de mains. Mais l’iode ! Lustres 1930, guingois, sur carrelage. Photo militaire, encadrée : genre chasseur alpin – enfin ce grand béret -, par terre, sous vitre. A la guerre de 14, le Crétois avait sept ans. Une seule fleur d’hibiscus à l’extrémité du jardin. La voisine offre une fleur à Martine. Cette fleur à la chair blanche, élastique, genre poulpe. Je me dis : nous sommes dans le ventre du poulpe. Nous a pieuvrés – à l’escale de Naples ? Au détour du Vésuve ? Hôtesses déglinguées d’Olympic Airways. Le calamar gobe, Boeing clique sec : découpage des côtes, Méditerranée courbe. Masses : ciel et d’eau. Limbes. Viol. Les moutonnements, les flocons. Iles grises, claires, sèches. Gargouillis hellènes du pilote dans carlingue, bouffées par haut-parleurs. C’est là, sans doute là : la maison mangée par la nuit. Enfin, presque sûr. Fenêtre de l’Hôtel Halepa, l’ancien consulat anglais. Le Crétois en parlait. Fenêtre chambre 217 (two, one, seven à la réception) : sur le jardin de la maison, l’arrière de la maison coiffé de sa citerne. Toute petite maison. Toute petite demeure. Fragile. C’est le berceau, livré par la fenêtre. Hasard ? Demain on vérifiera. Flacon de tsikoudia, deux verres sur une tablette. Nouveau Testament dans tiroir table de nuit. Un coin de mer, palmiers de villas cossues. Tout cela, mon cœur, doux-amer. C’était bien la maison. Bien la maison. Deux hommes, ouvriers du dimanche, sur le toit de cette maison ? Ou plutôt : celle d’à côté ? Deux couvreurs – charpente à neuf : tiges de bois blanc, serrées. Ici pas de neige. Un palmier hirsute, taillé en hauteur : douzaine de palmes en plumeau. Plus rien dans le jardin, sauf : chien-loup avec adolescent, sauf voiture rouge. Puis la mer, grise, avec nuages, récifs à fleur, poteau électrique en béton au centre de la vue, depuis le balconnet. Le jardin : piste, route de montagne, branchages morts jetés de part et d’autre. Bloc d’arbres sans feuilles. Murets de pierre sèche. En bas, près de la maison, tas de sable, près d’une cahute en béton ; un rez-de-chaussée pas fini. Seaux en plastique bleu, fragment de bâche noire. A l’horizon, volets peints en marron, sur l’arrière de la maison. Aucune photo du Crétois enfant. De près, la maison semble plus grande. En sorte que : comment l’imaginer courant, le Crétois ? Farfadet. Enfin, pas facile tout ça. Pas facile. Depuis la fenêtre de l’hôtel, pensé que les couvreurs refont la toiture de la maison. Donc occupée par d’autres ? Non : la maison est celle d’à côté, avec décrochement sur le flanc, la ruelle à bougainvillées – branches jaillies, cognent à la fenêtre du premier (miniature d’auvent en zinc). Guirlandes de bougainvillée surmontées d’un câble électrique, entrelaçant d’autres fils, électriques ou téléphone, courant sur façade – jusqu’au compteur enfoncé dans la niche, à gauche de la porte -, l’escaladant, sous le balcon, bifurquant à angle plus ou moins droit, vers l’angle opposé, ou se fichant à mi- hauteur de la fenêtre droite, premier étage. Le Crétois mangeait sous les figuiers. Des fruits beaucoup plus noirs, sucrés, que partout ailleurs. Bus un verre d’eau chez la voisine. Moi ému. Heureusement que Martine est là. Spatule, ébauchoir, couteau avec manche plastique, bâton magique. Enfin je sais pas si je suis chez moi, si c’est ma maison, un bout, une parcelle du rejeton. Me sens chez moi. Enfin je suis pas seul. On se tient compagnie dans tous ces meubles renversés. Matelas à fleurs jaunes sur la tranche. Les chaises un peu danoises. « Les coquelicots » de Monet sur l’étagère. Les lustres, au sol : peut-être des primes années du siècle. Et c’est pas sûr. Les quatre fenêtres de la façade, rapetissées. A l’origine hautes, plutôt étroites – identiques à celle du balcon. Les traces sous l’enduit jaunasse. Même le béton, le rebouchage. Ou il faudrait – je sais pas, sous le ciel gris bleu d’avant l’orage (s’abat deux heures après), il faudrait : se glisser entre les doigts du Crétois, les écarter, écarter les doigts fins, parcheminés du Crétois (que l’infirmière caresse, adieu, débranche la perfusion caduque, bénie soit-elle de l’adieu cette parque). Fleur si drue, si blanche entre les doigts de Martine. Voix du Crétois à sa source. Petit soldat avec fusil en bois, uniforme sur mesure. Toujours se battre dans la vie. Lancer cailloux. Garnement. Chenapan. Sommé d’aller en ville acheter du pain, du tabac, la nuit. Passer par les chemins comme une forêt. Pas d’éclairage. Enfin, je sais pas trop. Ou à dos d’âne, monter dans les montagnes vers la vigne du papa-grand, combien d’heures ? Écarter les doigts encore souples, tièdes. Il regardait : parapet du rivage, récifs, ville au lointain, navire qui passe. Arbres drus, citerne rouillée. Vilaines moisissures sur le crâne, les mains. Voilà. Je sais pas où aller. Sauf vers Martine : le mouvement intérieur, sans qu’on regarde autre chose que ce lointain. Saisit la gorge. Comme ce balcon frêle où j’ose monter, à peine. Normal avec toute cette mer de partir outre-mer. Au mur, proche fenêtre brune, volets clos, minuscule reproduction. Coquelicots de Monet, comme chez paysans. Murs vides, blanchis, une seule image. Bout de coussin à rayures vertes. Deux radiateurs à bain d’huile – l’un vert amande, l’autre crème, collés, joue à joue. Au mur, une écaille : petit visage hurlant. De chaque côté de la fenêtre (six carreaux ouvrants, imposte en haut, deux vitres), crochet miniature, pour tenir ouverts les vantaux. Quelques salissures de pluie à l’aplomb du vantail gauche. Négligeable. Embarquement : baie de Souda. Sur les cartes, les navires suivent le pointillé jusqu’au Pirée (157 miles nautiques). Après : Marseille. Après : Saint-Etienne. Après : Paris. Sur l’étagère (dessous polars) : deux femmes dans un champ, coquelicots, toujours Monet, la reproduction, dans l’angle que l’étagère fait avec le mur du fond. La poupée crétoise regarde le champ. Les figurines d’enfants découpent le mur blanc. Dessous, un tissu émeraude enveloppe des oreillers. Chaises et tablette à pieds métalliques dorés (laiton ?) renversée, posée sur son plateau. Fourbis. Ecume frétillante sur les vagues bleues au large, puis une barre jaune où les lames se rompent. Remous gris avec mousse blanche, le sable du rivage (particules acier avec reflets blonds) où Martine esquisse menuet. Ou bien la rade, d’encre, presque lisse, frisottée sous nuées d’orage. La poupée crétoise : bras en plastique, qui semblent en cire. Les jambes, engoncées de toile bise, font bloc avec les chaussures peintes en noir, à même le coton. Tablier de feutre noir, brodée de festons roses, jaunes paille, rouges. Sur le visage, coque en plastique couverte de coton, rides noires, peintes, les sourcils en blanc, les cils en noir. Yeux noirs, soulignés bleu blanc. Houppe de cheveux blancs en hydrophile s’échappe d’un fichu à impressions noires, vert émeraude, bleu nuit, noué serré autour du cou. Pommettes très rouges. Regard triste. Petite bouche violette. Tablier grossièrement noué à la taille, par dessus une robe verte qui s’évase jusqu’à mi mollets. Manche gauche descend jusqu’au poignet. La droite, tirée à mi bras par un lien de coton blanc. Enserrant les épaules à l’aisselle, colle contre la nuque un fagot de brindilles. Poussière grise dans plis robe, surtout sur la poitrine, bien développée. Un liserai brodé jaune, du fichu au ventre. Boutons : deux paillettes pourpres, fixées au liserai par un clou, dont l’un, tordu, dépasse. Nez liliput. De profil, tête joufflue genre bébé. Enfin – à la fin : la veille du dernier matin -, le Crétois, dopé à la cortisone, remontait l’arbre généalogique, dans les montagnes, village (lequel ?), cousins-grands, oncles-grands, descendus pour la guerre (Turcs, Bulgares, Boches). Lignée de baïonnettes et de vignerons. L’âne cahote dans les sentiers. Je sais pas trop qui est qui. L’annuaire de Chania regorge de comme moi-presque… Tous descendus des montagnes pour faire quoi, ici ou : France, States ? Du côté du papa du Crétois, du Crétois de la mère, de la mère du Crétois, mère de mère. J’aurais dû noter prénoms, noms, sites. Sans compter les vieux amis, comme dans un moulin dans la maison. Pierres de la montagne, massif cristallin. Pas pu noter : l’émotion devant la pupille soudain brillante. Peur de l’excès. Crétois soudain redressé, gestes des bras. Attend, je dis, attend je vais t’enregistrer demain, tous ces noms : moi je m’y perds. Spatule, Ebauchoir. Heureusement que Martine est là. Couteau avec manche plastique. Bâton magique. Sans elle je serais pas là. Ou volte-face. Nous voici en reportage. Ou alors triste à. Si j’y repense, ces figurines, piquées d’humidité (la fille surtout), chiures de mouche, en bois gondolé. La chaleur du pays. L’humidité. Salinité, Entassement. Les jours comptent pas plus que les ans. Pays de fouilles. Labyrinthe. La fillette : peut-être remise des prix ? Livre sous aisselle gauche. Gants blancs beaucoup trop grands. Robette blanche. Guiboles hautes, minces. Chaussettes blanches. Bon regard. Le gant des ancêtres. Tourterelles dans les palmiers. Quelques tuiles envolées en bordure. Rien de méchant. Les aïeux peuvent revenir. Chania, Le Pirée, Marseille, Saint-Etienne, Paris. Jamais revenus. Enterrés à La Rochelle. Le Crétois en Ardèche. Revenu trois fois. Le rejeton du Crétois (moi-da), séjour in extremis. Heureusement que Martine est là. Ici, ça sent bon. Même en hiver ça sent bon. Le visage du Crétois est froid. Se recroqueville. Impossible à dessiner. Beau profil. L’amour ne fait pas le trait. Plan de la maison du Crétois. Du Crétois et mère du Crétois. Plutôt du côté de la mère successivement s’entend. Enfin c’est loin tout ça, loin. Témoins les murs. Crétois dormeur sur terrasse. Pas vu terrasse – toit en terrasse ? Soirs d’été sur la terrasse. La mer. L’odeur salée. Odeurs humaines. Grappes de raisin, énormes, poissées de sucre. Oui : lauriers roses avril. Défilés de soldats des grandes puissances. England, tsars, France, Italiens (toujours se méfier des Romains). Casernes. Consulats. Canonnières au lointain. Ciel bleu. Discours du Prince Georges. L’Ottoman recule. Fiers capetans. Souvenirs entrent et sortent. Je serais tenté d’interpréter, moi. La figurine du garçon sept huit ans, c’est le Crétois. Pratique pour retrouvailles. Campé, mains aux hanches. Fier. Rien à reprocher. Mais les doigts boudinés ? Mais ils peuvent évoluer après puberté. Et si c’était le papa-grand ? Datation. Invention de la photo. Age du sujet. Rejet. Donc Crétois ? Mais alors en turc presque. Ce gilet imprimé à fleurs, très haut sous la poitrine. L’ample pantalon rejoignant là, très souple partout. Les grosses olives en bois, partout. En bracelets. Au ras de cuisse, et sous genoux. Et chevilles, poignets. Plus la coiffe, de mêmes fleurs. Avec la grande frange passant. Conquérant. Sourire. Œil vif. Ou un frère du Crétois ? Retournons les figurines. Heureusement que Martine est là. Spatule, ébauchoir, couteau avec manche plastique, bâton magique. Envers des figurines. Ces deux silhouettes dans la maison. Ou sur la tranche. La bougeotte. Pas une once d’entrailles. La merde. Chaos. Retour fenêtre Hôtel Halepa. Martine regarde. Photo de Martine regardant maison ancestrale. Ou la mer ? Ou ? Très beau profil. Spatule, ébauchoir, couteau manche plastique, bâton magique. Vers quelqu’un, incognito, le Crétois, me dis-je : elle regarde le Crétois qui vient d’ouvrir, juste, la fenêtre de la maisonnette. Soleil déjà chaud. Qu’ils disent ? C’est la présentation. Heureusement que Martine est là. « C’est beau les fleurs, soupire le Crétois ». Dernières jonquilles. On pourrait. Fenêtre de la chambre close. Lumière pastel sur profil. Spatule, ébauchoir, couteau manche plastique, bâton magique. Devait y avoir un olivier au moins dans le jardin. Centenaire. Amertume. Tous les ancêtres à l’ombre. Pas une photo de mariage. Trépassés d’outre-mer. Enfin Martine et moi avons pataugé dans les vagues. Tête contre tête contemplé le flux. Et grands ferries clapotant au large. Tout cela est assez complexe. Tous les vestiges. Enfin pas pire qu’ailleurs les kilomètres les guerres les naturalisations. Ici ce sont les tourterelles, les cheveux de Martine.
(Novembre 1998)
21 MARS
Trois ans depuis le ruisseau les encoches parfois la nuit, je lui dis dormir, rêver peut-être, je lui dis, je sens sa main, la paume, ronde – comme un cercle chaud, vif, doux, je dis, je lui dis, je te dis : trois ans, un souffle de trois ans, triple cercle, cerceau, je dis hoola-hop, triple comète, des sauts ainsi, des mots, le cours de terre, les bois à la chaîne, tiens -, ronde, je veux dire par là Ronde de nuit, non pas Rembrandt, non : ronde peau, la peau, le grain de peau, je touche sa fesse où elle joint la cuisse, c’est sa peau qui m’arrondit, comme c’est doux, je lui dis, tu roucoules dans la nuit, là c’est très doux, il y a des rêves pour toi ma chérie, là, lui-dis-je tandis qu’elle murmure dans le sommeil à demi-éveillée, là, cette nuit, veille du quatrième printemps, quatrième mars, on va pas compter, on souffle, ton souffle, voici qu’elle s’endort dans les fleurs du pyjama, lui compterais bien fleurette, j’ai des sensations muettes, les mots sont si fluets, ruisseau, ruissellement, le gué, un murmure lunaire, je me dis tu me parles d’où?
Oui toutes ces violettes entre les pierres, toutes ces violettes entre tes mains, à l’index, je lui dis violette, pervenche, coucou, tu es florale, scintillement, sombre et blanche, je te dis comme ci, les lèvres sur ton sein, ça va ? Où rêve-t-elle, dis-je, oiseaux de bois, ailes de tronçonneuse – non : plumes humides, terriennes, agiles céramiques, pierres, vent, tresse, long éclat, notre spirale lui dis-je, te dis-je, rides du soleil levant, la suie du merle idem, je te dis, paupières lourdes, ce que je touche alors, son ventre, ta courbe, je m’enfaille, un signal que tu dresses, tu, je, indifféremment, comment savoir, faudrait revenir la nuit, devenir nuit, ceinture des fesses, hop-là, vive sa géographie, galop aux chiffres secrets, je ronge des rives indéchiffrables, ton aisselle rasée, ce qui vient, une floraison, fleurette, juste une floraison, encore l’arc-au-ciel, suivons l’arc au ciel, flèche où je mords le grand océan, cheveux tendus, nerfs de mars, ton amour à baisers, son bras, terre de bois, c’est la forêt jonquille, sucrée, acide, forêt rivière, ta forêt sommeil, rêver peut-être, se referme, taillis d’où surgit sa nuque pommelée, brindilles, agitation de givre, chenilles processionnaires, poulain affalé – partout, ailleurs, en toi, éparpillé volume lèvres de Mars.
(21 mars 2000)
L’APPROCHE DES MORTS
A l’approche de la Toussaint, chacun raconte une brève histoire à sa façon. Histoire du mort qui tire la langue. Du mort qui rit encore. Du défoncé. Du binôme. De l’enfeuillée. Du cirque Anal. De Monsieur Moustache. De Mademoiselle Fièvre quand elle atteint le quota. De Philippe-Auguste. Mais la plus belle histoire n’est-elle pas celle du gisant ? Tout en pierre ponce, en pierre donc – mais léger : un atout dans la cathédrale. De nos jours, un gisant ? Et cette absence d’humidité. Histoire du silence. Et celle du grand nuage. Connaissez-vous ? Qu’en feriez-vous ? Histoire des tempes. De la taupe. Et la houppette de Suzette ! Histoire du riz. C’était le temps des stories boards, de la bombe H. Histoire du drap large. De l’infinie boule. Histoire du Narcisse myope. Du thé avec le millefeuilles et la poitrine nue de Miss Wagonne (plusieurs épisodes). Histoire du petit pigiste. De la dépravation autrichienne. Navigation suprême (histoire drôle et métaphysique). Histoire de la maquette des illusions. Histoire vierge. Histoire du caisson hyperbare. Des ploutocrates. Romantique histoire de la désespérance réduite. Et histoire champêtre. Histoire de la pipe ratée (érection avant). Histoire du rat. Histoire du lavage de cerceau. Du vent du nord. Du lapin écrasé. Histoire du préraphaélisme. Histoire du régime sans celle (c-e-deux l-e), sans selle (s-e-deux l-e), sans sel (ni sucre). Histoire du crâne qui rit des dents. Du souffleur de bière. Du zénith. Du rimmel qui s’empâte. Histoire de la dernière histoire. Histoire du mur. Du maximum de minimum. Du bouche-trou. De la préhistoire. Résumons : histoires (au pluriel) de la tête cassée, des yeux clos, de la jambe cirée, du pied émaillé, plusieurs têtes, plusieurs mollets, plusieurs destinées. Le destin de l’Histoire. Histoire écrite. Enfin une histoire vraie. Résumé : faut pas mourir, idiot ! Hustoire drôle. H comme histoire. Celle-là qui plonge, qui farfouille. Histoire de. De ? Deux doigts ? De saxe. Klaxon ? De caleçon ? Histoire de rave. Du fripouillis. Frangipane. Histoire du trac. Et celle du rat de l’eau. Celle qui coule. De rouille. Du crime qui ne paie pas. Des amours célèbres. Du fourrage. Résumé de l’histoire suivante.
THÉRÈSE D’AVILA, UNE RENCONTRE
A 8 h 30 ce jour-là, jour de la sainte Thérèse d’Avila, le coq a chanté trois fois. Georges aurait aimé connaître Thérèse d’Avila. Il serait resté muet de terreur et d’incompréhension. Elle l’aurait quand même béni du bout de ses longs doigts muets et fins. L’âme, à tout hasard, on ne sait jamais ? Puis il aurait perçu ce murmure de la glotte (un exercice de style mystique ?). Il aurait alors reculé, le plus discrètement possible, jusqu’à franchir le seuil, avant de se réfugier dans la chair élastique de son amoureuse – cette peau si suave, oubliée, les seins oubliés. Tout oublié, comprenez-vous ? Le décor seul résiste, les meubles, le lit, la couleur des couvertures, la vague allure de l’aimée. Si le coq chante trois fois, ce n’est pas en vain ou pour chanter la naissance de l’aube mais pour célébrer la traversée des êtres connus, ceux d’hier ou d’avant-hier : un flux incessant qui traverse son crâne – l’imbrication, l’entortillement de larges fleuves et de ruisselets, leurs enlacements parcourus de soubresauts, de clapotis, d’implosions silencieuses. Sa mémoire, immédiate ou lointaine, est silencieuse, sournoise. Un monstre subaquatique, tantôt agile, tantôt languide, garni de ventouses, agrippant – selon quelles fantaisies ? – des épaves envasées avant de les relâcher. La succion, d’étonnants baisers pour rien, des flashs incolores. Des saccades. Les êtres, aimés ou simplement croisés, sautant à cloche-pied pour une marelle désordonnée – le brouillon d’un jeu sans but ni vainqueur dans une cour de récréation aux murailles gangrénées, enduites de salpêtre, de balafres grises et noires (quelque chose des pixels d’écran d’ordinateur, mais secoués par le vent d’automne, porteurs de feuilles chues, grasses et poisseuses, imprégnées des nouvelles du monde, drames, attentats, expulsions, noyades, défilés de mannequins et mariages royaux)… Quand Georges revenait à Thérèse d’Avila, à la ville close de murailles et de couvents peinte par El Greco, au crucifix atone pendu au dessus du lit de la sainte, il lui semblait entrevoir la surface interne d’une voûte crânienne ensanglantée : granulation, crochets, intersections, nervures, zones, coagulations – quel cerveau s’est projeté ici ? L’impact de quelle masse cérébrale ? Quel château des angoisses ? Quelles méditations sur la mort ?… Une fameuse tambouille en tout cas. La soupe est le support du rêve, pensait-il. Il suffisait de fermer les yeux pour que le coq – un Brahma géant aux pattes monstrueusement emplumées de blanc – vrille à nouveau ses oreilles… Ce qu’il lui fallait désormais, c’était du silence, un travail laborieux et utile, par exemple trier les lentilles (« L’intimité c’est comme les lentilles, celles de jadis, qu’il fallait trier : une petite pierre, d’un coup, jaillissait sous le doigt, dure et minuscule mémoire du champ des origines. Une pierre, quasiment philosophale, à poser dans le jardin secret. »). Et puis cela le rapprocherait de Thérèse et de son chapelet… « Longuement, faire tremper les lentilles, une nuit s’il faut – à moins que vous ne préfériez manger des pierres. Si tel est votre souhait : à vos risques et périls !… » Georges s’était pris à rire – voilà qu’il citait Corneille et le Cid : À vaincre sans péril on triomphe sans gloire. Pédant, va !… Il inventerait la prière perpétuelle ès lentilles où chaque dizaine serait une pierrette bien grenue. Il porterait le chapelet à Thérèse qui le bénirait – avait-elle le sens de l’humour ? Assurément. Et, tandis que les lentilles fileraient entre ses doigts, les femmes de sa vie resurgiraient, lumineuses, rajeunies de trente ans, et lui, comme sur un trampoline, rebondirait de songe en songe, de moins en moins haut certes, jusqu’au réveil. Ce discret viatique accompagnerait la neige qui, à l’aube, aurait saupoudré les arbres, l’herbe. « Vous rêviez comme un flocon ? Vous portiez leur intacte beauté et leurs ruses. Et cette houppette en cils de cygne offerte à votre épouse, plumetis impalpable – d’un souffle, elle s’anime, vibratile ; un nuage poudre de riz de Java… Était-ce cela l’étoffe du rêve, sa doublure amovible, sa mue ? »… La pierre engendre la plume, le Brahma s’égosille, le crépuscule est là ; une harde de sangliers escaladerait la colline – quinze, en file indienne, au trot, étonnamment silencieux, agiles. Les gros en tête, les autres, de plus en plus petits, suivraient. Une dizaine de secondes d’un défilé gris tandis qu’au loin décamperait un chat noir. Les montagnes, à l’horizon, seraient balafrées de neige. Le paysage deviendrait sauvage, haché, zébré. Le froid roulerait de là-haut – rouleau compresseur invisible. « Oui, mon fils, dirait Thérèse, la nature est violente, son désordre implacable. Les taches d’automne sont des peaux écorchées, attaquées, spongieuses. Un monde hostile, dévoreur, immobile. Nous voici accouplés au froid, mon fils. Et nous formons d’étranges cristaux. Mais notre pensée, en dépit des frissons qui nous tourmentent, notre pensée est-elle froide, froide à jamais, ou seulement frileuse ? »… « Mon fils » ! Sainte-Thérèse d’Avila l’avait appelé mon fils (fallait-il l’entendre avec un F majuscule, comme on dit « Mon Père », « Notre Père qui êtes aux cieux ? ») ! Ou s’agissait-il d’une simple familiarité – la différence d’âge autoriserait cet impromptu. Le cœur de Georges battrait la chamade… Mais déjà, la Sainte se détournerait de lui : couchée en chien de fusil, elle feuilletait un livre à grand bruit, un livre qu’elle tenait serré contre sa poitrine, ouvrait en soupirant, feuilletait puis refermait. S’agissait-il d’un recueil de prières ? Georges resterait là, debout, bras ballants, sans oser rien demander. Thérèse ne s’occupait plus de lui. Devait-il partir ? Comme toutes les femmes, elle le laissait en plan… La Sainte se retournerait vers lui : « Fiston, c’est un bouquin pour toi ». Elle lui tendrait le livre : « C’est ta vie, ta vie de A à Z, l’alpha et l’oméga, jusqu’au trépas et – qui sait ? – au-delà… Hic et nunc. File ! Je ne veux plus te voir. » Il saisirait le livre, plutôt léger en dépit d’une couverture en gros cuir, et s’en irait à reculons, esquissant des révérences, mais elle le rappellerait : « Attend ! Viens que je te bénisse. » Il se rapprocherait du lit et, à tout hasard, s’agenouillerait. La Sainte se mettrait à rire – un rire frémissant, ondulant (un rire en plume, du genre à voltiger vers les nues). Elle étendrait la main droite, accrocherait sa chemise, l’attirerait vers elle, lui baiserait les lèvres d’un baiser frêle et sec… Sainte, Sainte, trois fois Sainte, la fille d’Avila, le parfum suave et violent de sa bouche, lys, jasmin, violette – il l’emporterait avec lui, avec le livre qu’il n’ouvrirait jamais.
LA VENGEANCE DE LA MARIÉE
Longtemps après qu’ils se soient séparés, elle profita de son absence pour aller fouiller dans la grande armoire. Elle trouva sa robe de mariage, blanche et molletonnée, garnie d’un col rond de fausse hermine (les épousailles avaient eu lieu en plein hiver), elle la fourra dans un sac poubelle noir, l’emporta pour la jeter. Le léger voile en tulle échappa à ses recherches, et les chaussures blanches, vernies, à talons mi hauts – l’armoire était un grand bazar et la chambre bien sombre. Quand il lui demanda des explications, elle dit que la robe lui appartenait : elle en faisait ce qu’elle voulait. Et pourquoi aurait-il conservé cette robe (à vrai dire plus si immaculée, mais légèrement jaunie et en partie tachée) ? Comment expliquer que, pour lui, il s’agissait d’une relique ? Il ne répondit rien. Mais, pour lui, la robe de mariage était bien une relique, ce qui restait d’un temps révolu où ils auraient pu être heureux. Un truc en voie d’extinction. Un débris de tissu qu’il aimait de temps à autre contempler et caresser d’une main distraite. Les châsses dans les églises enferment ainsi des vêtements décolorés, tavelés, flottant autour des carcasses des saints : on les regarde avec curiosité et dégoût. La mariée n’avait jamais été une sainte – toujours insatisfaite et toujours séductrice : de quoi les maintenir juste au-dessus de la ligne de flottaison, jusqu’au jour où elle avait décidé que cela suffisait. N’y avait-il pas d’autres femmes dans le vaste monde ? Il y trouverait son bonheur, son équilibre, des câlineries, des égards plus appropriées à ses goûts. C’est là qu’il avait plongé. Il l’avait vue essayer (c’était son terme) d’autres hommes et des femmes, et lui en faire confidence. Elle ajoutait que jamais elle ne retrouverait un type comme lui, bourré de qualités et d’attentions, de sensibilité et d’intelligence – mais elle ne pouvait agir autrement, c’était un genre de destinée. « Je me souviens des bons moments, des longs moments que nous avons passés », ajoutait-elle en le regardant. Ses yeux le caressaient, il la prenait encore une fois dans ses bras et elle se laissait faire comme si elle attendait quelque chose. Il lui disait que c’était bon d’être en elle, de sentir son sexe malaxer doucement le sien. Elle chuchotait c’est fait pour ça, se rhabillait et le quittait.
LA TÊTE AILLEURS

Tête : bille, tronche, binette, bouille, pomme, poire, trombine, citrouille, cafetière, encéphale, carafe, caisson, ogive, caillou, etc.
Arrivera-t-elle par le chemin ? D’où il se tient, il en voit l’enfilade ombragée et solitaire. Un crissement de pneu, une portière claque, loin sur le parking, une voix se rapproche, des pas écrasant les brindilles, puis, au seuil de la terrasse, la pouzzolane crissante… Rien. Personne. Il est bon d’attendre ce qui adviendra, bon d’attendre l’attente. La frustration est un piment. Si elle n’est encore venue, c’est qu’elle viendra, pense-t-il. Oui, demain sûr. Peut-être aurait-t-il dû prendre rendez-vous officiellement, poser sa candidature auprès de son ange gardien – du haut de son palier, auquel on accède par un escalier féroce, abrité derrière une petite table, il agite ses ailerons, il offre une bouffée d’espoir : « Demain, sûr… ». La porte vitrée derrière laquelle se concoctent les formulaires d’amour reste un paradis entrevu, mais demain, sûr, elle s’ouvrira pour l’accueillir dans le saint des saints (grisâtre, traversé de maigres rais de soleil à ce qu’il peut en apercevoir). Il attend dans le jardin, plus le temps passe, plus il sait qu’il y a du lapin dans l’air. Or, il persiste. La nuit vient, il persiste encore, le cœur davantage en émoi à mesure que le lapin grossit. A la fin, le lapin emplit l’espace, annule les arbres jusqu’à former écran entre ses désordres amoureux et la fille – bien après qu’ils eurent rompu, elle lui demandera pourquoi il n’avait jamais essayé de la caresser, pourquoi n’avoir jamais passé la main sous sa robe. « Je ne sais pas, avait-t-il répondu, j’avais la tête ailleurs… »
La main droite posée sur les genoux de la fille, il se demande ce qui peut bien se cacher sous cette robe rouge et sa tête ailleurs roule sous le grand tilleul, dégringole une terrasse, franchit le ruisselet et, maintenant, elle le regarde, blanche d’émoi. Ou d’effroi ? Interloquée. Pensive. Hébétée sous la frondaison. « Elle est comique ma tête. Elle est tragique ma tête. Elle est énorme ma tête. » Tête lunaire. Un astre. Il pourrait la croquer, glisser le brouillon dans le formulaire officiel à remettre à qui de droit pour approcher du paradis d’amour : yeux ronds, gros nez, petit menton replet, légèrement inclinée, joue droite aimantée par le sol. Mais sa tête reste là, effarée, calée dans la verdure, bientôt environnée de poules, de pinsons, de blaireaux, de mulots, de chats, de sangliers, de chevreuils, d’herbes molles, de lumières froides, de taons et de mouches. Il a pris des risques sans le savoir, comme toujours. Son crâne s’emplit de ferraille et de tessons. Et ses oreilles… « Bon dieu, où sont mes oreilles ? »… Il n’entend ni le vent ni la pluie ni les guêpes. Il lui semble qu’on arme sa caboche de fers à béton, qu’on la fourre de béton. Sa tête sue de l’eau de pluie, voilà le résultat. « Au moins, tu ne pleureras plus. » Il veut parler, bouger – les lèvres, au moins – mais il revoit seulement sa tête planer au-dessus de lui, juste avant d’atterrir. Muet, sourd, paralysé. Un coma de clown, pense-t-il. La fille en rouge a encore joué à la pétanque – ou aux quilles ? – avec sa tête ailleurs. Comment l’appelait-il déjà ? Voltigeuse. La Voltigeuse mène dare-dare sa brouette sur un chemin chaotique, une brouette aussi rouge que sa robe, bourrée de ciment-colle. Il s’agit, dit-elle, de « colmater les fissures ». Elle escalade son crâne, elle pénètre dans son crâne… Des sondages pour savoir où il en est. A-t-il toujours la tête ailleurs – « Son âme, a-t-il encore son âme ? » Aurait-il, à tout hasard, glissé la tête sous la robe rouge ? Alors, dans ce cas, inutile de fredonner, inutile puisqu’il n’a pas d’oreilles : ce qu’il lui faut c’est un bon coup de truelle et lui clouer le bec.
LE JARDIN DE LA GRINCETTE
« La Grincette est une petite créature larvaire, ressemblant à ce que pourrait donner un croisement entre un asticot et une crevette. Elle vit généralement dans les endroits humides et sombres, où elle se nourrit de déchets végétaux. Douée d’un certain mimétisme, elle se confond avec son environnement. La Grincette tient son nom du grincement horripilant qu’elle émet à chaque fois qu’elle se déplace : le bruit d’une craie grinçant en porte à faux sur une ardoise, en 50 fois plus fort et plus éprouvant pour les nerfs. »
1. La grincette
…La machine à remonter le temps c’est le jardin de la grincette. Ça grimpe, ça descend, forcément ça grince. C’est le lot du mouvement perpétuel… Comment ?… Parle plus fort, ma chérie… Le moment perpétuel ?… Je n’entends rien… Le moment… Ça grésille abominablement… Je dis : le mouvement perpétuel !… Tu n’entends rien… Ça grésille… Non, il n’y a pas de grésil !… Oui, il y a du soleil, un grand soleil… Je voulais dire : grésillement – c’est brouillé –. Dans le temps, dans la famille, on disait : ça fait du foin, tu te souviens ?… Changer la membrane du combiné ? Ma chérie, il y a longtemps qu’il n’y a plus de membrane dans les téléph… Non : disons que c’est le temps qui passe… Tu t’en souviens ? De quoi ?… Articule !… Tu ne te souviens… Je voulais juste te demander : quel est ton plus vieux souvenir ?… Mais comme tu veux ! Celui que tu préfères… Là, juste là, qu’est-ce qui te vient à l’esprit ? Ne réfléchis pas… Mais non, je ne fléchis pas : c’est le téléphone qui… Oui, c’est ça : juste un souvenir, même embrouillé, un brouillon de souvenir… Ah, là, c’est parfait : je te reçois cinq sur cinq… Quand tu avais cinq ans ?… Si tu veux… Tu ?… Ne parle pas si vite sinon j’oublierai tout… Les détails c’est important, surtout les détails… Incroyable ! C’est incroyable ce que tu me dis… Tu en es sûre ?… Tu le jures sur la tête de… De qui ?… Mais il est mort depuis longtemps… Et merde ! Ça regrésille… Je dis : il est mort depuis longtemps, mort et enterré !… Oui, ça arrive à des gens très bien, tu as raison ; mais je t’en supplie : ar-ti-cu-le… Il y a du foin sur la ligne… Donc, tu as cinq ans, elle arrive dans la cuisine, tu es en train d’avaler ta bouillie… On est d’accord ?… Le téléphone, fait de la bouillie ?… Ça va passer… Tu préfères que je rappelle… Tu ne te rappelles plus bien… Je n’ai pas saisi : est-ce que tu veux que je rappelle – que je rappelle plus tard, ce soir par exemple – ou bien tu es en train de me dire : je ne me rappelle plus ?… Je t’entends à nouveau… On reprend ton souv… ?… Tu en étais à la bouillie… Avec de la maïzena… Oui… Mais oui, je sais ce que c’est… Tu as horreur de la maïzena aujourd’hui encore… Non, je ne confonds pas avec ton zona. Le zona c’était l’année dernière et la maïzena quand tu avais cinq ans… Pas cinq mais trois ?… Peut-être deux ?… Ça n’a pas d’importance, ma chérie, ce qui compte, c’est ton souvenir de maïz… Elle arrive derrière toi et juste à ce moment-là tu… Bien sûr, cinq ans ce n’est pas comme deux ans, mais c’est toi qui décides… Eh oui, il y a encore du fading sur la ligne… Oui, la bouillie c’est fade, mais je te dis : il y a de nouveau du foin… Ça tombe bien ?… Fade comme du foin… Les souvenirs sont fades… Ça s’efface… Quoi il ne te reste plus que la cuillère ?… Et elle qui tient la cuillère ?… On est bien d’accord : elle tient la cuillère ?… Et là tu vomis. C’est bien ça : tu vomis… La bouillie… Bien sûr… Non, je ne dis pas que tu faisais la bouille ! Je parle de la bouillie… Pas celle du téléphone : celle que tu vomis tandis qu’elle est là avec sa cuillère… En corne ?… Oui, bien sûr les détails c’est capital… En corne… C’est rare les cuillères en corne pour les enfants… Tu te demandes pourquoi ?… Une cuillère de famille… Parle moins vite et plus fort, ma chérie, je t’en supplie… Tu te demandes encore si c’est le contact de la cuillère en corne ou le goût de la bouillie qui te fait… Dégueuler, tu dis bien : dégueuler ?… Je ne gueule pas, c’est toi qui… C’est un souvenir comme un autre… Ils se valent tous puisqu’ils s’effac… Et il était quelle heure ?… Entre chien et loup tu vomis sur la cuisinière… En fonte… Oui j’ai bien entendu : tu vomis sur la cuisinière en fonte noire… Tu vois : ça remonte !… Oui, c’est le cas de le dire… Là, ma chérie, je t’entends à merveille, c’est comme si j’y étais !… Ne te fâche pas : je ne veux pas entrer dans tes souvenirs !… Ton souvenir… Ton seul souvenir… Il ne regarde que toi… Ne pas insister… C’est comme tu veux… Tout s’efface… Je voulais juste que tu me donnes quelques mots sur le temps qui passe, memento mori, vanitas vanitatis, les feuilles mortes qui se ramassent à la pelle… Le caca de chat aussi… On est bien d’accord… Mais si, je m’intéresse à toi… A tes souvenirs aussi… A ton souvenir… Ton grand souvenir… Attends, qu’est-ce que tu… Et pourquoi je t’ai parlé de la grincette tout à l’heure ?… Les jardins de la grincette, tu as raison… Ça te fait grincer des dents ?… Attends, je t’entends à peine, j’ai l’impression que tu es au bout du monde… Tu as bien dit : le moment… Le moment perpétuel… Le mouvement perpétuel… Elle ramasse le vomi… Avec la cuillère… En corne, la cuillère… Oui c’est important… A cause de la famille… Bien sûr, ta famille… Et elle te force à la bouffer… Oui je t’écoute… Elle te force à bouffer ta famille et le vomi avec… Je ne t’entends plus ma chérie… Je n’entends plus rien.
2. Etouffement
Oui c’est ça l’inverse de respirer – respire à l’envers tu appelles ça ainsi : à toute force, cesser de respirer, la pompe ne fonctionne plus… Bloquer la pompe, bomber le torse jusqu’à n’en plus pouvoir, tenir, tenir… Qu’est-ce que tu tiens ? Mes poumons, je tiens mes poumons ouverts pour cesser de respirer. Je n’aspire plus… Et, quand c’est fini, quand le jeu se termine… J’entends la voix : « Tu as fini de jouer ? » tandis que je me demande à quel jeu… J’ouvre la porte de la chambre bleue, celle à la vitre bleue, lourde, opaque et granuleuse (la plèvre ?). Dans la chambre bleue, il y a l’armoire bleue, laquelle enferme la jolie fiole bleue close d’un bouchon noir. Son bleu est aussi profond que son noir… Une fois dévissé le bouchon, l’odeur suave se répand : à moi de respirer. Boucher du pouce gauche la narine gauche, coller la narine droite au col de la fiole, et là respirer, à fond, longuement. L’éther s’infiltre. Tu reprends ton souffle puis colle la narine gauche. A quel jeu joues-tu ? Cela détend, je peux ensuite m’allonger sur le divan bleu – qu’y puis-je si tout est bleu… Les murs, le plafond, le linonéum, le lavabo, le bureau… Le grand bleu. Comme ses yeux.
Elle a les yeux bleus ouverts, ses mains se crispent sur les draps. J’ai beau être détendu, j’ai peur : je viens d’entrer dans la chambre blanche – les murs, le plafond, et la moquette pâle, les draps et l’oreiller. Elle, tellement silencieuse depuis des jours, resserrée, voici qu’elle hurle, ses mains glissent vers sa poitrine, se projettent soudain comme s’il lui fallait nager : « Ouvre la fenêtre ! Ouvre la fenêtre ! ». Ouverte, la fenêtre. Froidure d’hiver humide, annonciatrice de neige. La chambre blanche aspire un souffle glacé. Elle vient d’arracher de toutes ses forces l’aiguille enfoncée dans sa veine – épicentre d’un bleu tant il devient difficile de piquer, repiquer la veine… D’arracher l’aiguille et le serpent de plastique translucide relié au flacon de sérum qui évite la soif. Elle retombe. Je referme la fenêtre. Elle ne parlera presque plus – juste dire : « Je vais mourir, faites que ça soit vite fait. ». Je me penche vers elle, vers le bleu de ses yeux tandis que, de sa main droite à peine décollée du drap, elle esquisse un signe de croix : elle me bénit, moi le bleu, qui vais de ce pas emplir d’éther mes poumons, respirer dans la chambre bleue puis revenir tandis que la nuit pousse. Ses yeux sont clos. On dit qu’elle est dans le coma – une chambre submergée d’un brouillard blanc. On dit qu’elle est tombée dans le coma. Peut-on tomber dans le… La veille, je lui avais massé les bras, les épaules, doucement, senti son corps frémir, à peine. Là, dans la chambre blanche, nous parlons encore en silence (celui de la nuit effective et celui, opaque, de la nuit interne)… Combien de temps avons-nous respiré ensemble jusqu’à son dernier souffle – démesuré, soulevant, ample, sa chemise de nuit blanche, avant de disparaître ?
LA MARIÉE
…Ainsi qu’il se doit, le marié porte dans ses bras la mariée blanche pour qu’ils franchissent le seuil de leur maison. Même légère, elle pèse trop pour qu’il puisse ainsi monter l’escalier. Il la lâche donc. Elle sautille de marche en marche devant lui et, même, se déhanche (comme font les putes en montant, pense le marié). Elle grimpe, un coup de hanches, un regard coquin vers le novio, un coup de hanches… Où a-elle appris cela ?
Dans la chambre des noces, le feu flambe. La cheminée est vaste, un feu de genêts illumine la pièce, souffle des lambeaux de chaleur. Soudain, il n’y a plus qu’un rougeoiement, puis le froid humide. Heureusement qu’ils sont jeunes !
La mariée est très belle avec sa robe molletonnée, très fine, très rieuse. Il faut déboutonner les nombreux boutons (la robe est fort longue). Entre le déboutonnage et la chemise de nuit transparente, légèrement rosée, le marié ne sait plus bien ce qu’il fait. Sans doute regarder un peu de côté ? La mariée dit alors : « Je ne pèse plus rien, vous savez » et lui de s’esclaffer. « Mais si, insiste-t-elle : moins qu’une plume ». Lui : « Vous n’allez donc pas vous envoler. » Il joint les mains, croise les doigts, les serre tant qu’ils bleuissent. Elle : « Piou piou ! Piou piou ! ». Puis elle étend ses bras, les allonge tant qu’elle peut. Il découvre alors que les aisselles de la mariée sont épilées. Certes, il a déjà tâté la mariée avant qu’elle soit épousée, mais là, vraiment, il ne reconnaît rien. A croire que cette femme, sur le lit, dans les draps, est une étrangère. Il procède donc ainsi que l’on procède avec l’étranger : à l’aveuglette. Il y va, fourrageant, se propulsant, se retirant vite fait, tandis que la mariée, bras replié contre sa tête, sent l’odeur monter jusqu’à sa gorge. Maintenant, le silence s’installe. Un grand calme envahit le marié, un engourdissement qui présage un bon sommeil. Il va sombrer, mais, avant, il demande à voix basse : « Alors, comment c’était ? ». « Ça a été une boucherie », dit la mariée.
LA CHAMBRE DES MERVEILLES, véridique histoire de L. V.
Madame, je connais si peu de vous. Vous vous appelleriez Louise Viardot – Louise, Pauline, Marie Héritte-Viardot, si se rajoute à vos prénoms votre nom d’épouse. Êtes-vous la fille de la chanteuse Pauline Viardot-Garcia, et surtout la nièce de La Malibran ? Vous convolez à l’église de la Madeleine le 18 mars 1863 – un évêque bénit votre union : vous avez vingt et un ans et votre mari, qui plus tard écrira des vers de mirliton, vous emporte au Cap, via celui de Bonne-Espérance où il est consul de France. Vous allez faire le tour du monde diplomatique… De cette époque, je n’ai de vous qu’une médiocre photographie : debout, de profil, le regard tourné vers l’objectif, vêtue d’une longue robe blanche assortie à votre chapeau – léger, cerné d’un liserai noir, comme ceux de l’encolure de la robe et de la ceinture serrant une taille fine – vous êtes en compagnie de trois femmes : deux se tiennent debout et de face, la dernière, assise, semble vous contempler. La scène se passe devant l’embrasure d’une porte-fenêtre mi-ouverte. La photographie, minuscule, autorise pourtant les regards : le vôtre est droit et ferme. Le cliché a-t-il été pris au château familial de Courtavenel, en Seine-et-Marne ? Dans l’hôtel particulier parisien, rue de Douai ? Le cadrage, serré, garde son secret.
Dans votre famille, on chante l’opéra, on dirige des orchestres, on est souvent célèbre. Courtavenel possède tours à poivrières et pont-levis. La salle des gardes est devenue un théâtre – plateau, portants, rideaux, rampe, trou de souffleur et loges. Georges Sand et Ivan Tourgueniev, Berlioz, Gounod ou Saint-Saëns y furent spectateurs et parfois acteurs. Valet de pied, femmes de chambres et valet de chambre faisaient aussi partie des spectateurs ; et Coluche, grognard de Napoléon… Étrange enfance. Vous chantez, vous composez déjà… Vos parents vous emmènent à Saint-Pétersbourg, à Londres, à Berlin où vous jouez à cache-cache avec Frederick de Prusse. Le futur empereur a douze ans, vous en avez cinq et il vous tire par les jambes pour vous extraire de votre cachette favorite – sous le canapé… Mais vous n’étiez pas Louise au Pays des Merveilles. Chez vos parents, les enfants ne parlent jamais à table, ne reprennent jamais d’un plat : vous calmez votre faim en mangeant du pain entre les repas. Et, chaque après dîner, après que les huit chiens de chasse, au petit trot, soient venus saluer les convives, il vous fallait, accompagnée au piano par votre mère, chanter un air, toujours le même, où il était question d’un fusil scintillant, d’un sabre en bois et d’un coursier caparaçonné, avant de faire demi-tour et de partir du pied gauche regagner votre lit où vous dormiez le moins possible afin de travailler le plus possible : à l’aide d’une ficelle, vous attachez votre pied aux barreaux de votre lit. Le moindre mouvement vous éveille : la nuit est faite pour étudier les partitions, lire en français ou en allemand, apprendre l’alphabet grec… « Il peut paraître singulier, écrirez-vous bien plus tard, qu’une gamine ait la passion d’étudier des partitions : mais, après tout, cela n’est pas plus étrange que de la voir composer avec succès… ». Ou de déchiffrer des sonates de Beethoven. Vous êtes, Madame, une autodidacte. Vous réfutez vos médiocres professeurs. Pour échapper à la leçon de piano, vous vous coupez au doigt, versez de l’eau sur le clavier. Adulte, regarder un graveur travailler vous suffira aussi pour pratiquer cet art…
Chaque jeudi, à Paris, vos parents recevaient pour une soirée musicale Berlioz, Corot, Stockhausen, Gounod, Massenet, César Franck, Lalo, Gustave Doré, Renan, Flaubert, Tourgueniev et tant d’autres : votre mère déposait devant vous des partitions que vous deviez déchiffrer au piano, à première vue comme on disait alors. Vous appeliez cela de la torture mais vous vous exécutiez. En solo, en trio, en quatuor avec des stars, vous vous exécutiez…
Au prix d’un saut d’années, nous voici donc, Madame, au cœur de la musique, de vos musiques aujourd’hui trop oubliées. Nombres de vos partitions ont disparu, leurs titres survivent… « Bacchus Fest » et « Lindoro », deux opéras… Deux cantates pour soli, chœurs et orchestres, « Wonne des Himmels » et « Die Bajadere », sonates et trios pour piano, des chants par dizaines, quatre quatuors pour cordes et trois pour piano, violon, alto et violoncelle… Les quatuors sont là, aujourd’hui – caché sous votre lit, un médiocre lecteur de CD les diffuse à volonté… Non, Madame, les mots n’ont pas fourché : il s’agit bien de votre lit, de vos quatuors, qu’accompagne le mobilier de votre chambre : un divan, deux chaises, deux fauteuils, un tabouret, un guéridon octogonal.
Mais retournons au lit – un dodo somptueux, théâtral et néo-gothique. Du chêne stuqué et sculpté, peint d’argent, de rouge et de bleu, comme l’ensemble du mobilier. On grimpe dans votre lit par deux portillons ouverts en ses flancs. J’ignore qui empruntait le portillon de gauche, qui celui de droite. Ernest, votre consul de mari ? J’en doute, car il semble que vous l’ayez largué, lui et ses vers ampoulés, voguant de votre côté à travers le monde pour y diriger orchestres et chanteurs. D’autres, peut-être – mais vous ne dites rien de votre vie privée. Aviez-vous des amants, des amantes ? Cela est bien tentant. A moins que vous ne dormiez en solo (mal, car vous êtes insomniaque) ? Vous voici environnée d’une biche, d’un pélican, d’un aigle à tête double, d’un paon et de chevaliers en armure, épée, bouclier et cotte de maille. Surtout, sur le pied de lit, un quatuor de médaillons titille le regard.
Les deux médaillons centraux s’ornent de vos initiales, L et V. Celui de gauche est un signe du zodiaque, le sagittaire – il s’agit bien de votre signe, n’est-ce-pas ? Vous êtes bien née à Paris un 14 décembre 1841, sous le signe du sagittaire ? Un centaure lançant sa flèche dans la bonne direction, celle qui transmue la force brute en science et sagesse, cela devrait vous convenir puisque la musique, quand elle n’est pas militaire, est censée adoucir les mœurs.
Le médaillon de droite nous embarque vers la Grèce antique, sept siècles avant J.C., avec Esope le fabuliste : voici sculpté l’âne qui joue de la lyre, un âne qui chante, un âne savant – il joue si merveilleusement de la lyre qu’il séduit la princesse dont il est tombé amoureux. Bien sûr, la nuit de noces lui ôte sa peau d’âne pour le transformer en prince charmant… Métamorphoses en musique, Madame – l’histoire ne dit pas si le lit grinça quand glissa la peau de l’âne, mais s’il couina ce fut sans fausse note, en pleine harmonie.
Quels rêves faisiez-vous dans ce lit fabuleux entre deux insomnies ? Et quelles étaient ces insomnies ? Revoyiez-vous Rossini s’asseyant lourdement sur le clavier du piano pour traduire ce qu’il pensait de Wagner ? Ou votre père et Tourgueniev jouant non-stop aux échecs de six heures du soir à quatre heures du matin ? Ou Verdi invectivant son orchestre ? Revoyiez-vous le bordel moscovite où, par mégarde, vous dormîtes une nuit glacée ? Ou ces hiboux, perchés en brochette sur le balcon de votre chambre russe, vous regardant écrire et lire en nocturne ? Ou les hurlements des loups dans les steppes de Crimée – l’un deux s’assit à dix mètres de vous et vous fixa si longtemps… Et les tarentules, les blattes, les scarabées, les araignées, les punaises, les scolopendres minces et poilus – tout un cirque courant au plafond avant de dégringoler sur votre couche avec un bruit flasque. Et la police tsariste aux aguets.
Ici – je vous dirai plus loin où et comment – votre lit accueille des sculptures de femmes arquées comme des danseuses farouches : on peut souffler dans leurs sexes et leurs bouches ouverts. Elles sont alors des instruments à vent. Ou toquant, raclant, faire résonner leur colonne vertébrale. Toujours la musique… Une panthère chevauche la tête du lit, d’autres s’adossent aux fauteuils, ainsi qu’un bouquetin. La tête d’un chevreuil fixe le baldaquin vermillon de votre lit. Une myriade d’oiseaux bleus et rouges constelle les murs, une vanité aussi (tête de mort aux roses), une tête de veau tranchée et blême, le chef sanglant de Saint Jean-Baptiste décapité, un singe à l’escalade – il s’agit de tableaux amoncelés aux pierres des murailles… Je n’irai pas plus loin dans cet inventaire – sauf à signaler la présence d’un jeune blaireau, d’une hure de sanglier, d’un cobra luttant avec une mangouste, d’une peau de boa formant rideau devant un vitrail, ou de ce renard mi-endormi sur votre fauteuil azur…
Résisterez-vous longtemps, Madame, au désir d’ouvrir, à gauche de votre lit, ce cabinet Renaissance ? Il recèle crâne humain et masque de porc, horloge renversée et vases grotesques, tabatières en bouledogue, conque, œufs pétrifiés, et, entre mille autres perfidies enjouées ou terribles, une photographie de votre serviteur… Une fois ouverts les battants d’acajou, sentez-vous ce parfum de violette – celui que vous portiez, peut-être – échappé d’un flacon mauve ?
Et quoi donc ! Toute cette fatrasie, tant de bibelots ! diriez-vous. Tant de mort et de vie accolées, romantiques en somme, comme le sont vos musiques – et simplement les entrelacs illustrant les couvertures de vos partitions : lyres, Euterpe, angelots, cygnes et guirlandes pour cette fantaisie, « Spanisches Quartett », Opus 11… Cela permet de voyager loin et profond, de ciseler l’espace ainsi que vous l’avez fait, en portées et en lieues…
Vous voici à Stockholm, accueillant par une nuit de pleine lune un navire revenu de l’Arctique, ou, toujours en Suède, soulagée de maux mystérieux par un guérisseur qui, disait-il, soignait à l’identique hommes et cochons.
Vous voici à Pompéi cinq jours d’affilée, puis à Amalfi où vous constatez, je cite, « l’irrévérence du peuple dans les églises et la médiocrité de la musique qu’on y fait ». Entrez-vous à Saint-Pierre de Rome, c’est pour constater que les chiens y sont admis ; dans une église de Pise ? Pour ouïr le sermon d’un prêtre manipulant Voltaire et Rousseau en marionnettes. Les églises, on s’y épouille, on y consomme l’amour, on s’y met au frais ou au chaud. Je n’aurai garde d’oublier de mentionner Phanor, votre caniche blanc, capable de déceler la moindre fausse note…

Le monde, Madame, serait-il un gigantesque et universel cabinet de curiosités, une réplique de celui qui, chez nous, en Ardèche, dans le modeste château du Pin, abrite votre chambre à coucher, votre lit ? Nous l’avons baptisée « Chambre des Merveilles » en votre honneur… Et donc (car il faut bien retomber sur ses pieds, fussent-ils pieds de nez du hasard) comment donc lit, divan, fauteuils, chaises, tabouret, guéridon atterrirent-ils dans ce castel de poche ? C’est une affaire de puces, Madame. Il faut, comme dans les églises italiennes, s’occuper des puces. Les puces, la mémoire, cela démange. On se gratte, les souvenirs reviennent…
J’étais enfant à Paris, Madame, et mes parents étaient des fervents du Marché aux Puces de Saint-Ouen. Ce grand marché se divise en petits marchés – dont le marché Paul Bert. Paul Bert, votre contemporain, puis-je vous le rappeler, était un spécialiste de la plongée sous-marine et des gaz anesthésiants. Ministre des Colonies, il voyagea jusqu’à Hanoï où il mourut. Un chantre de l’école laïque et obligatoire, un fervent républicain. Cela doit vous plaire : vous détestiez Napoléon III, vos parents cachèrent un insurgé contre le coup d’état de Napoléon le Petit en 1852. L’insurgé au demeurant se révéla grand ingrat et grandiose escroc : tandis que votre famille, de concerts en récitals, parcourait la Prusse, l’Angleterre, la Russie, elle lui avait confié le beau château de Courtavenel. A votre retour, il n’en restait rien : l’homme l’avait vendu pierre par pierre, au mètre cube, l’avait rasé avant de filer avec le magot. En Suisse. Cette coutume se pratique encore de nos jours.
Mais revenons à nos Puces. C’était une fin d’après-midi pluvieuse, l’heure de la fermeture approchait. Un éclat d’argent nous attira dans la pénombre d’un entrepôt : votre lit, Madame, votre lit, scintillait doucement. L’affaire fut vite conclue : le brocanteur désespérait de vendre une chambre trop encombrante et trop bizarre à son goût. Le marchandage fut expédié au profit de mes parents qui s’enquirent de l’origine du mobilier. Il avait appartenu, nous dit cet homme replet et gris, à une chanteuse d’opéra de la fin du XIXe siècle. Il n’en savait pas davantage. L’avait-il acheté lors d’une vente aux enchères ? A l’occasion de la succession de votre fils Louis ?
Madame, mes parents dormirent dans votre lit, des modèles, nus ou habillés posèrent dans vos fauteuils, moi-même j’y fus portraituré adolescent : ma mère était peintre – les tableaux qui entourent votre lit en témoignent. Une nuit de noces se passa – plutôt mal – dans votre lit. Un Suisse, navigateur et milliardaire, y plongea sa barbe une nuit durant, pestant que la couche ne fut plus longue au regard de sa taille. Une musicienne et son amante y convolèrent. Une visiteuse s’enfuit en pleurant tant votre lit l’effrayait – elle ne comprenait rien aux merveilles, ou bien était-elle trop sensible à l’émerveillement ?
Récemment, Madame, des lycéennes d’une ville voisine, au vu de votre mobilier et à l’écoute de sa stupéfiante histoire, prirent des notes et me les communiquèrent. Elle vous imaginaient, pardonnez-leur, au fil de leur imaginaire. Des mots surgirent, en vrac :
« Sombre, chaude, rouge, brune, châtain, froid, rose
Opéra, lyrique, cantatrice, classique, dramatique, comptine, macabre, grosse, folle
Lisse, rugueux, rêche, dur, épais
Elle n’était pas schizophrène
S’il n’y a pas les oiseaux…
Envoûtée par un serpent
Boîte à musique
Silence lourd, ça grince
Ça sent le vieux, le bois, la mort, l’humide, la violette envoûtante
Le bal, la fête. »
Elle dirent ensuite vos cheveux châtains attachés en chignon, vos yeux bleus, votre regard provocant. Elles décrétèrent que, finalement, vous étiez grande et fine, que vous portiez de longues robes nanties de cols en fourrure et des escarpins. Elles estimaient que vous étiez mère de plusieurs enfants. Vous les aviez perdus, dramatiquement – sans doute s’agit-il de vos partitions hélas disparues. Tout bien pesé, vous étiez entièrement vêtue de fourrures, vos ongles étaient très longs, vos doigts fourmillaient de bagues épaisses, vos paupières s’armaient de longs faux cils noirs et gras. Elles pensaient que ne vous maquilliez sans doute jamais. Elles allaient y remédier : « LV s’observe dans le miroir. LV se poudre de blanc le visage. Un coup d’eye-liner noir charbon pour avoir des yeux de biche. LV se concentre. Elle prend du recul pour observer ses yeux, elle plisse les paupières. LV aime paraître sévère. Elle s’admire. LV murmure une douce mélodie. »
…Cette jeunesse – 16, 17 ans… – ignorait tout du solfège, des partitions, de la composition et, je le crains, du Romantisme, du XIXe siècle… Mais elles vous entendaient murmurer une douce mélodie. Debout autour de votre lit, elles tendaient l’oreille, faisaient silence : elles vous écoutaient, elles vous écoutent, Madame.
Nous sommes maintenant en 1911 et vous avez 70 ans. Il vous reste 7 ans à vivre et vous dites : « C’est encore dans le travail que je trouve les jouissances les plus pures ». Vous ajoutez : « On a toujours quelque chose à apprendre ; et l’on se figure volontiers qu’il est utile d’enseigner à autrui ce que l’on croit savoir. » Il me reste, Madame, à prendre congé de vous. J’ignore si vous êtes morte dans ce lit de conte de fée… Vos proches vous veillèrent-ils, assis dans les fauteuils sculptés de paons et de cerfs ? Des fleurs, sur le guéridon ? Des violettes alors…
LA CLEF
Elle s’avance jusqu’à la porte du salon, prenant garde qu’on ne l’entende pas. Elle glisse sur le parquet ciré (c’est du moins son impression, ce glissement des chaussons, le feutre gris sur le bois) et colle l’oreille contre la porte. Le murmure des voix d’à-côté en pénètre les fibres – une rumeur qui clapote vers ses tympans, puis le silence, puis le raclement d’un meuble sur le sol (la chaise noire, à moins qu’il ne s’agisse du fauteuil crapaud tapissé d’une peluche moutarde ?). Un éclat de rire assourdi vient ensuite mourir, decrescendo, s’épuise. Elle n’aime pas ce rire de femme. Un gloussement satisfait, rien de bien ne sort de ça : la femme doit se trémousser – elle ne met aucun nom sur cette voix, « la femme » suffit, bien qu’elle sache parfaitement qui couine ainsi. Elle imagine la femme sur le fauteuil crapaud, large et bas, ventru, au coussin rafistolé. La femme doit porter sa robe de taffetas mauve (elle jurerait entendre son froissement, les vagues d’étoffe moirée glissant contre les cuisses, remontant vers les hanches, cela lui rappelle le flux des vaguelettes s’affalant sur le sable). « Non, pas là !… : là ! » dit maintenant, très vite, presque à voix basse, la femme, puis elle rit à nouveau, un rire étranglé. Ensuite, c’est le silence. Un silence qui fait battre les tempes, sèche les lèvres. Elle entend son cœur, retient son souffle, avec la peur que, de l’autre côté de la cloison, on l’entende – un métronome, une caisse enregistreuse, on tape sur le clavier et le tiroir s’ouvre avec un son mat… La porte du salon s’ouvrira d’un coup : « Puisque tu aimes te cacher, cache-toi ! » On la traînera dans le cagibi et viendra l’oubli… Alors, elle court dans le noir du corridor et la clé du cagibi s’enfonce dans son œil gauche. Elle hurle, elle pleure, la lumière jaillit, la femme et l’autre l’entourent. La clé. L’œil. La clé dans l’œil. Ils disent qu’elle n’en fera jamais d’autre, que ce n’est rien, du reste ça ne saigne pas, juste un bobo, certes très douloureux. « – Mais qu’est-ce que tu faisais là ? ». « Je voulais ouvrir le cagibi. » Juste ouvrir le cagibi, s’y pelotonner, juste en dessous du compteur électrique qui caquette sans cesse, dont la roue dentée tourne sans fin, scintillante, et dans l’odeur aigre des médicaments entassés sur la planchette du haut.
OISEAUX, ETC.
C’est un temps où les oiseaux ont des dents – crocs d’un silex affuté… Grands oiseaux affamés que leurs ailes lourdes privent d’envol, oiseaux dont l’envergure…
Prenez votre envol, oiseaux d’amours
Ils tourbillonnent – lentement déjà –, visent le feu des cratères pour, d’un coup d’entrailles bouillantes, tenter d’aller plus haut : l’orgueil du surplomb (orgueil de plomb) hante leurs crânes minuscules – cervelles rapaces nourries de becs dentelés, de cisailles ébarbées. Le ciel en chaleur les aspire – large remous, typhon inversé. Ils n’en croient par leurs yeux étriqués (à peine des fissures) : enfin, enfin ils voient leurs proies, cessent d’argumenter (la virtualité des captures…). Jamais ils n’ont convoité la terre d’aussi loin. Jamais leurs ailes d’écaille n’ont ainsi frissonné. Ils babillent, claquent du rostre : « Comme au bon vieux temps où tu pêches à chaque raid, où tu purges la savane – pas une seconde à perdre, tu l’as vue celle-là ? ». Ils disent aimer la mort, aimer donner la mort, pour la faim qui leur broie le bréchet. Et la goinfrerie en mémoire. Ces oiseaux possèdent d’infimes souvenirs, bribes qu’ils mastiquent – mastication des morts. Un lamento d’altitude, guère d’oxygène, la fièvre retombe vite. Senteurs ? Chair volatile… Allongez, déployez l’aile ! S’il faut, mimez le loriot têtu ! Prenez votre envol, oiseaux d’amours !
Ce qu’ils font, sertis de fumerolles, de bombes, de scories, décrivant de larges cercles toujours plus larges – une ivresse d’oisillons explorant la fournaise alors même que les chaudières s’éteignent : les voici à terre, pataugas dans la cendre. Le magma colle aux serres, les englue. Immobiles, les voici contraints…
Supplique des oiseaux englués
…Contraints de prier leur créateur oublié (omis) :
Père qui nous colla des plumes sur l’écaille, Père qui nous planta des dents au bec, Père qui nous tira des marigots, qu’allons-nous devenir ainsi cloués ? Ne sommes-nous pas conçus pour voler dans tes cieux et déchiqueter nos proies ? Sommes-nous à jamais condamnés ? Comment nous repaître ? Comment désormais jouir, nous que tu créas oiseaux ?
Réponse à la supplique via François d’Assise
Mes frères les oiseaux, vous avez bien sujet de louer votre créateur et de l’aimer toujours; il vous a donné des plumes pour vous vêtir, des ailes pour voler et tout ce dont vous avez besoin pour vivre. De toutes les créatures de Dieu, c’est vous qui avez meilleure grâce ; il vous a dévolu pour champ l’espace et sa simplicité ; vous n’avez ni à semer, ni à moissonner ; il vous donne le vivre et le couvert sans que vous ayez à vous en inquiéter. Mes frères les oiseaux, il vous faut juste pondre et pondre.
La voix céleste laisse cois les grands oiseaux. Quoi ! Pondre hic et nunc amen ! Dans les gaz délétères, les ponces, la nuée ardente – et le soufre ! A-t-il pensé au soufre, François ?… Or le temps presse, leurs poumons s’embuent, leurs ailes ne peuvent déjà plus se déployer, leurs pattes s’ankylosent. Alors les grands oiseaux allongent une dernière fois leurs cous, regardent le ciel, ouvrent le bec, puis, humblement, s’accroupissent, pondent et meurent.
Ce qu’il advient des œufs pondus par les grands oiseaux
Certains passent à la casserole ardente, fondus à jamais. Pour d’autres, la cendre et les braises des volcans se font tièdes et doux nids. Quelques heures suffisent à l’éclosion : dans un brouhaha (cliquetis étouffés d’épaisses portes carcérales) les coquilles se brisent. Voici venu le règne d’oiseaux inouïs – non de plumes, d’écailles et d’os : vitrifiés, immobiles, statufiés, debout ou couchés, à la peau grenue et lisse, avec ou sans pattes, ailes absentes ou en moignons. Certains ronds, d’autres maigres mais aux ventres tendus ; d’autres, rebondis, greffés de mamelles petites. Ceux-là sont des augures, oracles ni bons ni mauvais, saisis non par les vents et les nuées mais par sidération – métamorphose. Se souviennent-ils du vol des ancêtres ? Et l’avenir ? Quel avenir ? Figurants d’Hitchcock ? Suspendus aux vitres pour glaner soleil et lune et soleil ? Migrateurs stoppés, luisants des tropiques, céladons et cobalts, verts et lie de vin, écartelés par l’incertain… Combien de temps encore ? Encore combien de temps ? Quand remonterons-nous aux cieux ? Où en sommes-nous, voyons où nous en sommes en somme – songent-ils au paradis perdu, à l’épopée des anges (plumes flamboyantes, air modeste, allure majestueuse !) ? Assouvir leur mémoire reptilienne, glisser le bec dans une panse ou, simplement, s’assoupir dans l’herbe chaude… Et pourquoi sommes-nous tantôt carapaces tantôt cailles dodues ? Qui nous a flanqué vulve et phallus ? Et comment désormais pondre ? Et quoi ?… Un œuf d’argile !… Cela prend longtemps mais on s’y accoutume ; à force d’efforts et de rêves on pond son œuf et l’on se dit : pas plus compliqué qu’un grain de beauté ! Si l’on s’agite avec méthode – qui lissant du flanc, de la rotule, qui du bréchet, tapotant, poussant – le résultat est au rendez-vous.
Y’a quoi dans l’œuf ? (La bonne question : c’est qui dans l’œuf)
Version 1 : Des p’tites cailles toutes déplumées que tu achètes chez le boucher. Elles ne sont pas ficelées, donc elles prennent des poses, elles sont débridées comme des putti, ces angelots qu’on voit dans les églises baroques, avec leurs fesses potelées.
Inversion : Les cailles, je les pends pour les étouffer (mes mains sont trop faibles pour pouvoir les étrangler, c’est trop long). J’ai essayé une fois la méthode du tourniquet, j’ai pas recommencé : j’ai tellement tourné ma petite caille que je l’ai décapitée, donc j’ai abandonné cette technique qui ne me va pas du tout…
Version 2 : Des anges, oui, mais débridés.
Inversion : Il faut toujours tenir les brides, aux anges par dessus tout. Sinon c’est l’arnaque : toi c’est moi chez Lucifer.
Version finale : Fermer l’œil si l’on est borgne. Puis tâter, caresser, lécher, téter, soupeser, humer (éviter de mordre ou mordiller motus) : chambrer un rituel. Qui jouera ainsi restera impuni, sera récompensé ainsi : il entendra le chant printanier des rossignols, la trille primesautière et glapir la mouette, chuchoter le cygne ; il entendra hululement et croassement, le grand air enfin du phénix et des harpies.
Inversion finale : entre ses paumes et sous la dent, il sentira des squelettes armés de chair vitrifiée, glacée, émaillée, oxydée de fer et de cuivre. Il entendra le cri de Nini-patte-en-l’air crucifiée, des plumes de paon naîtront à ses paupières. Tel Eros courant vers sa proie, alors qu’il bat de l’aile il battra des ailes, sûr qu’elles le propulseront droit aux cimes, ces ailes absentes…
Post-scriptum – souvenirs oiseux
Ironie giratoire : tourterelle percutée tournant au sol, ailes déployées, tournant sur aile-même de plus en plus lentement jusqu’à ce que mort s’ensuive. Cette… Cette légèreté d’os creux et de plumes… Couleurs flambantes ou douces des plumes… Poudre de plume, excellente farine pour les vaches… Poussière de plume… Poudre d’émail…
Parade : Il Piccolo Circo s’agite dans une mansarde. Spectateurs au balcon : des pigeons gris aux pattes atrophiées… L’Acrobate se balance sans jamais s’envoyer en l’air. La Poularde se rengorge, veut chanter, rien ne sort (en cours de cuisson Poupoule vire au bleu). L’Ecuyère, faute d’ailes, tombe. Ses jambes se recroquevillent.
Cage thoracique : plus fragile qu’une cage elle devient soudain minérale. L’Oiseau-Cage, très lourd d’un coup, tangue pourtant légèrement – tango de pierre.
Déclaration d’amour susurrée par le Geai-Majordome à qui de droit : « Ma cocotte, ma grue, ma poulette, mon turnix andalou mugissant, ô migratrice… Ce soir j’enfile tes vieilles plumes ! »
Parure : l’émail sied aux marionnettes, le brasier les déshabille. Bouillantes au nid, elles embrasent la forêt. Clouées aux grands arbres qui les couvrent de cendres, les suppliantes, les impétueuses, les terres de pierre, les oiselles gravides ! Nudités du cobalt, ivresses lie de vin, cuivre au bec, elles défilent (parfois s’affalent, s’assemblent en colloque) : Miss Plumette ! Miss Très Grès ! Miss Penne de Mort ! Miss Plume Tralala ! Et, bouquet sublime…Mysssstère et sa jumelle Miss Terre ! Inséparables ! Chauffées à blanc ! Eblouissantes ! Que dis-je : aveuglantes ! Inquiétantes, angoissantes autant que drolatiques ! Approchez, Distingué Public ! Rincez-vous l’œil dans l’œilleton ! Vous serez éblouis à jamais, pour toujours éperdus dans la plus épaisse des nuits, la purée de pois chiches, la nuée des plumes nègres !… Dieu des Succubes…
Monsieur Loyal et ses pizzicati – simagrées de corneille ! – lève alors les bras et, sur ses mains gantées de noir se perchent tour à tour phénix, griffon, basilic, hippogriffe – puis tournent, cavalcadent, rampent, fusent vers les cintres, tourbillonnent : fracas d’ailes, de griffes, de sabots. Ils atterrissent dans la sciure, labourent la piste, se lissent soudain les plumes, se roulent des galoches.
Mise à mort de Monsieur Loyal
Les becs, les serres, l’épine des ailes, le martel des sabots : vite fait bien fait. Les gants noirs sont rouges. Rideau sur la pipelette ? Nenni. Le phénix pond un œuf – masse de myrrhe onctueuse et parfumée qu’il creuse à coups de goule puis y enferme le cadavre.
Rebonds : portant entre ses ailes Monsieur Loyal en œuf, le phénix rouge pénètre dans l’arène. Il foule la sciure qui, aussitôt, se teinte de sang. Alors – ultime cérémonial – il déploie une aile, l’autre… L’envergure, voilà qui convient au phénix ! Puis, d’un rais de bec, il frotte ses plumes avec componction, en sorte que les projecteurs, aux cimes des cintres, les fassent scintiller. L’œuf glisse et roule, se brise au sol : un oisillon en sort, gluant comme un crapaud, duveteux d’épines, un oisillon qui s’envole…
Ultimes
Choses vues : l’oisillon faiblard, père et mère le jettent du nid. A peine chuté dans l’herbe, la ronce, un régiment de fourmis noires s’active : encore vivant, elles fouinent, se glissent et le dévorent. Tu peux toujours pépier, frétiller des ailettes, frissonner, tendre le bec : les fourmis te mangent.
Conclusion
Regrets : Et les hommes-oiseaux ? Icare ? La chute Lucifer ? Et les Mordorés ? Et le Vide ? L’appel du Vide ? Thanatéros ? Qui ne s’est jamais envolé dans une vulve ne connaît rien des oiseaux. Les oiseaux sont des soudards… Et les ermites aux os si légers qu’il leur arrive de planer ? Et les kamikazes ? Et les vols de la mort, Malgaches jetés vifs des avions français, Argentins des Fokker F 28 ? Les ailerons du chaos ? Et les poissons volants, pensez aux poissons volants atterris sur le pont des bateaux. Et les oiseaux de la nuit marine, les raies ondulantes ?… Envisagez-vous la lévitation ? La sustentation ? Le Deltaplane ? L’élastique ? La défenestration ? Le vol à voile ? Le parachutisme ? Le parapente ? Le drone ?… Et le Christ aux six ailes ? Autre question : les anges naissent-ils avec des ailes ? Les anges sont de drôles d’oiseaux. Plus léger que l’air, ça vole. Plus lourd que l’air, ça vole… Les ailes du vent (Oiseau-Bourrasque)… Les ailes du désir (Oiseau-Furax)… Les ailes du temps (Oiseau Passe-passe)… Les ailes du délire (Oiseau-Étranglé)… Les ailes de la prière (Oiseau-Béni)… Les ailes du futur (Oiseau-Impair)… Les ailes de l’aurore (Oiseau-Salut)… Les ailes du Grand Aigle (Oiseau-Cabot)… Les ailes du serpent (Oiseau-d’Envers)… Du dragon…Les ailes du papillon démocratique… Les ailes de l’esprit (Saint-Piaf)… Les ailes du pélican… Les ailes de la Transformation… Les ailes immortelles… A l’ombre de tes ailes, ô mon amour oiseau…
…La première fois qu’elle voulut pondre un œuf, l’œuf ne sortit jamais : elle en frissonna longtemps, s’ébouriffa, bascula enfin de sa branche et mourut.
…A l’ombre de tes ailes, ô mon amour (Oiseau-Revolver), à l’ombre de tes serres j’ai piqué du bec.
L’oiseau ? Un rêve qui se casse la gueule.
P.S. : Connaissez-vous La Java des Oiseaux ?
LA GRANDE MOI
J’étais assis à gauche de la Grande Moi, affalé plutôt contre elle qui se tenait droite, cambrée des reins – cela ne se voyait pas au premier coup d’œil mais se sentait au contact. On lui avait appris à se brider ainsi, coite, appris à se tenir libre en restant guindée, à moins que ce fût l’inverse : l’extrême tension de son corps masquant les fourmillements qui l’agitaient, traficotaient sa peau, roulaient dans ses muscles, bousculaient ses entrailles – sa liberté relevait de la confiscation. La grande Moi et moi étions intimes depuis l’adolescence, le vagabondage des sens, au grenier ou dans les fougères, nous ravissait. Emboîtés l’un dans l’autre nous débusquions l’impromptu. Le grain de la peau, les poils emberlificotés, les odeurs louches, les choses gluantes, les râles qui suivaient, la nigauderie et l’esquive : un paradis, hélas perdu.
La Grande Moi avait fait son chemin dans la vie – une vraie luciole. Danse, tutu, pointes, puis l’envol ! J’étais resté sur le carreau, seulement invité aux premières avec petits tours en loges, fleurettes au poing. J’en ressortais meurtri de n’être jamais seul avec elle : la cour grossissait sans cesse autour de la Grande Moi. Je restais confiné, absurde, un genre de cancrelat – au mieux une pipistrelle affolée par tant de lumières et de soubresauts. Une fois – une seule ! – elle me tapota l’abdomen, du fugitif qui me fit frissonner : « Ça va là-dedans ? ». Déjà elle trinquait avec ses admirateurs, déjà je décampais, invisible, oublié.
J’aurais dû passer mon chemin pour toujours. L’odeur du foin, les roulades de jadis, ma ténacité (reconnue par tous), me l’interdirent. J’avais la caboche pleine de la Grande Moi, comme une pierre qui cognait dans mon crâne – et le sexe qui dérivait, s’agrippait à n’importe quoi. Une crampe à perpétuité… Il fallait nous rabibocher. Ce mot glissait, ondulait, se frottait contre mon ventre, s’infiltrait : rabiboche rabiboche. Nuit et jour je dansais la rabiboche. J’aurais pu gribouiller les mémoires d’un rabibocheur. L’obsession d’une vie n’est pas une panacée, ça je l’ai enduré. Jusqu’au traquenard.
Je n’écris pas cela pour présenter des excuses mais pour exposer les faits, sans fard, sans précaution. On me jugera coupable ? Je m’en bats l’œil… Elle sortait de scène en courant, je m’étais embusqué derrière un pendrillon. J’allongeai un pied. La chute de la Grande Moi, je la revis au ralenti : les bras battent de l’aile, le buste pivote, la jambe gauche – celle que j’avais visée – ploie : la Grande Moi gisait à terre, cheville fracturée. Vilaine affaire pour sa carrière d’étoile – étoile naine car elle ne montait qu’avec lenteur au firmament. Je m’étais éclipsé en coulisses, fier – oui, fier ! – du bastringue qui suivit, pompiers et brancard, sanglots et lamentations : du beau travail.
Jamais la Grande Moi ne remonta vraiment sur scène – juste bonne désormais à donner des cours, à chorégraphier des spectacles d’apprentis : je fus l’un d’eux, pas le meilleur sans être le pire, heureux de fréquenter le studio où elle officiait, de m’initier aux falbalas qu’elle enseignait, de transpirer sous ses ordres. Le résultat était médiocre, elle m’encourageait à persévérer – en souvenir du bon vieux temps, disait-elle, ajoutant, « la danse c’est la vie », ce dont je ne doutai bientôt plus : une après-midi nous devînmes amants, là, sur le divan à peluche, à l’angle du studio, à l’aplomb du vasistas. Je retrouvai le sel de sa bouche, celui de notre adolescence… Elle boitait et j’adorais cette claudication, couvrais de baisers sa cheville – la Grande Moi pleurait alors. « Tu l’aimes tant que ça, ma cheville ? » « Oh oui ! Plus que tu ne peux l’imaginer, tes petits os ratiboisés je me damnerai pour eux. »
La vie s’écoulait, lente et paisible, ponctuée de phases d’excitation – ses cours particuliers (très particuliers, précisait-elle) me délassaient de ceux que je distribuais au collège de l’Immaculée Conception. Je devins même passable en entrechats… Combien d’années ? Quatre. Ou cinq, peu importe. Jusqu’au soir anniversaire de mon croche-pied. La Grande Moi avait transformé son studio en théâtre de poche, dressé un plateau encadré de taps noirs ; deux projecteurs éclairaient la scène. Elle dansa, étrange danse où elle pivotait sur son pied droit, l’autre – le bousillé comme je le nommais in petto – battant la mesure dans le vide. Tournoiements et saccades, accélération fulgurante – jusqu’à l’essoufflement : alors le bousillé regagna le sol. La Grande Moi bringuebalait à nouveau.
Je n’ai rien vu venir. L’invitation à passer sur scène ? Une gentillesse blagueuse, un défi pour rire que je relevai. Assise sur le divan, elle regardait mes efforts, mes pirouettes incertaines, l’oscillation, le déséquilibre de son amant. Elle m’intima de recommencer jusqu’à plus soif : « Je veux que tu réussisses, fais-le pour moi. » J’obéis jusqu’au vertige, elle applaudissait : « Plus vite, plus vite. Plus tu vas vite moins tu risques de tomber. » Oui, mué en derviche tourneur je n’ai rien vu venir. A quel instant du tourbillon la lumière s’est éteinte ? A quelle seconde ai-je senti cette minuscule secousse : un pied s’était glissé contre ma jambe. Je dégringolai. Et là, dans le noir, cette morsure violente à la cheville : les mâchoires de la Grande Moi. Puis sa voix : « Cela s’appelle un croque-en-jambe, mon chéri. »
(Septembre 2018)