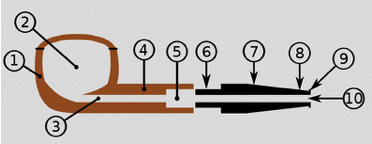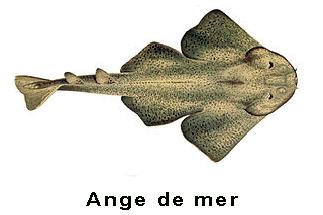PALAIS ROYAL

Pour M
Tu m’as glissé un billet doux – serviette en papier distribuée dans les gares pour accompagner les sandwichs – papier pelucheux, froissé, plié en quatre, griffé de lettres à l’encre violette : on déchiffre deux majuscules : P R – ou DR. « Droits réservés » ? La pointe du stylo a écorché jambe et papier. A bien observer, P R s’impose…
Dans la serviette une vis sertie d’un écrou gris surmonté par un disque d’un diamètre plus large. L’écrou s’accompagne de minuscules cailloux, fragments de silex – l’un à facettes beige clair évoque un outil néolithique, l’autre gris sombre et brillant, bordé de calcaire blanc semble un astéroïde éclaté. Les initiales trottent, les silex brillent, l’écrou… Planté sur sa vis, coiffé de son disque, c’est un pavillon, un de ces kiosques que l’on retrouvait dans les jardins publics – on y vendait, friandises et cerceaux… Je perds ma sandale, mon pied nu se blesse aux cailloux, je me penche, ramasse les deux silex, ils luisent dans ma paume d’enfant. Ils sautent dans ma poche, et moi dans les jardins du Palais Royal. Caresser les initiales ouvre aux jeux de l’enfance, s’y joignent ceux d’aujourd’hui – tailler une pointe de flèche préhistorique, l’expédier dans l’espace où elle scinde la météorite. La flèche traverse les arcades du Palais. Jean Marais se penche – sa jambe droite reste sur le trottoir qui longe les arcades, la gauche se fixe sur le gravier du jardin, la flèche fend le jet d’eau du bassin. C’est par là qu’il regarde, les mains dans les poches de son manteau à col de fourrure. Le jardin est sinistre, hivernal, désert. Jean Marais est mort. Les marronniers sont réduits à de maigres troncs coiffés de branches hirsutes. Mieux vaut retourner vers le bassin où voguent des voiliers. Le mien est blanc. Un coup de vent l’incline, il plonge, se redresse, d’un caprice file vers la bordure, s’y cogne. A moitié allongé j’essaye en vain de l’attraper, il zigzague, loin. A genoux, je découvre coincé sous la bordure un drôle d’écrou – non : il gisait dans l’eau, je le récupère. Un vol de pigeons bascule dans le ciel gris, atterrit aux pieds d’un vieux couple. Assis sur des chaises vert foncé ils mangent des sandwichs. Ils se tournent le dos. Il sourit, distribue des miettes aux pigeons – l’un picore entre ses doigts. Elle, mains crispées sur la courroie de son sac, fait la gueule. Ils portent des chapeaux du temps jadis… Le chat siamois tire sur sa laisse – quelle idée de l’avoir traîné au jardin, il a peur, veut s’enfuir, courir sus aux moineaux. Le chat s’est immobilisé : la jeune femme, très vite, marche vers moi, un bouquet de jonquilles dans la main droite, un grand sourire, le soleil accroche la broche agrafée sur sa robe, à l’épaule. Bras nus, elle avance vers son amour. Une femme assise arrête de tricoter, se retourne vers elle qui va ailleurs, au delà. Est-ce pour cela que je tombe amoureux de la belle passante ? Elle donne des rendez-vous où elle ne vient jamais. Le soir il fait froid, les jardins sont vides. Les grilles closes des arcades, en ordre de bataille, attendent qu’on les agrippe, qu’on y cogne le front. Dans ces jardins, chacun se penche sur le côté. Impossible de garder un point d’équilibre. Au risque de tomber je me penche. Toujours ces rendez-vous illusoires, le soleil passe derrière la Comédie-Française, je bascule sans fin, songeant qu’elle ne viendra pas mais l’attendant, longtemps, avant que le froid nocturne me chasse. Avec qui jouer la comédie ? A quoi bon. Le cerceau – le cerveau ? – roule, bascule. Il oscille, chute. Personne ne me regarde et je m’empresse de filer vers les arcades. Les polichinelles, les boîtes à musique scintillent derrière la vitrine. La femme aux jonquilles regarde, j’aimerais marcher avec vous, nous avons rendez-vous n’est-ce pas, vous n’allez pas tomber au moins, pas vous, ni me laisser tomber n’est-ce pas – d’un souffle j’ai dit cela sans qu’elle se retourne vers moi. De quel droit m’adressez-vous la parole, répond-elle enfin. Oh j’ai dû confondre, pourtant les jonquilles tremblent dans sa main. Les fleurs sont pour moi, c’est ce que je pense, elle va m’en tendre une, la détacher du bouquet, ou bien la fleur tombe sur le carreau, je la ramasse, lui tend. Elle va me dire de la garder en souvenir de notre rencontre, de notre rendez-vous. Une jonquille, toujours ça de pris. Je ne rêve pas : enfant, dit-elle, j’ai habité là-haut, au dernier étage, c’était l’appartement de mon père, aujourd’hui c’était son anniversaire, les fleurs sont pour lui mais il est mort. Je viens quand même, il est heureux de me voir, je cours vers lui mais il s’échappe, c’est le bouquet ! Son rire est clair, si clair. Aimez-vous les jonquilles ? Elles sont à vous, je veux dire pour vous… Elle aussi s’échappe et je serre les fleurs contre ma poitrine – qu’importe la pluie, les feuilles mortes voltigent tombent sur le gravier, collent aux semelles, le sol est gras, les pigeons pataugent vers Victor Hugo, sa statue – un Rodin, le poète est pensif, allongé et nu, dans l’herbe, pas loin de l’immense marronnier – son tronc torturé se dresse, Hugo et lui sont de mèche, la nuit ils s’encanaillent sous les arcades. Le tronc de l’arbre, offrait une large brèche, les jardiniers y entreposaient des outils, il a fini par tomber, le Rodin a fui… Je colle la joue contre le sol, entendre ce qui se trame là-dessous, tâter du caillou… Ainsi je pense à mourir, la terre se dérobe, je descends, la pleine lune éclaire la scène – je balade le chat, joue au cerceau, songe à la mort. Tout s’arrête dans un hoquet. C’est quoi la mort ? Poser la question à la petite fille aux cheveux courts, à la robe vichy… Elle regarde son chien assis sur un banc, lui sourit vaguement. L’immobilité du chien répond à ma question ? La petite fille s’adosse à un arbre, ses ongles griffent l’écorce, elle regarde le chien. Ils se regardent sans se voir. Les jardins de l’énigme disait-on. La nuit, les riverains viennent y enterrer leur chat, leur perruche. La petite fille attend que ça passe… La chanteuse se glisse à ce moment là – que tu es beau mon amour, elle ne s’adresse pas à moi mais à tous les morts, à toutes les mortes – elle me caresse la joue, que tu es belle mon amour j’ai répondu les yeux grands ouverts non je n’ai pas froid les morts n’ont pas froid ça n’empêche pas de les embrasser non ? Tais-toi chante avec moi les arbres pas pour se pendre les arbres c’est ça la vie s’envoler tu vois les feuilles – elle m’a saisi les cheveux, levé ma bouche de terre son chant a fini entre mes lèvres… J’ai souvent rêvé de dormir au Palais Royal, m’éveillant à l’aube grise, l’heure des chuchotements. Dans le grand lit de pelouses et de roses j’effleure les statues de nymphes à peine voilées. Elles se moquent de moi, me tendent seau, pelle et râteau – le bac à sable est au sud, leur index indique la fenêtre, Colette vient de s’y accouder, la voici ensuite sur une chaise roulante qui se rapproche du catafalque, montagne blanche de jasmins, de gardénias, de tubéreuses où elle repose dans la cour d’honneur du Palais Royal… Quel temps aujourd’hui ? Elle soulève le drapeau tricolore qui couvre le cercueil, sous la chaleur d’août remonte l’allée des marronniers, revient chez elle – je suis seul à la voir… Nous allons lire. Sido ? Les Vrilles de la Vigne ? Do ré mi fa sol la si do partent en vrille ça m’amuse ainsi. La fille à la tresse pose un lapin – là, sur la mosaïque de la galerie de Valois, vers le Passage, le lapin détale et je baille, tend les mains, écarte larges les bras, à croire que je vais déclamer, face à elle, elle dit que ça ne rime à rien comme si j’étais déjà si vieux, je ferais mieux de soulever sa robe et d’inspecter, c’est dans l’ordre des choses, humer où il faut l’odeur fraîche des coucous, le bulbe charnu des… Narcotique, le mot surgit son sens m’échappe, narcose – tel un soupir. Tu aimes mon parfum ? L’aimes-tu ? Elle faisait le tapinois en douce, j’étais son seul client, un genre de bénévole, elle me faisait payer l’affût, ma soif lui suffisait, je fermais les yeux, mon désir l’excitait – elle s’éloignait alors à pas de louve… Galerie de Montpensier on vend des décorations, palmes et légions d’honneur frétillent derrière la vitre. Quand je serai vieux j’arborerai la palme de la décrépitude, je défilerai, fantoche parmi les fantoches, sous les marronniers et les tilleuls ; à la fin, épuisé, assis devant le bassin, la tête sur l’épaule de la fille à la tresse, je revisiterai les jardins du Palais Royal… L’écrou, la vis et leur chapeau feront une chic décoration… Vous êtes, Monsieur, Chevalier dans l’ordre du Palais Royal. Un ordre raide et voluptueux, noctambule et roucouleur. Voyez combien la boutonnière de votre pauvre veste scintille ! Vous êtes le seul à arborer un kiosque à souvenirs en guise de rosette. Quel apparat ! Quelle orfèvrerie !… Ainsi je déambule en culottes courtes vert épinard et velours côtelé. Si j’osais je ferais des ricochets dans le bassin, fier destin pour ma paire de silex, le fracas du jet d’eau me fait reculer, le chat siamois n’aime pas les giclures, il m’entraîne. Le soleil cogne, les reflets du bassin aveuglent, est-ce que le velours passe au soleil ? Les côtes atténuent le choc. Ça brule, la poussière envahit les massifs, les rosiers s’éteignent, les yeux pleurent. Tout va bien, je suis là, dit-elle. Elle courait presque pour me rejoindre. Tu es là pour toujours ? Tant que je serai vivante, oui et, qui sait, après coup. Faubourg Poissonnière nous prendrons le 48 nous descendrons au Palais Royal n’oublie pas le chat siamois. Les yeux bleus du chat sous le soleil d’été c’est quelque chose… Seule sa voix m’intéressait, une voix qui se lançait puis retombait d’un coup, comme si elle attaquait un poème pour aussitôt l’oublier. Sa tresse naviguait – un grand balancier noir, tantôt déluré, enjoué, tantôt docile, presque alangui. Un pas de côté, un cloche-pied désespéré : l’heure des adieux s’affiche. A bientôt, à demain, à jamais comme tu veux. La lune éclate derrière le péristyle, projette l’ombre des piliers, c’est l’heure des pensées absentes, le vernis craque, l’enfant et l’adolescent dansent en silence, leurs ombres croisent celles des colonnes. Chaque instant se dissimule. Chaque seconde explose, le cœur, ses battements sont un balancier. L’enfant s’éloigne, l’adolescent ronchonne, il traîne les pieds, file enfin vers la sortie. La femme à la tresse tient désormais le kiosque, elle vend des gâteries. Un bonbon acidulé roule au sol, la fillette en vichy le ramasse. Suce, dit la femme, c’est gratuit. Le chien ne quitte pas son banc. Deux vieilles s’y assoient. Elles papotent… Hiver de rectitude. Froideur des pierres, nudité des sentiments. Personne désormais personne. Il est temps de rêver aux parfums de jadis, à la messagère : d’un coup d’œil, elle met en marche la machine à rebours, cueille un écrou, une vis et deux silex, blague, disant qu’elle est venue accomplir la levée d’écrou – c’était bien peu de choses, une modeste récolte, affirmait-elle avec un sourire en coin et un envol de tresse, mais cela pouvait s’avérer utile pour la suite des événements, allons, ajoutait-elle, pas la peine de prédire l’avenir, ni de conjurer quoique ce soit : vous savez bien que je suis une héroïne inconnue – elle désigna deux statues aux bras cassés – celles-ci m’ont précédé dans les jardins, combien d’années deux cents au moins qu’elles poirotent, forcément personne ne les regarde plus, elles s’émiettent doucement, le gel, le soleil, la vie des statues quoi. Avais-je mal entendu ? La vie des statu quo ? Ma méprise l’amusait. La vie est un statu quo, quoi ? Quoique – elle leva la main droite vers le ciel – quoique et se mit à tourner sur elle-même, vite si vite, sa tresse avait du mal à suivre. Elle marmonnait et j’avais peur, elle me rappelait la chaisière : ton chat est monté sur le fauteuil, il occupe le fauteuil donc tu dois payer c’est comme ça la vie… Elle avait cessé de tourbillonner, ses yeux étincelaient, à peine essoufflée, juste un léger vertige chassé d’un revers de main. Elle avait soif, j’appuyai sur le robinet de la petite fontaine en bronze. Elle recueillit de l’eau dans ses paumes jointes et m’enjoignit d’y boire. Ensuite seulement elle se désaltéra.
25 décembre 2022
DIANE AU NAUTILUS

(Diane est là. Dans la pénombre du Nautilus, sa blancheur l’isole. Le Nautilus est un drôle de sous-marin. Diane au bain, aujourd’hui, pose nue dans le Nautilus – en réalité un ancien moulinage amarré au long de la Nationale, avec côté jardin la rivière Ardéche, tumultueuse -. Peut-être le Nautilus plongera-t-il un jour dans les flots… Diane la Blanche se baignera avec ses nymphes dès que Gaby l’Eclairagiste aura posé sa canette et sa clope pour jouer du rhéostat. Gaby, c’est l’archange Gabriel chargé de terrasser le Dragon. Il gère le Nautilus avec Marie-Ange. Ange, archange, Diane est en bonne compagnie. L’Archange pousse les manettes du rhéostat, les spots s’allument. L’Exposition peut commencer.)
L’énergie de l’eau est partout. De l’eau à tous les étages – Diane insiste beaucoup là-dessus : ce serait épatant de voir comment naviguent les filles – les nymphes – là-dedans. Comment elle se glissent entre les rubans de cuirs, les soupapes. « Le mieux, dit-elle, est d’essayer sous la voûte froide ». La première, comme toujours, elle pénètre dans l’aéropage des turbines – nue comme il se doit – et toutes les autres la suivent.
Ainsi va le bain de Diane, celui des nymphes, dans le fracas des moulins, le tournicotis des bobines. Si elles crient, de plaisir ou d’effroi, personne ne les entendra dans le tohu-bohu mécanique, la mécanique des fluides – et personne n’entend l’aboie des chiens, la meute qui s’approche et se frotte à la rumeur des poulies.
Ici la forêt rugit – aucune nymphe n’entend approcher Actéon. Il tient sa meute à l’œil et son œil de chasseur s’égare entre les poulies, les engrenages, les bobineaux. Il voit, scintillants, passer un bras, une cuisse, une chevelure trempée. Le cliquetis s’ajoute aux clignotement des peaux, à leur miroitement – à force de baigner dans les rouages, les corps des nymphes, à force de moulinage, les voici transformées.
Peut-être sont-elles fautives d’être là, simplement, là dans la pénombre, de s’offrir aux rouages. Peut-être seront-elles punies, châtiées, transformées – à moins qu’il en soit ainsi seulement pour effrayer ou divertir Actéon…
Son regard s’arrête soudain : Diane nue, l’éclair d’une seconde, il la voit, l’admire et sitôt la désire. « Blanche Diane »… A peine les mots surgis des lèvres d’Actéon, à peine, le voici aspergé – cette eau qui sert à humidifier le fil… Le voici baptisé, baptisé cerf dont les bois s’enchevêtrent aux engrenages des moulins.
Lentement, méthodiquement, la mécanique broie les défenses, les ramures, tandis que les chiens mordent partout ailleurs le corps-cerf d’Actéon. Bientôt il est déchiqueté, presque mastiqué. Les nymphes, en corps de garde, veillent le cadavre qui fut, en ses métamorphoses, grignoté, taillé, rembobiné, lambeaux par lambeaux tressé, enfilé, raccommodé.
Diane, là-haut, dans le poste de surveillance, est patronne. Elle exige que cette bouillie d’Actéon soit tressée, filée, mêlée aux fils de soie. Les nymphes, ouvrières zélées, obéissent. Masquées, grimaçantes – rarement un sourire car il faut travailler vite et dur dans le vacarme des machines, la suée des engrenages, la criée d’un dispositif exténuant.
Bientôt, la soie blanche d’une tunique apparaît – immaculée sauf le fil écarlate de l’ourlet – trace dont la discrétion souligne la présence, fil d’Actéon dont un millimètre dépasse au ras de la tunique… Diane s’en empare, d’un coup de dents elle supprime le défaut – brindille qui voltige haut sous la voûte, portée par la touffeur et le remugle des machines.
Diane, maintenant, revêt sa tunique, le vrombissement cesse, les nymphes, à genoux, supplient la déesse de les libérer d’un servage – qu’elles soient un jour, bientôt, habillées sinon de soie au moins de lin, sinon de coton, sinon d’acrylique froufroutant, qu’elles puissent enfin s’envoler, convoler, procréer.
La déesse se détourne puis, d’un geste ordonne aux chiens d’aboyer – qu’elles filent filer désormais à perpétuité ouvrières, tâcheronnes, monstres, esclaves. Et si l’une se rebiffe, les chiens lui font la fête, gueules et crocs, salive et sang.
(Je me souviens d’être entré là du temps où l’usine, le moulinage, la filature tournaient rond dans le fracas des machines et l’humidité effroyable. Toutes les femmes turbinaient, tous les métiers bossaient. Le bois, le fer, le fil, la sueur : cela se mélangeait, s’enroulait, coulait, dégueulait. Aux murs lépreux – parfois armés de graffitis, du nom des ouvrières, des années qu’elles passèrent ici – aux murs écornés et gris pendaient le panneau des interdits, celui des mises en garde, le portrait des patrons. Diane m’avait amené là pour que je la voie à l’œuvre, elle et ses nymphes. Elles travaillaient là depuis longtemps, des années. Elles ne s’étaient jamais mariées, étaient demeurées vierges malgré les avances des contremaîtres et des patrons. C’était leur vie. A la pause, elles quittaient la salle des machines, se postaient devant la rivière dont les flots, souvent furieux, produisaient l’énergie nécessaire au fil. Puis elles regagnaient les métiers, rêvant d’une grève dont Diane serait la porte-voix, la déléguée syndicale des nymphes, une grève d’où elles plongeraient, libres de tout vêtement, nues à nouveau dans la rivière. Libres)
19 novembre 2020
AGATHE / MONOTYPES AU NAUTILUS

(Les spectateurs, triés sur le volet, pénètrent dans une ancienne usine convertie en salle de torture.)
Ecorcher, pendre, énumérer, soustraire, extraire. Reprendre. Recommencer. Ou plutôt : suspension. Les seins éclaboussent. Rayonnent – le gris de l’arbre dans la forêt, l’arbre métamorphosé en potence. Toujours pendre par les pieds, évidemment. Gloire ! Gloire ! Le sang, parfois, remonte vers le ciel – parfois. Parfois il gicle, on glisse dessus. On se glisse entre les seins. On glisse.
Pas grand-chose. Une femme de pas grand-chose. Un genre d’acrobate. Parfois (il suffit que le fil se dévoie) elle va chuter – tout cela dans le plus grand silence de l’intimité, l’intimité des bourreaux et d’elle.
Le rouge jailli d’elle n’est pas seulement du sang mais une diffusion céleste, une sorte d’aura – parfois le corps semble ne plus exister, voilé, effacé, dissimulé à coups de couteaux, à coups de lames, de tranchoirs, de griffes peut-être : certains bourreaux se taillent exprès les ongles – des experts en orgie ; les seins nécrosés ils aiment ça.
Agathe est pendue par les pieds, ses seins tenaillés, seins qui aimaient la caresse, la succion, les voici ensanglantés, pourris… Et eux, les bourreaux, assis, pensifs, ayant essuyé leurs doigts gluants, ils les portent à leurs fronts, à leurs tempes et se disent qu’ils ont bien travaillé.
Le jour tombe, du gris, du noir, du strié descend sur le corps mutilé, glorieux, qui maintenant bat breloque – plus haut, suspension, suspendue aux nuages. Ils sont maintenant de sang, plus haut, le soutien-gorge a quitté les seins. Inutile n’est-ce pas, maintenant cerf-volant.
Le plus grand silence préside aux présentations du supplice dans l’usine désaffectée – lieu où travaillent aujourd’hui les bourreaux, où s’expose leur labeur, où ils amènent des projecteurs pour éclairer en sourdine l’exécution de leur tâche. Lumière donc et le plus grand silence.
(Entre les tempes des spectateurs cogne le sang. Agathe n’est pas une bille multicolore – à moins que les couleurs des suppliciées, leurs terribles teintes, ne roulent dans les ténèbres, soleils funèbres.)
…Le ruisseau des couleurs, le ruissellement, le ruissellement des douleurs – ou leur jaillissement quand la bille roule, comme un œil divaguant, et vient percuter un angle, un mur, heurter une pierre, un parpaing qui l’écaille, l’use – ou bien que l’agate se perde dans l’eau d’un caniveau, d’un ruisseau, et que l’on entrevoit une dernière fois ses couleurs tourbillonner, traversées de lumière – il avait suffi pour cela d’une pichenette, d’un coup d’ongle, tel qui écorche la peau de la suppliciée – et se souvenir de la chaleur de la bille au fond de la poche, imaginer roulant sous les doigts la tiédeur des seins, des tétons d’Agathe ensuite tenaillés.
(Les spectateurs, invités à quitter les lieux, laissent la place à une nouvelle fournée de spectateurs. Le spectacle continue, identique.)
19 novembre 2020
LE BANC
Pour le printemps de Martine.
Le banc était dans la lumière blanche, celle de l’aube sur la gelée – un honnête banc de jardin, en teck usagé, dont les bras, le dossier semblaient minces. Fragilité réelle ? Ou apparente : le promeneur se trouvait assez loin du banc. Au reste, telle n’était pas la question. Le promeneur passait par là chaque matin, histoire de s’oxygéner le poumon (le, car il avait offert son poumon gauche à sa plus jeune fille), histoire aussi d’apprivoiser un souffle au cœur. Il n’avait jamais vu quiconque s’asseoir sur le banc mais il avait constaté qu’il changeait de place. Un jour il regardait le potager recouvert de fumier, un autre il lui tournait le dos, un autre il avoisinait le chemin ou bien, posé en biais, regardait droit au Nord. C’était un banc vagabond, un banc métaphysique puisque toujours vide, un loustic qui se décolorait lentement sous pluie et soleil, loin de la maison des propriétaires du terrain où il divaguait – sans doute la nuit car le promeneur avait varié l’heure de ses balades diurnes pour tenter de le coincer lors de ses pérégrinations. Le banc était somnambule, il se carapatait en catimini à l’autre bord du terrain, dans l’espoir peut-être d’accueillir un être humain, un hibou, un mulot… Après trois mois d’observation, de divagations, le promeneur avait appelé le banc par son prénom – c’était venu tout seul un matin où il l’avait découvert renversé, dossier à terre : des sangliers, sans doute, étaient passés par là. Il bruinait, le ciel était bouché, les collines au loin masquées par la brume qui, par moments, flottait jusqu’au banc, glissait entre les accoudoirs, s’infiltrait entre les lattes de l’assise… Encore, il l’avait baptisé Encore car le banc avait encore vagabondé, au point d’insupporter les sangliers. « Relève-toi Encore ! »… Le jeu de mots lui avait paru stupide un jeudi 5 mars : la clôture du terrain était pour une fois ouverte, le grillage au sol, les pieux qui le tenaient balancés comme des quilles – les sangliers sûrement. Le promeneur s’était approché du banc (cette fois arrimé vers l’ouest). De près, il s’avéra costaud et quasi neuf. Le promeneur faillit s’y asseoir, le bois couvert de rosée et semé de moisissures l’en dissuada. Il se contenta d’une brève caresse, émit un hum et s’éloigna. Le banc désormais s’appelait Hum – l’incertitude de l’onomatopée convenait aux dérobades du siège, aux brèves toux du promeneur. Le Vendredi Saint sa langue fourcha, Hum se mua en Ame – tousser en hum ou en âme aux sonorités voisines, les différences étaient infimes et qu’une âme fasse hum ou qu’un hum engendre une âme l’avait plongé dans une rêverie filandreuse. Oserait-il un jour s’asseoir sur Âme ? « Bonjour mon Âme, comment va la vie ? ». Il avait convié les morts de sa famille à venir s’asseoir sur Âme – une invitation qui avait déclenché cette réflexion : d’autres morts guettaient le moment de s’asseoir sur le banc, des morts qui en pinçaient pour le nord ou la colline d’en face ou le chemin bossu, cela expliquait les manigances d’Âme incapable de tenir en place, sans cesse condamnée aux variations de paysage. Cette Âme, vraiment, était convoitée. En se tassant, on pouvait y tenir à quatre. A trois cela allait. A deux on frisait la perfection : le promeneur avait invité son amoureuse à l’y rejoindre le 20 mars à seize heures tapantes pour fêter le printemps – heure douce, banc ardent, que de plaisirs à consommer en contemplant les épicéas (la châtaigneraie, le ruisseau si l’Âme avait changé d’avis). Que la clôture ait été réparée et l’accès au banc impossible ne changeait rien aux désirs du promeneur : pour lui, tout n’était que songes, souffles fugitifs, émois stériles… La toux s’était soudain déclenchée, sèche et violente au point qu’il en vacilla. Son poumon se rappelait à son bon souvenir. L’autre poumon, celui greffé sur sa fille, était assis sur Âme – un poumon solitaire qui ahanait sur le banc tourné vers lui. Voulait-il rejoindre son jumeau ? La greffe avait été rejetée ? Il se força à s’approcher du banc. Les oiseaux, brusquement, s’étaient tus – leurs chants étaient étrangement au zénith dans cette après-midi printanière. Aux cerisiers, aux châtaigniers, les feuilles bruissaient sous la brise, à moins que ce frémis ne provienne de ses pas sur l’herbe sèche – ou plutôt du poumon, proie d’une asphyxie discrète… Bref il s’était assis et caressait vaguement le poumon comme on flatte le passage d’un chat. Il n’était pas venu pour ça mais pour retrouver son amoureuse, l’inviter à s’installer sur le banc, évoquer leur tendre avenir, lui saisir la main, la taille – un baiser et l’on se croit au paradis. Tantôt il l’appelait Ma Brune tantôt Ma Blonde – Brune divaguant en brume, blonde en onde, ainsi oscillaient ses paysages incertains. Il ferma les yeux, le poumon, maintenant, hoquetait… L’amoureuse avait du retard, trente-quatre minutes précisément, mais l’essentiel était qu’elle soit venue rejoindre le promeneur sur le banc. Elle ne s’était pas excusé, lui avait claqué la bise. Maintenant elle s’éventait avec son chapeau de paille gansé de rouge, un souffle qui semblait apaiser le poumon. Puis, elle avait déboutonné la chemise du promeneur, passé l’index sur sa poitrine. Le thorax du promeneur s’était ouvert, l’amoureuse avait saisi le poumon, d’un coup l’avait remis à la place qu’il n’aurait jamais dû quitter. Un second glissando de doigt avait clos la brèche. L’amoureuse avait frôlé de la paume le dossier de Âme, l’épaule du promeneur, lancé un « à bientôt » qui n’engageait à rien, « à bientôt sur le banc » avait-il répondu. Il avait ajouté Hum et respiré à fond. Deux poumons c’était formidable, sa fille se débrouillerait autrement. On peut vivre sans poumons quand on n’existe pas.
20 mars 2021
FRÈRE ET SŒUR
« Tu es comme ma sœur, tu es ma sœur ». Il la serrait dans ses bras ; collé contre elle il sentait l’odeur de son cou, y posait ses lèvres. Il pleurait presque – elle aussi peut-être. C’était très bien ainsi. Plus tard il comprendrait pourquoi ce désir si violent l’avait saisi en la revoyant de longues années après leurs embrouilles – il nommait ainsi les chemins divergents de la vie. L’essentiel était là, cette nuit, d’être serré corps et âme contre sa sœur. Elle ne le repoussait pas, l’avait enlacé et, la première, avait laissé ses lèvres frôler les siennes. Elles avaient dérivé, s’étaient ouvertes, et le souffle, la tiédeur, bientôt la langue… Quelle chance d’avoir rêvé cela – si tant est qu’il s’agît bien d’un rêve, ce dont il aimait douter. Le souvenir de sa mère surgissait soudain : elle avait voulu une fille – tant pis si ç’avait été un garçon qu’elle se plaisait à habiller en fille, lui interdisant de couper ses cheveux –, elle aurait un jour une fille, quitte à l’adopter pourvu qu’il soit d’accord. Il avait acquiescé, profondément troublé et, dès lors, ses rêveries adolescentes esquissaient cette sœur : il devenait l’amant de la sœur inconnue… Jamais il ne la verrait puisque sa mère était morte peu de temps après… Il avait oublié cette histoire de sœur jamais née, jamais adoptée, il avait souffert, rencontré, aimé des femmes – jusqu’à celle dont il pensait que seules les femmes lui plaisaient – elle se dérobait à ses avances les plus douces, jusqu’à ce qu’elle lui glisse : « Qu’est-ce que tu crois, j’ai souvent eu envie de coucher avec mon frère ». Il s’en était fallu d’un iota mais ils étaient passés à autre chose… Cette confidence remontait à la surface tandis qu’il regardait les vêtements de sa sœur : jetés au sol, ils formaient une drôle de fleur blanche et rouge, froissée. Elle – sa sœur – allongée sur la couverture mauve, attendait silencieuse. Et il l’avait rejointe. Il lui semblait la connaître depuis toujours, depuis le ventre de la mère, ventre fantôme où il se lovait maintenant. Elle tenait sa nuque et, doucement, l’aspirait. « Ma sœur, ô ma sœur » et ce murmure accompagnait leur va-et-vient. Ils avaient toujours voulu être l’un à l’autre et cela venait de s’accomplir, d’éternité l’un à l’autre, dans le parfum d’un peu de sueur, odeur qui l’apaisait, à la fois l’excitait. Elle ne parlait toujours pas, gardait les yeux grands ouverts – sauf à la fin : son bras replié était venu cacher son visage, elle avait gémi sans qu’il comprenne s’il s’agissait de plaisir, de douleur ou de surprise… Les jours qui suivirent, ils avaient renouvelé cette rencontre mais le cœur ne semblait plus y être. Ne disait-elle pas qu’il pourrait être son oncle, elle l’avait toujours considéré ainsi… Cela l’avait vexé – ils avaient le même âge – puis il avait ri de cette fraternité avunculaire, façon de parler, maladresse affectueuse. Elle l’avait persuadé d’être désormais un frère « comme les autres », ajoutant en même temps qu’il était le seul homme dont elle aurait souhaité avoir un enfant… Souvent, après qu’ils se soient perdus de vue (comme on dit affreusement), il pensait à cet enfant, chimère qui le conduirait, main dans la main, vers la mort, lui chuchotant l’histoire de sa mère, « ta sœur, comme tu dis, une femme d’exception, la houle au ventre, qui savait si bien saisir tes doigts et, fût-ce en public, les embrasser, montrant à tous que vous étiez unis, frère et sœur à jamais. »
4 février 2021
CATCH
« Catch à gogo » : c’est écrit sur l’oriflamme qui claque. Sur l’estrade qui jouxte la baraque, les deux catcheuses sont assises. L’une est noire, l’autre blanche. Leurs cuisses débordent des tabourets. Elles portent une cuirasse en satin rouge d’où jaillissent des seins plantureux. A intervalles réguliers, elles se lèvent et s’expédient des bourrades, rigolent puis grondent et se rassoient. Jambes mafflues, biceps de foire, elles me fascinent. Le type derrière moi gueule « C’est l’Trocadéro ! » et Fil de fer se glisse entre les rideaux crasse. Au boniment, il jure qu’on va voir ce qu’on espère et plus encore, Blondie et Nègrette se coincer le muscle, se frotter la sportive. Des professionnelles à mort. Des catcheuses vicieuses, des furies sans pitié. Du vrai catch. « C’est Valparaiso ! » clame un quidam arrière – comparse ou sincère ? Le vieil efflanqué se colle à mes fesses, beugle et remue de l’avant. Les catcheuses esquissent une pataude, un tralala du cul. Le quidam me pousse vers l’estrade, il crie « c’est Toto qui paie ! Toto pour le p’tit. » A l’intérieur, le ring et trois gradins. Et moi, dans la pénombre avec Toto qui me gâte. Je n’aime pas trop mais j’écarquille : Nègrette empoigne Blondie, la plaque au sol, s’assoit sur elle – qui l’expédie d’un coup de rein dans les cordes. L’efflanqué agrippe ma braguette, j’ai honte mais mon sexe gonfle, j’avance vers le ring… Comment me dégager sans causer de scandale… L’efflanqué est costaud – moins que les catcheuses : ont-elles vu le manège ? Roulées en boule, elles atterrissent à deux pas, sautent de concert sur le ring – fameuse caisse de résonance qui chamboule Toto. Il me lâche, il me sourit, je file, cours hors de la baraque avec cette angoisse : il va me suivre, m’attaquer ailleurs… Cette rue je la connais par cœur : au 10, au deuxième étage, une porte anonyme ouvre sur un étroit corridor qui débouche sur un autre immeuble, une autre rue. J’y suis. Seul. N’empêche : j’ai raté la fin du catch, même si je sais que tout y est truqué j’ai raté les catcheuses.
Février 2021
LA PAIRE
Ils disent que tu es maigre et que je suis gros – donc que nous faisons la paire. Question d’équilibre, de juste milieu. Les adultes sont de sales farceurs. Face à nous, la Méditerranée se prélasse, les vaguelettes chutent sur la plage des Sablettes. Il faut partir, bientôt nous quitter pour de bon, pas seulement abandonner les bains de mer jusqu’à demain : nous séparer, plus jamais je ne reviendrai ici en vacances, plus jamais nager ensemble, faire mine de pêcher dans les creux de rochers, se cacher, serrés l’un contre l’autre, dans l’immense passe-plats de l’appartement – jamais ton grand frère ne pensera que nous y sommes tapis. Nous nous entendons à merveille – du reste je t’ai prise en photo chez toi, assise par terre – un rayon de soleil te traverse en diagonale et tu me regardes, exactement comme tu me regardes quand les adultes sonnent la fin du bain. Je dois ôter mon slip, me rhabiller, et vite car la famille s’impatiente. Alors tu tends devant moi une serviette, tu m’en frottes rapidement, ta main frôle mon sexe sans que je sache si c’est exprès ou non et tu me regardes je crois avec amour.
Février 2021
PRISON
La prison, immense, presque neuve, campe au milieu d’un no man’s land où voltigent des flopées de sacs en plastique. Autour, des champs désertés, au-dessus un ciel de nuages et de vent. La prison est une maison d’arrêt – rien qu’une demeure où s’arrêter un temps très incertain. Une succession de portes, de vitrages blindés, de couloirs astiqués, d’échos – voix, ouvertures, fermetures de portes. On ne s’habitue jamais à entrer là, ni aux sas où il faut stopper, se faire contrôler, ni au vide, ni, encore, aux voix qui s’évanouissent, affreux murmure infiniment sonore. Je ne vois pas le visage des matons, seulement leurs uniformes, les jambes de pantalon qui me précèdent dans les corridors bleus ou canaris. Les prisonnières ont été triées, s’il en manque une c’est qu’elle a été punie, privée de ces deux heures où raconter, écrire ce qu’elle veut de sa vie, réelle ou inventée. J’ignore pourquoi elles sont emprisonnées – la règle du jeu impose cette sorte d’anonymat, sauf quand elle est rompue. Une matonne m’informe que la sympathique sexagénaire, grande participante à nos rencontres, dont je souligne le talent, est un meurtrière – elle a tué sa fille. Cela me force à imaginer qui sont les autres, dont je ne sais rien, à couvrir leurs visages d’un crime ou d’un délit. « Aller et revenir sans croiser une idée », contre quoi je me bats, est une bataille désormais pervertie par la vengeance d’une gardienne dont les motifs m’échappent, ou son désir de battre en brèche ce qu’elle pense être ma naïveté. Aller et revenir sans croiser une idée – aller et venir aussi, arpenter la clôture, celle de la maison d’arrêt, celle du cerveau. S’y cogner en silence ou avec ces cris soudain entendus, suivis d’une cavalcade et d’un bruit sec de porte battue. Colère, révolte, souffrance – je ne sais… Les cris viennent mourir du côté de la sortie où je suis, prêt à franchir le guichet qui conduit au monde libre.
Février 2021
VIVAT !
Nous étions là, debout, trempés d’embruns car le vent fouettait, debout à regarder le temps passer (passé ?) depuis la baie des Trépassés. Vivat ! Vivat ! répétions-nous dans cette contrée sauvage, dans le remugle des vagues et soudain leur fracas. Nous avions emmené l’urne grise sans trop savoir qui l’ouvrirait, s’avancerait sur les rochers, verserait les cendres au tourbillon d’écume. Nous étions incrustés là, sans rire et sans pleurer, juste à gueuler vivat. Le froid venait, la nuit viendrait… La belle-sœur a cessé de brailler, s’est avancée, a dévissé le couvercle de l’urne, reniflé les cendres avant de les jeter dans l’océan, d’un coup – puis d’envoyer valdinguer le récipient dans les vagues. Nous étions là depuis un bon moment, vivat avons-nous cette fois chuchoté – à peine un souffle, l’étirement d’une lèvre, le chuintement des langues. Vivat. Vivat les confins du monde, vive les confusions, « nous marchions dans les nécropoles » des bords de mer, à reculons, soudain lentement, toute la famille à reculons au risque de chuter dans une faille. Le brouillard s’était levé, escamotant la grève, nous murmurions le nom du défunt, ses qualités infinies, ses défauts amusants, sa date de naissance, celle de sa mort, jurant qu’il avait passé de bons moments. Nous comptions ces bons moments sur nos doigts : à nous cinq le total dépassait de beaucoup les doigts d’une main et même de deux – nous étions soulagés, presque heureux de cette conclusion optimiste. Si le brouillard avait été moins féroce nous serions allés trinquer au disparu – au noyé, rectifia la belle-sœur qui avait été aussi son amante, ce que chacun savait et taisait. Nous sommes rentrés. Chacun chez soi au coin du feu, solitaire sous la couette à entendre la tempête cogner aux vitres – elles tremblaient, gémissaient, fendillaient le mastic.
Janvier 2021
8, RUE DES ANGES
Toutes les anges sont des femmes. J’ai croisé une ange. Elle paraissait préoccupée, voletait rapidement – sa robe rouge, longue, sans doute en mousseline, amplifiait ce frôlement aérien. Le rouge coquelicot contrastait avec l’immaculé des ailes. Les plumes d’ange sont incomparables. Rien à voir avec celles du canard, du cygne ou de l’autruche : elles sont impalpables. La plus exquise douceur n’arrive pas, si j’ose dire, à la cheville d’une plume angélique. Leur frôlement, à peine un souffle, s’accompagne d’un parfum de frisson… Oui en croisant l’ange, j’ai senti cet indéfinissable embaumement : elle m’a fait rebrousser chemin. Je me suis mis à suivre l’ange, à trotter puis galoper car elle accélérait. Je craignais qu’elle ne décolle, il n’en fut rien. Elle bifurqua au numéro 8 de la rue des Anges – la scène se passait à Lyon –, juste derrière le commissariat de police. La rue des Anges n’a rien de folichon : à gauche des maisons saumon écaillé, à droite un long et haut mur assorti, une sente étroite à gros pavés, bonne à trébucher. A l’angle de la rue Basses-Verchères un graffiti affirmait : « J’avais de 0 à 30 ans ». Je vis l’ange s’arrêter soudain, poser un doigt sur les chiffres qui, aussitôt, devinrent rouges – exactement du même rouge que celui de sa robe –. L’Ange ensuite se retourna vers moi, ailes rabattues. Au point où j’en étais – le ravissement n’empêche pas la curiosité – j’osai lui demander ce qu’elle trafiquait rue des Anges mis à part enluminer les graffiti. Elle me répondit : « Je m’amuse et je t’attends ». Sa voix (très suave, remontées aigue en fin de phrase) me troubla, je faillis m’agenouiller. « Tu es un rigolo, j’adore rigoler » Un petit coup de plumes, je me redressai. « Je sais ce que tu penses : les anges sont des femmes. Vérifie par toi-même. » Ses ailes battaient si fort que sa robe valdinguait, se soulevait. Je regardai : il y avait bien là un sexe féminin, comme un feston sur la peau très blanche. « Je sais que tu voudrais toucher : n’hésite pas. » Je touchai – très délicatement mais je touchai. Mon index s’enfonça dans un monde chaud et gluant. Je retirai mon doigt : il était rouge, du même rouge que le graffiti transfiguré et la robe coquelicot. L’Ange avait ses ours et se marrait : « Quand la plume se fend, voilà le résultat. La plume ou l’aile… Reviens me voir le mois prochain. Rue des Anges. Promis ? » Elle s’envola. J’étais aux anges.
Janvier 2021
J’AVAIS DE 0 À 30 ANS
C’est elle qui habitait là, qui m’appelait mon ange, que j’appelais mon ange. Etions-nous vraiment des anges ? Nous baisions comme des anges disait-elle en baissant la voix, puis elle se rhabillait, elle chuchotait : « Les anges, ça bat de l’aile ? Les anges, ça se mange à la broche quand on les a déplumés ? Les anges, ça pond des œufs ? »… Ou bien on s’endormait poitrine contre poitrine, serrés à défaillir… Rue des Anges, avec un F ça donne rue des Fanges. La bassouille s’écoule, reste les anges. Ç’aurait pu être rue des Franges – mon ange portait une frange qui lui mangeait un sourcil. Ou rue des Langes en souvenir de notre angelot, de notre chérubin, nous le bercions à l’ombre des persiennes. Rue des Anges c’était parfait.
…J’oubliais la statuette de l’ange encagée dans l’angle de la maisonnette, jamais un ange sous les barreaux ne s’envole.
…Plus jamais j’avais – à trente ans on repart à zéro, c’était dans mon horoscope le jour de mes trente ans qui était le même que le sien, deux anges nés le même jour à l’âge zéro et qui allaient périr à trente, elle et moi, main dans la main on se remémorait nos vingt-neuf ans et, à mesure que nous descendions la rue des Anges, nous comptions à rebours jusqu’à l’an fatal, zéro. Peut-être avions-nous éclos du même œuf, jaillis pinceaux à la main, et commencé jour après jour par touchettes, minuscules impacts et nuances, à écrire l’imparfait sur le mur de notre vie. Les volets ne s’ouvriraient plus jamais, plus jamais de missives dans la fente de la boîte aux lettres, à même la vieille porte ouvrant sur la cour de la maison – combien de fois avons-nous remisé nos plumes pour en franchir le seuil, elle surtout, mon ange, dont les ailes, pour des raisons qu’elle tenait secrètes, poussèrent plus vite que les miennes !… Elle prétendait que cette porte ouvrait sur un ancien couvent patronné par Saint-Just, l’ange de la Terreur et, disant cela, elle venais se nicher entre mes bras, ou c’est moi qui, proférant à voix basse ce mensonge me blottissais contre ses seins. Peut-être que, de zéro à trente ans, j’avais consenti à perdre mon temps, elle aussi bien qu’elle fût beaucoup plus active que moi… Ô jeunesse enterrée ! Oh Oh ! ajoutait-elle : notre hymne en valait d’autres et sa rapidité incarnait la fuite du temps, son accélération brutale juste avant la chute, guillotine, clac et voici l’imparfait toujours à regretter la perfection, toujours en passe d’être défait.
31 mars 2021
ANGUS
Angus se désespère face à ses défaites. Il préfère jouer à la poupée, à la dînette. Plus tard il sera martien ou général, un jour prochain on lui coupera sa longue frange pour qu’il soit enfin un homme – le maître s’est montré ferme : il a bloqué Angus dans la cour de l’école… « L’année prochaine tu seras dans ma classe. Je n’accepte pas les filles. » Il avait désigné la frange, de l’index et du majeur mimé un coup de ciseau… Le soir, dans sa chambre, Angus se regarde dans la glace – la grande glace au dessus de la cheminée, miroir si haut qu’il doit se hisser sur la pointe des pieds pour manier les ciseaux, cisailler un bout de frange. C’est là que Maman intervient. Maman voulait avoir une fille, elle se contente d’un garçon. Pourvu qu’il ait une frange, au moins une frange « sur ton grand front mélancolique », cela ira. Elle contemple Angus, récupère les ciseaux, ramasse les cheveux tombés sur le dessus de la cheminée, les cueille avec grand soin – elle les glissera dans un médaillon ovale qu’elle portera longtemps autour de son joli cou. Il reste pas mal de frange, les trois-quarts au moins. Maman regarde les dégâts : « Il manque une dent au râtelier ». Elle sourit, sa main froisse les cheveux d’Angus. « Ça repoussera ». Angus rapporte les paroles du maître. Maman hausse les épaules : « Tu n’es pas une fille, ça se saurait ! Vraiment ça se saurait » Elle baise le front d’Angus. « Un jour j’aurai une vraie fille, tu aimerais avoir une sœur, non ? » Angus répond oui, bien sûr. Il a toujours rêvé de tomber amoureux d’une sœur. Qu’elle vienne et vite, dans le ventre maternel puisque tout se passe là-dedans – et il caresse ce ventre avant qu’elle ne s’enfuie, légère comme toujours. Angus pense qu’elle l’abandonne, encore à galoper avec Papa au théâtre, et lui, seul dans la nuit avec sa frange mutilée… Le tube à dormir est derrière le vase de Venise rose. Il se reflète dans la glace, un gros ver de terre immobile. Angus dévisse le couvercle, avale un comprimé blanc – c’est bien ainsi que Maman fait ? –, puis un autre, un autre encore et la suite. Il va dormir.
Janvier 2021
CONTEMPLATION
Elle est fine, plutôt grande, seins et fesses menues et les yeux, grand Dieu, les yeux : un regard du tonnerre ! Les doigts ? Longs et costauds. Et les jambes, que dire des jambes, et le ventre à peine bombé… Je n’écris pas cela pour flatter un être d’exception – admettons que je rêve de coucher avec elle. Je lui ai écrit un poème pour ça (« Pour ça » est le titre d’un éloge mérité). Pour toi je me damnerai, etc. Le dimanche après-midi, elle se déshabille et me laisse l’admirer. Pas question de toucher, juste regarder. La contemplation excite ? Ce n’est pas son affaire. Parfois elle baille un peu et s’en excuse puis me demande si je vais bien, si mon truc progresse parce que, dit-elle en souriant, les meilleures choses ont une fin. Question d’imagination, ajoute-t-elle en s’approchant de moi – si près : je sens son souffle, j’entends sa respiration, je respire son odeur. Immobile, elle plante ses yeux dans les miens jusqu’à ce… Puis elle se rhabille – « un peu froid, tu comprends » – et me raccompagne à la porte du palier : « Bonne semaine et à dimanche. » Vingt-deux marches me séparent d’elle et la rue maintenant. Le rideau de la fenêtre s’écarte à peine, juste de quoi voir un visage, et une main qui salue.
Décembre 2020
QUELQUE CHOSE DE L’OUBLI
Quelque chose de l’oubli… « J’ai oublié quelque chose, attend, je reviens. » Et personne ne revient… Se souvenir qu’on a oublié est inquiétant, oublier de se souvenir le serait aussi. Le pire est dans « quelque chose », innommable, très hasardeux ce quelque chose de l’oubli. Toi, ainsi évanouie, sans retour… Reste à t’imaginer ailleurs, incertaine, à la recherche de quelque chose et, forcément vieillissant, morte, vite oubliée ou pas trop vite puis à la fin dégringolée – d’avoir trébuché sur quelque chose enfin découvert : « c’était donc ça ! » Hélas il est trop tard pour revenir (vers qui du reste : tu ignores vers qui ce retour inopiné, inattendu, ce revenez-y vers un autre sans doute disparu). Ô mon amour oublié, comment sommes-nous devenus quelque chose ? Tu es partie en fermant doucement la porte – non : en la claquant à pleine volée car tu courais après quelque chose, disant qu’il fallait attendre et que tu reviendrais, sans doute très vite – ou jamais, ce que nous ne savions pas – non : tu as laissé la porte ouverte, tu as quitté la maison, je t’ai vu filer à travers le jardin, un léger signe de main, comme une main recroquevillée signifiant un retour rapide ou un repli. Je reste, sans savoir quoi dire, quelque chose de moi (d’émoi ?) reste, oubliant pourquoi demeurer dans la maison déserte – encombrée de souvenirs indéchiffrables donc vide. J’ai cessé de pleurer, de répondre non aux questions amicales : « Quelque chose te ferait plaisir ? ». D’ajouter : « N’oubliez pas de fermer la porte. » Quelque chose, ces mots me font quelque chose puis rien, quelque chose de l’oubli.
Décembre 2020
LA PIPE
…Certain qu’on le retrouverait sur le sentier où il fumait la pipe – où il avait, définitivement, cessé de fumer la pipe – il avançait à petits pas. Il avait oublié comment le chemin bifurquait, remontait, s’embrouillait dans les bois, finissait par redescendre du côté du ruisseau aujourd’hui à sec. Les volutes de fumée disparues tournicotaient dans son crâne. Depuis quand avait-il mis au rancard la pipe en bruyère, la boîte de tabac odorant ? A force d’avoir mal à la gorge il avait remisé l’attirail aux fins fonds de l’armoire. Le corps médical l’avait félicité, son épouse aussi. Il ne fumerait plus, l’affaire était close. De temps à autre, il ouvrait l’armoire, vérifiait la présence du matériel. Il lui arrivait même de renifler le tabac. On ne sait jamais, n’est-ce pas ?… Ce matin, il avait glissé sur le sentier – ces pierres qui roulent vous jettent dans les ronces. Il avait réussi de justesse à se rétablir. Maintenant, assis sur une souche, il regardait l’univers des orties et des mouches, les mousses cramées par le soleil, les fougères grillées – il n’identifiait rien, les noms des insectes, des plantes, s’étaient éclipsés. Leur grouillement tendait vers l’infini. Quelques gouttes de rosée faisaient encore illusion. Leurs pointes luisantes s’évaporèrent. Il aurait voulu les toucher mais c’était trop tard. Il perdait petit à petit ses points de repère. La fumée tournicotait, s’envolait vers un ciel déjà immaculé, une masse bleue. Le parfum du tabac chatouillait son gosier. De cela il se souvenait, et de la tête chaude sous ses doigts, du tuyau humide. Il tétait le bouton de la tige comme on tète un sein, longuement, minutieusement, la vapeur alors l’envahissait – une invasion voluptueuse, propice aux rêvasseries, aux vagabondages des sens et à la libération d’une dose d’humilité. Il disait cela dans le temps, sans pouvoir expliquer pourquoi ce mot désuet lui semblait convenir à son état vaporeux, relevé d’une virgule acide. Cela ouvrait sur une large rive verdoyante, une vasque offerte à l’eau tranquille d’une rivière où défilaient des cols verts – une entrée théâtrale dont il n’arrivait pas à trouver l’origine. Ces comédiens emplumés fendaient l’onde, laissant derrière eux un sillage impeccable. Il les enviait de cancaner avec tant d’assurance et d’insouciance. L’un des canards s’envola dans un froufrou d’ailes. On aurait dit le satin froissé d’une robe. Jade ôtait ainsi sa robe, rapidement, et, presque nue, lui tendait les bras. Il venait de retrouver le prénom, sans en être sûr : peut-être confondait-il Jade et jadis. Mettre jadis à nu est agréable quand on a tout perdu – Jade n’était que le reflet d’une âme à l’esquive. Il murmura : Toi, avant la fin du jour… D’un coup, le rideau des ténèbres tombait, écrasait un tapis de myosotis. Sa mémoire se muait en boule compacte. Elle roulait devant lui, l’obligeant à cavaler – donc à trébucher à nouveau. Cette fois, il ne se releva pas : pelotonné dans les bruyères, il attendait le passage de la douleur. Quand elle serait évanouie, il serait temps de monter sur scène pour évoquer les paysages dangereux qu’il traversait. Cela tranquillement, assis, en fumant la pipe. Un mot ou deux, une bouffée – dramaturgie dont la simplicité le réjouirait. S’il avait été musicien (ce dont il rêva longtemps), il aurait… ou chanteur (ce qu’il espéra souvent)… Mais il n’était devenu ni l’un ni l’autre, juste bon, au fil d’une balade, à cogner une pierre sur une autre en espérant la résonance – ou à fredonner, avec parfois l’essai d’une trille… Pour l’instant, tapi dans le trou du souffleur, il regardait le plateau violemment éclairé – une lumière blanche où vaguaient les jambes et les pieds de Jade. Elle était muette, peut-être dansait-elle comme jadis dans les décombres de leur couple tandis qu’il tapotait sa pipe froide sur le plancher. Décombres, le mot lui plaisait, il le répéta. L’ombre de Jade valsait sur les décombres de sa mémoire et la douleur montait, insidieuse, s’infiltrait. Sa main gauche griffait la mousse – une poussière grise s’en éleva –, la droite triturait son épaule où la douleur s’arrondissait avant de galoper vers la poitrine… Une bogue de châtaigne dégringola. Ses fruits échappés s’échouaient, rutilants. Il aurait aimé évoquer la futilité et la voracité de la vie, se rabibocher avec deux ou trois souvenirs, les délivrer comme on presse une éponge : l’eau ondule, les doigts restent un peu gras – mais la mémoire est sans issue… Parfois, si l’on respire à grandes goulées, un semblant de mémoire peut resurgir, une estafilade – mais ses poumons s’atrophiaient (de vulgaires petits sacs en plastique que les enfants gonflent et crèvent, combien de fois avait-il joué à ça), l’air de la montagne y pénétrait à peine… La pipe se bouchait, la fumée refluait, le fourneau grésillait, il persévérait, aspirant un semblant de tabac, une giclure de salive, infecte de nicotine. Faudra déboucher. Il ferma les yeux. Le voile noir s’installa. Inutile de regarder un paysage qui se disloque. Le paysage était à l’intérieur de son corps, il agrippait son cœur, un coup de tenaille aigu et ce serait fini. Toi, avant la fin du jour : l’antienne tournicota sans qu’il puisse identifier ce Toi. S’agissait-il de lui, mort au crépuscule – ou de Jade qui, avant la fin du jour, révélerait l’amour qu’elle lui portait, tomberait veuve à la brune ? Jadis il fumait la pipe.
2 octobre 2020
« LES STATUES PARLENT AUSSI »
A Yvon Davis
Sans doute parce qu’il n’y a aucun pin aux alentours, pas même un rabougri, je me souviens parfaitement du château du Pin. En dépit de la sécheresse, il y a toujours des roses, dans ses jardins, des roses anciennes : Liza m’explique qu’elles demandent très peu d’eau. Nous jouons ensemble, je porte mon chapeau de gendarme en papier journal et je brandis mon épée. Le journal, c’est le Canard enchaîné (le nom me plait, j’imagine un caneton menotté, claudiquant). J’ai peint en rouge l’épée de bois à cause du sang – à force de blesser, de fendre, de tuer voilà le résultat. Je pose l’épée dans l’herbe pour couronner Liza – une couronne de princesse, dorée comme ses yeux sous le soleil. Elle tient son voile (tulle blanc qui voltige au vent). La couronne descend doucement sur le voile… Chevalier servant d’une noble damoiselle, je lui offre mon cœur et ma protection. Liza refuse. « Les statues ne veulent pas », dit-elle. Je regarde les statues : elles restent muettes parmi les fleurs. J’entends seulement le bruissement de mes pas, l’imperceptible sifflement des hautes herbes… Liza a disparu, couru ainsi qu’elle sait le faire, silencieuse, peut-être va-t-elle cueillir des narcisses du côté du bassin ? Elle les offrira à la Nymphe de l’enclos, posera le bouquet sur ses genoux de terre cuite. Je devine la suite : présenter la couronne, le voile, balbutier un compliment. La Nymphe appréciera. Liza me racontera les paroles un peu obscures de la Nymphe – remerciements assortis de légers rires, cri soudain dont elle ne sait s’il ponctue le passage d’un oiseau de proie ou traduit une douleur – la mousse, peu à peu, gangrène la peau de la Nymphe, fissure sa chair… Libre à Liza d’inventer ses dialogues avec la Nymphe de l’enclos – tresse de fers dont les croisements, l’emmêlement m’évoquent des instruments de torture… Parfois je plains la Nymphe mais pas trop : elle a sûrement des raisons de vivre là. Liza et elle s’entendent bien, la Nymphe me demeure étrangère. « Chacun son truc », comme disent les Nains de jardin… Eux et moi sommes copains comme cochons. Ils ne finassent pas, ne rêvassent pas. De bonnes petites brutes bleues qui en savent long sur les mystères du coin, qui trame quoi avec qui, ronces, genêts et patali et patalo. La vie secrète des nymphes n’a pas de secret pour eux. Mais motus, méfiance… Les Nains de jardin aiment « foutre le bordel » (ce sont leurs termes) : changer les étiquettes de place, inverser les fléchages, commenter l’anatomie des passants – des passantes surtout. « On va te lubrifier ! », « A croupetons canasson ! », « On carnavale ? » Et ils carnavalent, lubriques et sérieux comme des papes, justement au cœur d’une jungle de monnaie des papes… Dès que Liza apparaît, le silence, l’immobilité reviennent. Les Nains de jardin se tassent dans les oreilles de lapin (Stachys byzantina), puis papotent botanique : oreilles de lapin contre oreilles d’ours, voire de lièvre. Le principal est qu’elles soient duveteuses : on s’y roule, on s’y planque, on reluque, on fornique, on danse… J’aime danser avec ces tristes lurons, entendre pépier leurs tambourins. Liza prétend que j’ignore le b a ba de la danse qui, selon elle, encense les Nymphes. Chaque pas de côté mène vers une statue, chaque déhanchement… Je n’ai pas vu revenir Liza mais je la vois danser avec une telle légèreté qu’elle semble invisible. Les statues lui parlent. Je n’invente rien : bribes de mots, fragments de chansons, soupirs – cela je l’entends comme on perçoit d’une langue étrangère l’intention, les invites, sans pouvoir en saisir le sens précis. Liza connaît leur langue mais elle refuse de traduire. Au reste, traduit-on l’extase, la souffrance, la guerre, l’amour, leurs excitations par la banalité des mots ?… « J’apprends, dit Liza, j’apprends beaucoup : quand les statues parlent d’elles, c’est de moi qu’elles parlent. Tu comprends ? ». Je ne comprends pas mais j’ai peur. Si les statues parlaient de moi sans que je saisisse leurs paroles, j’aurais peur… Le mode d’emploi est pourtant simple : tu danses devant la Nymphe, elle parle et chante. Tu poursuis ton chemin vers une autre statue : gigue ou valse, tu gambilles et les sons fusent dans chaque bosquet. J’ai même l’impression qu’ils jaillissent de mes paumes. Si je claque des mains c’est moi qui danse la tarentelle… Liza, avoue-t-elle, rêve d’être une statue offerte au vent, à la pluie, aux bourrasques, au soleil, à la neige, aux regards. Aujourd’hui, nous jouons au cerceau dans les allées, le cerceau tombe au sol – deux ou trois rebonds, il s’affale. Elle, au centre, immobile, soudain lève une main vers le ciel : « Il va pleuvoir mais je m’en fiche : je suis une statue »… Je n’avais jamais vu Liza nue : c’est fait. Elle vient de jeter ses vêtements dans les bleuets. Elle est blanche. Elle est pétrifiée et j’ouvre grand mes yeux. J’ignore si elle me voit. Liza est ailleurs. Je devrais danser devant elle, adroit ou maladroit, je devrais, mais je n’y arrive pas – alors c’est elle qui danse, non danse enfantine mais troublante, au point qu’une étrange vibration s’empare de mon corps, ma peau frétille : Liza devient une femme, cette femme est une statue, je regarde cette statue qui ondule, rythme son mirage. Liza, maintenant, se dirige vers le bassin, elle enjambe le rebord moussu – son ventre aussi abrite une pointe de mousse blonde. Je découvre cela et je regarde. Une déesse, voilà ce que je mate – et mon cœur bat à rompre et mon jeune sexe gigote… Une déesse, une statue de chair qui s’aperçoit de ma présence, de mon regard, de mon désir. Elle me lance de l’eau au visage – non comme avant, quand nous nagions dans le bassin, en nous aspergeant, en riant : une lancée violente, l’onde froide, des flèches, de brèves lames éclatent sur mon front, mes yeux. Liza s’éloigne et plonge, sa tête ressort, elle parcourt sans fin le cercle du bassin tandis que je souffre comme une bête. J’ai voulu voir. J’en suis puni d’une terrible façon : mon crâne explose, mes mains, mes pieds s’écartèlent. Je suis, corps et âme, métamorphose, proie d’une rumeur : abois jaillis des fonds du jardin, hurlements de chiens qui, bientôt, me sautent à la gorge. Liza ! Je crie son nom, je tremble. Peut-on crier secours vers une statue dressée au centre du bassin ? L’eau jaillit de sa bouche, ruisselle, brille sur la poitrine, le ventre. Liza ! Liza ! Je souffre comme une bête ! Un seul mot de Liza me sauvera, les statues parlent aussi, cela je le sais…
Paroles des statues :
Ô roide
Ô extase
Ô douleur
Ô jouissance
Ô vient au ciel
Ô vient en terre viens
dans ma terre
Ô vient au feu viens
dans mon feu
Ô vient au souffle viens
je m’essouffle
Ô vienne l’eau d’où terre, feu, souffle
procèdent
Celui-là l’insensé
Qu’il périsse
A feu petit à peine
foyer
S’étire le temps
L’enfance de l’homme
En lui s’annonce
Un regard vif darde
L’Intouchable
Qu’il périsse
Non en homme mais en bête
avide
Les chiens accourent
Silencieux
Puis hurlants se bousculent
Claquent leurs crocs
Sur l’enfant fait homme
D’un regard sur une femme
Homme à demi
dévoré
Lambeaux
Ils ne voient rien
Les chiens
Hors une bête
Qu’ils dévorent
Affamés
Puis gémir aux pieds de L’Intouchable
Maîtresse
Caresse où l’œil dort
Haut jouir
D’un croissant
lunaire
Aux cheveux de
Au crâne de
Ne pas nommer
Elle n’est plus là
28 juillet 2020
FEMME GALET

Dès qu’il m’a vu approcher, il s’est éloigné du renard empaillé – celui qui veille près de la porte. J’ai cru qu’il allait recommencer : arracher une touffe de poils de la queue. Je lui ai demandé pourquoi il faisait ça. Quand on pêche, on ne résiste pas à la tentation, il m’a répondu quelque chose comme ça. Un grand pêcheur comme lui en connaît un rayon sur les leurres, les amorces. Rien de mieux que le poil de renard, la couleur, la souplesse, le renard roux d’abord mais le renard chinchilla a ses adeptes. Le saumon s’y laisse prendre, les truites, les ombres. Une fameuse sauve bredouille ! Soie poissée et poils de queue, manigances sur l’hameçon, ébouriffer avec l’aiguille… Je n’ai pas tout compris tant il parlait vite. L’histoire du sauve bredouille, son nom, m’amusaient et je lui ai dit. Il vivait pour la pêche – au point de passer des Pyrénées à l’Auvergne pour assouvir sa passion. Il partait seul, laissant sa femme et ses filles à la maison – elles en avaient par dessus la tête de la pêche, des rivières, des leurres, de l’immobilité. Il le regrettait mais ne leur en voulait pas, quitte à rester immobile, de préférer la télévision. « Je ne peux pas m’empêcher de pêcher », a-t-il conclu en riant. Je voyais qu’il hésitait à partir. Il caressait le renard, je crois même l’avoir entendu le remercier. Il a fait quelques pas vers la porte, s’est retourné vers moi avec une drôle d’étincelle dans l’œil : « Il m’est arrivé un sacré truc jeudi dernier… » Il regardait filer sa ligne au bord de l’Adour – une heure qu’il restait ici, à fixer sa mouche en poil de renard sans rien prendre. L’eau courait, froide, peu profonde ; le soleil irisait une myriade de vaguelettes. Dessous, les galets luisaient, recouverts d’une fine couche d’algues brunes. C’est là qu’il avait vu la tête de la femme, galet parmi les galets. Oui, une femme galet – enfin son visage lunaire, bouche pulpeuse, yeux enfoncés. Des yeux « incertains qui lui donnaient l’apparence d’un rêve », précisait-il. Quelqu’un avait dû sculpter ce caillou avant de l’immerger, de le jeter peut-être comme on se débarrasse d’un objet incongru. Le pêcheur avait délaissé canne et hameçon, s’était penché et avait « capturé » (c’était son mot) le galet. « Croyez-moi : hors de l’eau, c’était un galet rond, légèrement visqueux, rien d’autre. » Il avait replacé le galet dans l’onde et, aussitôt, la bouche, les yeux, l’expression « attentive, oui, attentive » étaient revenus. Trois, quatre fois, il avait répété l’expérience, obtenu le même résultat. La tête vivait dans l’eau et disparaissait à l’air libre. Une métamorphose due peut-être aux jeux de la lumière et du courant fluvial. Le pointillisme de l’un croisant le flux cristallin de l’autre livrait cette tête ? Rien de sûr. Si la tête avait été une sculpture, il l’aurait ramené chez lui. Il avait laissé la femme galet au creux de l’Adour – « au creux de l’Amour », avait-il blagué. Pas de sauve bredouille ? avais-je demandé. Non. La vérité est qu’il était tombé amoureux, le coup de la sirène en quelque sorte. Dimanche, il partirait pêcher là-bas – à la pleine lune, pour en savoir plus, puisque ce visage évoquait l’astre, ses ombres et ses cratères. A y bien regarder, elle ressemblait à la lune de Méliès, grotesque en moins. « Mais moi, ce n’est pas de la science-fiction » ajouta-t-il. Maintenant, il chuchotait : « J’ai peur qu’elle meure, sinon je la rapporterais à la maison. Oui, même sans rien, sans les yeux, sans ses lèvres. Si je la caresse, ça lui fera de l’eau, de la lumière, tout ce qu’il lui faut pour vivre… Et avec mes larmes, vous croyez que ça marchera ? »
7 juillet 2020
ESTHER
Se tenir à carreau. Tiens-toi à carreau. Garde ton arbalète. Je n’arrête pas de me dire ça. La haute-fonctionnaire onusienne m’intimide. Danoise, mais au teint mat. Brune, grande, nippée soft, œil vide. Elle parle, j’approuve. Elle mange, je grignote. Elle en pince pour la culture – est là pour ça en face de moi. Aucun risque de l’interrompre : elle sait tout du dessous des cartes. J’aimerais qu’elle boive, se lâche – elle ne sirote que de l’eau minérale – ou se taise, s’endorme un brin, que sa tête bouclée bascule sur mon épaule. Je pourrais ainsi tâter cet occiput savant, oser une caresse sur cette oreille ciselée, ourlée fin, glisser une main vers sa poitrine, connaître son haleine. Tandis que je me lève – il est temps de prendre congé – elle me conseille soudain de lire la Bible, ou de la relire. Elle est debout, vraiment très grande, taille mannequin, beauté chaude et froide, voix lisse – n’était son léger accent scandinave : « Ouvrez la Bible au hasard… ». De son sac Hermès elle tire le saint ouvrage. J’obéis. « Lisez ». Je lis. « Prière d’Esther. La reine Esther cherchait aussi refuge près du Seigneur dans le péril de mort qui avait fondu sur elle. Elle avait quitté ses vêtements somptueux pour prendre des habits de détresse et de deuil. Au lieu de fastueux parfums elle avait couvert sa tête de cendres et d’ordures… » Dois-je continuer ? « Vous le savez, Esther est mon prénom. Vous ouvrez la Bible au hasard et me voici devant vous. Vous savez tout sur moi, pourquoi j’ai défait ma chevelure, coupé ma tresse, comment ensuite j’ai quitté mes vêtements de suppliante et revêtue ceux de la splendeur – pour vous peut-être, Monsieur, venu me tirer les vers du nez. Et je vous ai donné ce que vous souhaitiez, ce blabla ; et je vous donne Esther, ce que vous n’attendiez pas, Esther en joyeuse parure. » Elle se tait, puis : « Au fond, je suis une femme tranquille, je n’aime ni boire, ni coucher… Sauf qu’une femme tranquille peut avoir envie de boire, de coucher jusqu’à plus soif, de souiller sa couche, de dormir dans l’intranquillité, sous un ciel inattendu… Juste une idée qui passe qui me suit, comme dit la chanson, juste une idée, pas ce que je suis… ». Ayant dit cela, Esther me tend sa main droite à baiser – main forte et fine prolongée d’ongles ras. Mes lèvres l’effleurent, et ses doigts, d’une pichenette, m’expédient au diable : « Farvel, min kærighed. »… Deux jours après notre rencontre, Esther se jette dans la Seine.
IN UTERO
In utero, j’ai dansé au 14 Juillet, au bal musette, rue de la Grange Batelière. Je revois la scène comme si j’étais hors du ventre de Maman alors que je tripotais encore dedans pour deux bons mois. Mes oreilles et, plus étonnant encore, mes yeux transperçaient les entrailles maternelles. J’ai tout vu. Tout. Les guirlandes de drapeaux, l’orchestre… Tout vu, tout entendu, valse et tango, jazz et cha-cha-cha. A croire que j’étais dans la rue, entre le bistro et l’entrée du passage Jouffroy car je voyais Papa et Maman enlacés, et comment ils tournaient et riaient. Tout cela depuis le ventre, comme si j’étais au balcon pour jouir de la chaleur de la nuit, des trois projecteurs braqués sur l’estrade où s’escrimaient les musiciens. Et Maman qui transpirait (étrange sensation de percevoir la suée à l’intérieur et à l’extérieur de son ventre). Pas étonnant, après ça, que je naisse avant terme dans un couloir, entre deux placards – celui de gauche où Maman range sa poudre de riz et ses dessous ; celui de droite où Papa suspend ses costumes et ses trente cravates.
2020
L’HOSTIE
Souvent nous avons joué à l’hostie. L’hostie était une montre ultra plate dont nous avions ôté le bracelet. L’idée, c’était d’avaler le temps qui passe pour gagner l’éternité. Nous n’avalions pas l’hostie mais cela marchait quand même. Allonger la langue, déposer l’objet sur la langue, murmurer « Le corps du Cri » – Christ, nous l’avions raccourci pour éviter le blasphème, le Cri transmué en corps, cela nous plaisait (« Ton corps crie ? Il ressuscite. »)… Amen. On ajoutait : « Amène moi ça ». Nous devions conserver l’hostie le plus longtemps possible, entendre le tic-tac. Absorber le temps, sa substance sonore, fermer les yeux, se concentrer. J’ai failli gober l’hostie. Tic-tac. La glotte se lève. Rideau… Je m’en suis tiré en crachant. L’hostie a valdingué sur la moquette. La salive l’avait déréglé, elle indiquait n’importe quelle heure avant d’expirer. On s’est consolé en buvant un coup : « Le Sang du Cri ». Un cri sanglant ça avait du chien. Plus tard nous avons bu du Lacryma christi, enfin nous sommes passés au « Sang du peuple », excellent Châteauneuf-du-Pape.
2020
LA CAVALIÈRE
Le cheval pâle surgit – dressé sur ses pattes arrière, les antérieurs moulinent l’espace, gueule ouverte, crinière secouée… Sa frêle cavalière se nomme la Mort. Non squelette de danse macabre, mais jeune fille emportée, innocente dont le cou appelle les baisers, brune aux longs cheveux saboulés par le vent – accélération de la course, tempête annoncée. Ce film n’est pas celui que la réalisatrice rêve de tourner. Ici, personne n’a envie d’être comédien – et pourtant on joue, jusqu’à la fin. Le film est muet. On n’entend rien. Morts de faim, de guerre, de maladie, de dévoration sauvage, les acteurs improvisent. La ruelle, la sente, les maisons, les immeubles sont les décors d’un studio jadis splendide, aujourd’hui déglingué, minable. Passé le sommet de la colline se découvre l’envers du décor, forêt d’échafaudages rouillés qui tiennent – pour combien de temps ? – verticales les constructions. La réalisatrice demande à la cavalière de quitter son cheval, de s’adosser à l’échafaudage nord – celui qui tient droit les façades nord –, d’attendre que je la rejoigne. Elle filme l’éloignement puis la disparition du cheval pâle percuté par un soleil levant qui frappe un cerisier en fleur, un ruisseau argenté… « A vous de copuler », ordonne-t-elle. « Tu désirais cette fille ? Elle te veut aussi. Elle t’accueille debout, jambes écartées. Tu divagues en elle si violemment que l’échafaudage bascule. » Oui, les façades dégringolent. Poussière et fracas, rebonds de poutrelles, de stucs, de vitres. Clap de fin ? La réalisatrice en veut encore : que revienne le cheval ! Aussitôt, il est présent dans les ruines. A moitié déshabillés, enfourchez-moi ça – la cavalière à l’échine, moi en croupe – et fouette cocher ! Pas encore : on dégotte un tombereau dans les décombres du studio, on l’attelle, on y va. Nous traînons le séjour des morts. La charrette crapahute. Le cheval est aussi pâle que les moribonds qu’il transporte, et blême la cavalière la mort. Loin, très loin, la réalisatrice filme au ralenti, puis : arrêt sur image… Je relis l’Apocalypse : « …je vis paraître un cheval de couleur pâle ; et celui qui était monté dessus se nommait la Mort et l’Enfer le suivait. » La cavalière écoute – nous sommes dans sa chambre, il fait nuit, l’éclairage est minimum. Elle m’interroge du regard. Ce n’est pas pour ce soir. Sans cheval, La cavalière est anodine.
2020
LA DAME ET LE CAMÉLIA
En voyant la jeune prothésiste, je pense Dame au camélia – teint chlorotique, atmosphère de léger désespoir qui émane d’elle – : cette façon de se jeter en avant puis, aussitôt, de se reprendre, de s’étonner, sans le dire, qu’on s’intéresse à elle, puis de sourire en invitant à découvrir son univers, à deux pas du Panthéon, au dernier étage d’un immeuble bourgeois – une suite de chambres de bonnes, recomposée en cabinet. Où diable l’ai-je rencontrée ? Le Premier Ministre (ou Ministre des Finances, je ne sais plus) prête son appartement (justement aussi à deux pas du Panthéon) à son fils pour une soirée entre artistes. L’un d’eux me convie… La prothésiste est, pourquoi pas, une artiste, une voisine qui peut-être appareille tel invité, voire le propriétaire du somptueux logis, ou son rejeton. Elle semble timide, je le suis, cela nous rapproche… Fabricante de prothèses, elle crée ce qui manque, ce qui est perdu, détruit – installe dans un corps une mécanique qu’elle crée… D’où me vient cette excitation ?… Son hobby, c’est le dessin, la peinture horticole, la bouffonnerie du camélia, spécialité qu’elle décline d’abondance… Les rouages et le camélia – comment comprendre ?… Quand je la revois, je lui offre une fleur de camélia, belle et sans odeur… Notre timidité s’envole, la prothésiste est nue – cela me semble extravagant : la mécanicienne est une fille maigrelette, sa peau très blanche éclabousse le divan rouge, elle a jeté ses vêtements – ils parsèment la moquette noire – et me regarde, pose le camélia sur son nombril. La fleur, bientôt, recouvre sa touffe. Le rouge éclabousse la pâleur de sa peau. Elle écarte largement les cuisses, me prie de la joindre au camélia, « sans écraser une seule pétale, ni même la froisser », précise-t-elle. Exercice périlleux, quasi acrobatique, que je réussis pourtant. En elle, je crois saisir la nécessité du rouage : les pétales vibrent, le camélia frissonne. N’était l’inconfort de ma posture (arc-bouté, je sue et tremble), je parlerais merveille, rythme, harmonie, travail, chorégraphie subtile. « Très agréable, dit-elle. Retire-toi, repose-toi, tu es en plein émoi »… Maintes fois, nous pratiquons ce qu’elle nomme « le jeu du camélia ». Tantôt la fleur recouvre le nombril, tantôt un sein, un genou, le sexe, une cheville – ou simplement sa paume ouverte. A moi de « camélier » : pénétrer la prothésiste sans bousculer la fleur. Aujourd’hui, le camélia, posé sur sa bouche ouverte, épouse sa respiration – lente ascension, brève phase de plateau, aspiration soudain violente – la faute au coup de phallus, à sa butée. Le camélia encombre la gorge, elle manque d’étouffer, crache la fleur, chiffon rouge, résille de salive… Debout contre la porte ouverte, elle désigne le palier, l’escalier. Elle me flanque dehors.
2020
LA DÉROBADE
D’habitude, nous jouons à la dérobade, riant à peine d’un baisemain, d’un baiser imprévu. Celui-là glisse au coin des lèvres : une fin d’après-midi elles chaloupent, se joignent. Rien ne présage cela – ou sommes-nous aveugles aux présages ? Rien n’est calculé. C’est ainsi : un frôlement de hasards et nous franchissons la frontière – le gué plutôt : la rumeur de l’eau nous guide… Elle me connaît depuis si loin… Aujourd’hui, elle me regarde avec une douceur inconnue. J’aimerais savoir comment je la regarde… Avec surprise ?… Nos vêtements glissent dans la pénombre. La chambre est petite, très grand le lit. Elle se couche. La courbe de son bras cache son visage. Refuse-t-elle de me voir ainsi, sur elle – soudain différent ? Attend-elle que passe l’épisode ? Ou bien revit-elle un trauma d’adolescente dont elle m’a fait confidence ? Ou c’est une habitude, un simple geste de détente… D’être en elle, si vite, comme par étonnement, reste une sensation inconnue. La chambre, le lit, n’existent plus – ni la lumière tamisée qui les baigne. Elle est une autre, secrète. Mon sexe se love dans le sien, qui me semble large et profond. Je suis comme un poisson dans l’eau, un plongeur en apnée. L’ivresse des profondeurs où la conscience vacille est ici calme doux, immensité, hors temps. Je n’existe plus, j’existe dans sa présence, muette… Retiré d’elle, revenu à la raison – qu’avons-nous fait d’une confiance amicale – je balbutie une excuse. Elle répond : « Tu ne vas pas t’excuser, en plus ». C’est gentiment dit, avec une caresse, un sourire. Plus tard, elle s’éclipse d’un baiser.
2020
LA FILLE D’EN FACE
J’ai fermé les volets, tiré les rideaux, j’espérais devenir invisible pour la fille d’en face. J’espérais ne plus exister, échapper à son regard – l’espace d’une ruelle autorise un regard d’une rive à l’autre tandis que les voitures défilent, manquerait plus que ça me déconcentre, ce boucan est infernal. Persienne closes, double-rideaux d’épais velours. Elle ne me voit plus, je ne la vois plus. Pourtant je crains un soupçon de lumière qui révèlerait ma présence. J’éteins le lustre jaune. J’ai horreur de dîner dans le noir, j’ai faim, je tâte la cuisse de poulet, y mord à pleines dents. Je bâfre, le téléphone sonne – pas question de répondre : si c’était elle, j’en suis sûr, c’est elle, elle sait que je suis ici à me cacher comme les enfants se dissimulent sous la table, se croient insaisissables jusqu’à ce que des souliers heurtent leurs secrets. Je sais qu’elle me devine à travers le bois et les velours, elle va m’inviter à dîner alors que, doigts graisseux, je me goinfre solo. Je ronge la cuisse jusqu’à l’os. Si ça se trouve, elle m’a vu m’enclore. J’ai fait très vite – après avoir vérifié son absence, mais peut-être s’était-elle dissimulée. Cette fille m’espionne. Quand on se croise dans la ruelle, nous parlons comme vous et moi, polis, aimables, volontiers rieurs. Mais là, derrière l’opacité, c’est une guerre d’étouffement. Elle me perce à jour, va encore gloser : « oui il était tapi derrière ses volets, il me zyeutait, je l’ai vu de mes yeux vu comme je te vois, tassé derrière sa fenêtre, il me surveille, n’a que ça à glander, je lui dirai. Dès qu’on se croisera dehors je lui dirai qu’il est ridicule – il est déjà venu chez moi, nous sommes allés au théâtre, je l’avais invité – grotesque, lamentable ce type, c’est triste, non ? On n’a même pas couché ensemble, après le théâtre je n’aurai pas refusé – j’en avais très envie – mais il s’est esquivé, a remonté quatre à quatre derrière ses volets après que je lui ai allumé du feu dans mon salon. J’étais assise sur le tapis, je me suis allongée sans dire un mot, le bras tendu vers lui – et lui reculait, balbutiait qu’il était si tard… Au théâtre, ce coup de fusil sur la scène, j’avais sursauté, il m’avait pris la main, du genre je comprends ta peur, les coups de feu des fois ça rappelle des choses terribles, tu vois le genre. Et chez moi, rien. Incapable de me toucher le petit doigt… » Elle n’avait pas tort dans ce cas là pas tort, cette nuit là j’avais la mécanique improbable, du genre pas sûr que ça démarre au coin du feu, puis l’intestin qui fait des siennes, tout pouvait lâcher – ce sont de fausses excuses tant pis, des remugles enfantins, soit : j’étais avide de regagner mon logis, se calfeutrer n’est pas un crime : une simple précaution et pas question de répondre au téléphone pour l’entendre dire qu’elle peut me rejoindre : « Je parie qu’il a encore trop bu, ivre au point de refuser un simple réconfort, qu’est-ce qu’il croit, j’en ai vu d’autres, j’ai l’habitude »… L’habitude, manque plus qu’elle rajoute hélas : j’ai l’habitude, hélas. Je sais qui se cache derrière ces mots, aucune envie de prendre la suite, de cohabiter avec Hélas. Peut-être qu’il se cache aussi – pas comme moi : juste prendre la poudre d’escampette, changer de domicile… Comment pourrais-je changer de toit, comment quitter l’appartement aimablement prêté ? Logis aux grandes fenêtres avec vue imprenable sur elle : pas question de filer. Je veux être libre d’ouvrir ou fermer les volets, les rideaux mauves, de la regarder à la dérobée, quand elle s’esquive dieu sait où, qu’elle rentre à point d’heure. J’aime être au courant, j’aime la lorgner. Toucher avec les yeux, est-ce coupable ?
2020
LA TRICHE
« Tricher n’est pas jouer », combien de fois j’ai entendu cette rengaine. J’ai horreur de jouer aux cartes, surtout les soirs d’hiver, surtout avec les cousins, les cousines, tous sérieux à battre les cartes, les distribuer, les tirer, les abattre. On entend voler une mouche, parfois un soupir, parfois un crissement de soulier. Les seins de la cousine cadette sont pointés vers moi, sous le tee shirt pâle je vois les mamelons. Taché de nicotine, l’index du grand cousin glisse sur un valet de pique, le vasistas laisse filtrer une lueur glauque. Qui a oublié d’éteindre la lumière de la penderie ?… Le grand cousin et la cadette se farfouillent souvent dans la garde-robe. Voilà pourquoi je triche – non par jalousie mais par dégoût. Avant, et parfois après la partie de cartes, ils s’enferment et vas-y donc. Je sais de quoi je parle : j’ai entendu gémir derrière la porte, et des « Ah ! », des « Oh ouiii ! », des « Encore » à voix basse. Le pire, c’est « Non, pas là ! Là ! »… C’est là que je triche. Carré d’as. Ils l’ont pas volé.
2020
LE BAIN
Quand je pénètre dans la baignoire, elle y est déjà. Je ne suis pas sûr qu’elle m’attende mais j’y vais quand même. Souvent je lui disais : « tu es belle comme une armoire normande » sans qu’elle ose demander s’il s’agissait vraiment d’un compliment – et pourquoi normande et pourquoi pas à glace. Belle comme une armoire à glace, l’horizon s’y reflète. Faire l’amour avec une armoire à glace est autrement plus chic, plus vicieux qu’avec une armoire normande. Mais la Normandie avait débarqué, peut-être à cause de ses seins si généreux qu’on les aurait cru gonflés de lait. L’armoire n’était jamais fermée à clé, son vantail s’ouvrait vite, le chou (moi) se planquait bien à l’abri – un peu d’agitation puis le repos sur l’étagère du milieu… Bref, l’armoire est dans le bain moussant. Avec moi dedans, nous risquons le débordement, l’inondation, la beuglée des voisins du dessous, les tracas d’assurance. « Attend, mon chou, attend… » Cette manie du chou ! Cette ritournelle chuintante… Le chou sur le cul de l’armoire… Stop. J’ouvre la bonde, l’eau s’évacue d’enfer. Nous voici à prendre un bain sec, l’armoire, le chou. On s’agite, on se frotte, on se serre au maximum, on vidange à peine mouillé – juste quelques gouttelettes du chou vers l’armoire, de l’armoire au chou. Après, nous aurons envie de courir aux toilettes – sèches, bien sûr. C’est toujours comme ça, l’amour est à sec.
2020
LE PETIT BATEAU
Le petit bateau est à plat : le vent est tombé. Le voilier dérive dans l’immensité du bassin. Le bassin – rond – occupe exactement le centre du Grand Jardin. A genoux sur son rebord, j’assiste impuissant à la détresse du petit bateau – voiles affalées, il fait peine. Le bâtonnet qui sert à pousser l’esquif au démarrage ne sert à rien. La baguette du chef d’orchestre est impuissante… Parfois le petit bateau approche du jet d’eau, au milieu du bassin. L’eau retombe en grappe, bascule le youyou. Le mât, les voiles plongent, peinent à se redresser. Vénus, indifférente, fait mine de cacher son sexe de la main gauche, sa poitrine de la main droite : la statue se fiche du petit bateau, de mon attente. J’ai la boule. Le petit bateau va rester en carafe, la nuit viendra, nous obligeant, le bâtonnet et moi, à quitter le Grand Jardin. Vénus pourrait faire un effort. Un geste, un soupçon de geste et le vent s’élève, les voiles se gonflent, le petit bateau fend l’onde, vient buter contre le rebord, je le récupère… Putain de Vénus qui ne bronche pas, avec ses mains d’hypocrite, son visage à la Sainte Nitouche… Je m’approche d’elle, effleure ses pieds – à peine une caresse –, mes doigts remontent le mollet de marbre blanc. Impossible d’aller plus haut – je ne suis qu’un enfant face à la statue juchée sur son socle. Mes doigts fourmillent, ça c’est sûr. Le courant passe – miracle des miracles – et je vois l’eau du bassin frémir, onduler, les voiles du petit bateau enfler sous un bon vent, le voilier obéir à Vénus. Il s’approche du rebord, il est presque là, à portée de main. Je me penche, il s’éloigne. Je me penche davantage, il se rapproche, soudain s’esquive, je me penche encore : le petit bateau m’attire – Vénus m’attire et nous plongeons, le bâtonnet et moi.
2020
LE RÉVEIL
Figé sur l’infini le réveil ne réveille plus. La propriétaire du réveil est morte, son réveil s’est arrêté pile. Au dernier soupir, la petite et la grande aiguille ont stoppé leur course. Pile sur trois heures. Même après la mise en bière, la mise en terre, impossible de le faire repartir. Remonter (il s’agit d’un vieux coucou), remonter dans le vide. Point final. Et le poser sur la cheminée de la chambre mortuaire afin de ne jamais oublier l’heure de l’envol. A trois heures précises, l’âme de la future défunte a voltigé dans la pièce, s’est envolée. Toutes portes et fenêtres closes, sans un froissement d’aile, elle a disparu. L’âme de la disparue a disparu. Reste la poussière sur le réveil. A force, elle obscurcira le verre, la grande et la petite aiguille se tasseront dans la nuit. Quelqu’un, plus tard, jettera le réveil aux ordures sans se rendre compte qu’à cet instant, il se remettra en route. L’âme de la défunte a mis du temps, un temps bizarrement infini, avant de débarquer au paradis – en enfer ? Au purgatoire ? Nulle part ? Aucune importance. On a tout notre temps, tous notre temps.
2020
OMBRE
« Je vais te dire l’Histoire de l’ombre… ». Elle se cale dans le fauteuil Voltaire. « Ecoute, mon chéri, comment descendue aux Enfers à la recherche de mon défunt amant, je rencontrai un fort discret poisson – son étendard démentait sa modestie. C’était un ombre de bonne taille, un mâle qui ondulait dans les courants du Styx. L’ombre, peut-être, était l’ombre de mon cher disparu ? D’avoir tant aimé cet homme, j’étais prête à prendre une chimère pour la réalité, à troquer l’apparence pour une séance improbable. Pour garder patience, j’avais emmené ma broderie au point d’ombre et je décorais une petite culotte – j’avais envie d’être affriolante au cas où je croiserais l’ombre de mon défunt… Courir après cette ombre c’était me souvenir : de son vivant, nous étions comme l’ombre et le corps. Nous nous savions éphémères, inséparables séparables, fantômes en transit, ombres pourtant réelles comme ce beau poisson à l’œil cerclé d’or, à l’écaille bleutée, argentée, dont la dorsale marbrée de brun et de rougeâtre frappait l’onde – haute voilure au goût de thym qui parfumait nos ébats… » Elle continue longtemps ainsi – persévère serait plus juste – persévère dans l’évocation aquatique, décrivant l’eau rapide, très claire : l’ombre, fût-ce aux Enfers, ne vit qu’en eau limpide. Elle avait plongé, seulement vêtue de la culotte au point d’ombre, nagé avec l’agilité d’une sirène, traversé maintes ombres, contourné d’autres, vite, très vite. Enfin (elle était au bord de l’asphyxie), elle avait mis la main sur une silhouette sans épaisseur aucune (« une sorte de brume mélancolique », disait-elle joliment) qui tentait l’esquive. Elle l’avait hameçonnée d’un doigt, ramenée à la surface, « extraite des Enfers » dit-elle en riant, « une sorte de levée d’écrou ». Il était donc possible de piéger une ombre, maintenant allongée sur la rive, et qui, de saccades en soubresauts, se dirigeait vers son ventre, glissait sous la culotte au point d’ombre, calait sa tête contre le sexe qu’elle taquinait. Il n’y a pas de petits plaisirs, n’est-ce pas ? Tandis que la silhouette de son défunt arrondissait la bouche sur son point d’orgue, elle avait entrepris… « Tu ne connais pas l’ombre à paupières, je parie… » Non. J’imagine : l’ombre descend sur les paupières, les contraint à se fermer – crépuscule intime. Ou bien l’ombre de la mort ? « Bien plus simple, mon chéri… » Elle avait donc entrepris de se farder avec cette poudre colorée qu’on appelle ombre à paupières. Tandis que l’ombre lui taquinait le bourgeon, ses doigts papillonnaient : l’ombre en rose et rouge, pastel sur ses paupières…
NICE
Le choc me réveille d’un coup. Soubresaut. Un truc mou. Je regarde la conductrice : rien ne dérange sa conduite régulière. Elle est pressée d’arriver à Nice. Je demande si ça va.
– Oui, merci. Vous vous êtes endormi ?
Je ne lui ai pas dit : vous avez heurté quoi ? Un chien, un chat ? Quelqu’un ? J’ai répondu : oui j’ai dormi. Elle se tourne à moitié vers moi. Maintenant elle fixe à nouveau le bitume. La conductrice m’a pris en stop à Antibes. Je revenais de chez Diriks et j’allais à Nice.
Elle a ? Quarante ans ? Profil sévère. Quand elle sourit, quelque chose paraît vaciller dans son visage. Sinon elle est triste. Elle parle peu et cela me rend timide. La nuit tombe. Nuit froide de novembre. Nous longeons la mer, elle me demande si j’aime ça. Elle, déteste la mer.
– Vous vivez à Nice ?
Silence. Puis :
– Vous croyez vraiment qu’on peut vivre à Nice ?
Au large, les lumières d’un cargo clignotent. L’autoroute plonge entre des falaises ocre.
A Nice, je verrai bien s’il y a des traces sur le pare-chocs avant.
La conductrice a gardé son manteau, un loden gris avec un large col rond. Sur la banquette arrière, à côté d’une valise rouge, genre Samsonite, mon sac noir. Deux taches dans le rétroviseur.
– Vous vous intéressez à la peinture ?
– Pourquoi vous demandez ça ?
Sa voix est dure.
– Je viens de voir un peintre. Diriks. Vous connaissez ?
– Diriks ? Non.
Elle hausse les épaules.
– Vous savez, les peintres de la Côte…
Nous quittons l’autoroute. La voiture longe le viaduc du chemin de fer. Des immeubles fades où les réverbères creusent des trous jaunes.
– Où voulez-vous que je vous dépose ?
– Comme ça vous arrange.
La conductrice sourit à nouveau. Elle a un grain de beauté à la base du cou.
– Pardon pour les peintres. Les artistes, j’en ai soupé… Avenue Jean-Jaurès ça vous va ?
Il y a encore des feuilles aux platanes.
La pluie, soudain. Une bonne averse.
– Vous allez vous faire tremper.
Elle chuchote presque. La pluie crépite sur les vitres.
– Je vous rapproche ?
– De quoi ?
Un rire bref. Elle effleure mon bras. J’ai envie de la quitter, là, tout de suite. Je lui dis que je ne sais rien de Nice. Enfin, si peu. Souvenirs d’enfance. La voiture roule doucement, les essuie-glaces peinent à effacer la pluie. Des amis me prêtent leur appartement vide. Pour quelques jours.
– En somme, vous venez visiter Nice.
Elle ne connait pas la rue Michel-Ange et nous tournons dans la ville. Elle ajoute :
– C’est une bonne idée, Nice à la Toussaint.
Une blague à sa manière. Son front se plisse. Les rides mettent longtemps à s’effacer.
Près de la place Masséna, un épicier arabe regarde dégringoler la flotte. Son corps bouche le seuil de la boutique. Des oranges luisent dans des cageots. La conductrice baisse sa vitre, demande la rue Michel-Ange.
– L’ange ?
L’épicier désigne le ciel d’un geste vague. Il disparaît dans le magasin. La conductrice éclate de rire et moi aussi. L’épicier ressort. Il s’abrite sous un parapluie jaune.
– Michel-Ange. Rue Michel-Ange. Vous connaissez ?
Le parapluie est minuscule. La pluie dégouline sur la blouse de l’homme. Il nous dévisage. Puis il indique le chemin. La voiture remonte l’avenue Jean-Jaurès. La rue Michel-Ange s’ouvre sur la droite. Deux cabines téléphoniques blafardes marquent l’entrée.
– Quel numéro ?
– 25.
La rue étroite est bordée de villas à palmiers, de résidences aux volets clos. La devanture d’une boucherie annonce des spécialités pieds-noirs. 25, en face. Un immeuble en briques. Au dessus de la porte cochère en fer forgé, les lettres d’or d’une mosaïque : Palazzo Michelangelo.
– A Nice, il n’y a que des palais.
La conductrice range la voiture devant la boucherie. Elle coupe le contact. La pluie cogne sur les tôles. Je la remercie.
– Pas de problèmes.
Drôle de voix. Elle semble émue. Je suis gêné, soulagé de la quitter. Lui tendre la main. J’esquisse le geste. Elle tient son volant serré. Dehors, je contourne la voiture par l’avant. Rien sur le pare-chocs. La pluie efface les traces. J’ouvre la porte arrière pour récupérer mon sac. La conductrice se tourne vers moi :
– Adieu, donc.
La Fiat blanche démarre.
Je ne m’attendais pas à un bleu pareil.
Depuis trois jours le ciel de Nice est gris. Les autobus se perdent dans les embouteillages. La houle bouscule les flottilles de yachts à quai. La ville est opaque. Je suis au musée pour occuper l’après-midi. L’ombre bleue des Klein occupe la salle vide. Je frissonne. Les cimaises absorbent la lumière et réfléchissent la profondeur du bleu. J’ai les larmes aux yeux.
Je sens sa présence.
Elle se tient derrière moi, silencieuse.
Elle s’approche. Je perçois sa respiration.
– Toujours la peinture ?
Elle porte une veste autrichienne serrée. Je remarque pour la première fois ses yeux gris clair. Elle tient à la main un dossier et semble à l’aise. Elle travaille au musée ? Regardons Klein. J’aime être seul devant une œuvre. Là, rien de tel. Tremblement léger. La chevelure de la conductrice exhale une odeur lourde, agréable. L’air s’en imprègne. Je suis dans le bleu.
Ici ce sont les chambres de bonne, mais il n’y a plus personne. Pourquoi ces mots se baladent dans mon crâne ? J’explique ça à la conductrice. Elle répète la phrase de la voix chuchotante qu’elle avait dans la voiture. Rire.
– Si vous dites tout ce qui vous passe par la tête…
Plus loin, un Tinguely devant une paroi. La conductrice fait un signe au gardien, un jeune en blazer assis sur un tabouret. Le gardien court à l’angle de la salle. Il enclenche un interrupteur. Les rouages et les bielles se mettent en mouvement. Une agitation avachie. Le métal tressaille. Des couteaux frappent le vide. La conductrice préfère Louise Bourgeois. Moi idem. Avant de quitter la salle je remercie le gardien. Il se lève à moitié de son tabouret. Il sent la sueur. La machine s’arrête lentement, presque sans bruit.
– Vous avez vu le musée Matisse ?
– Oui. Et la Baie des Anges, le Negresco, le Ruhl et la Promenade des Anglais.
– Alors vous avez tout vu !
Son rire encore. Il va mal avec la veste autrichienne.
Je demande si elle travaille ici.
Geste évasif.
– Ça arrive.
Rez-de-chaussée. Je me dis : “toi, je ne quitte pas”. Je lui demande si elle a le temps de marcher en ville.
– Non. Je suis une femme pressée. Ça ne se voit pas ?
Elle répond avec un mélange de rudesse et de coquetterie.
– Pas vraiment.
– Donc, allons-y.
Elle ponctue ainsi ses phrases. Donc.
Elle parle du Congo. A cause d’un modèle de Matisse, la Dame en robe blanche. Elle connait Matisse sur le bout des ongles. Ses ongles à elle sont coupés ras. Phalanges rose vif. Plus tard elle dit : “je suis quelqu’un de coriace”. Cela semble s’appliquer à l’extrémité rose de ses doigts.
La chambre où nous dormons est acidulée, les double-rideaux parfaitement opaques. Impossible de voir naître le jour. Allumer la lampe de chevet. Le jaune de la chambre éclate. Puis entrouvrir les rideaux. La boucherie pied-noir, rutilante. Des merguez en guirlande pendent dans la vitrine. La seule boutique de la rue. Devant, les autos stationnent en double file. Du premier étage du Palazzo Michelangelo, on voit les clients s’agiter dans la boucherie. Les fenêtres de la chambre, garnies de vitrages épais, étouffent les bruits. Elle me rejoint, appuie ses deux mains croisées sur mon épaule.
– Boucherie Michel-Ange.
Elle m’embrasse la tempe. Ses lèvres sont très douces.
A gauche de la fenêtre, sur la console en toc, un sac en plastique blanc protège une statuette. Elle soulève le plastique : une Vénus de Milo.
– Tiens ! Une femme sans bras.
Drôle de façon de dire ça.
La veille, après le musée, nous avons marché jusqu’à la place de la Préfecture. Elle m’emmène au cimetière. “La plus jolie vue de Nice”. Mistral. Touffes de chrysanthèmes en goguette. La mer fait une grande courbe. C’est beau. Je pense à l’autoroute, au choc sur l’autoroute. Elle désigne les mausolées des Russes blancs, les monuments romantiques. Je ne pense qu’à l’autoroute. Parfois elle s’arrête, regard perdu. Elle va parler de ce qui m’obsède ? Elle est ailleurs. Un couple âgé nous frôle, dépose un bouquet sur une tombe. A Nice, les photos des morts sont scellées sur les tombes. Un aviateur. Trente ans. Les couleurs de la photo sont encore vives. Leur fils ? On s’éloigne. Elle passe son bras sous le mien, me dit son prénom. Je sens sa chaleur. Il va falloir l’appeler ainsi. J’essaye. Elle a un léger sursaut, comme si elle allait retirer son bras.
Elle veut encore me montrer le cimetière juif, mais il est fermé.
Nous redescendons en ville par le quartier des antiquaires.
Ensuite elle me raccompagne.
Je remarque tout de suite le chrome étincelant : le pare-chocs de la Fiat a été changé.
Je garde le silence mais je suis sûr qu’elle a compris.
C’est l’heure de la sortie des bureaux. Elle mordille ses lèvres en conduisant. Le vent chasse les passants. Place Masséna, un bus manque nous heurter. La Fiat pile net.
– Attention de ne pas abîmer votre pare-chocs.
Je ne peux pas m’empêcher de dire ça.
Elle ne répond rien.
Rue Michel-Ange je lui propose de dîner ensemble.
– Ce soir je ne peux pas.
– Demain ?
– Demain, oui.
Je pense ne jamais la revoir. Je dors très mal.
Dans le port, un deux mâts a rompu ses amarres. Un groupe d’hommes tente de le ramener à quai. Le vent est froid. Des badauds contemplent la scène. Nissa Bella, le bateau. Je longe le rivage. Les vagues se brisent contre les rochers. Sale temps sur la Côte d’Azur. Des cormorans entre les bourrasques. Au milieu des galets, un homme manie un cerf-volant. La toile rouge file vers le ciel à toute vitesse, elle pique vers les flots. Alors l’homme court bras tendu en dévidant la ficelle, et ça recommence. Le visage de la conductrice surgit, il perturbe ma promenade, cela m’agace. Ses yeux gris me fixent. Elle ferme les paupières. Parfois, le bleu Klein s’intercale. Je n’arrive pas à recoller les morceaux. Le choc. Mon réveil. Le sourire de la conductrice. Le pare-chocs flambant neuf. Elle pouvait s’éloigner de moi. Veut-elle savoir si je sais ? Elle ne viendra pas ce soir. Le froid vide les rues. J’entre dans un bistro. Une grosse femme, derrière le comptoir. Je commande un café et je m’assieds. Au fond, une jeune fille boit un pastis. De temps en temps, elle berce un landau. Un chien-loup se balade entre les tables. Il s’accroupit près du landau. Une rousse entre deux âges pousse la porte. Elle brandit des billets de loto, les pose sur le comptoir. Elle parle fort, avec un accent niçois prononcé. La femme du comptoir lui tend un billet de cent francs, on n’est pas à cent sous près. La rousse s’installe à côté de la jeune fille. Elles parlent d’une fête, doivent s’y rendre cette nuit. Le bébé. Qui va garder le bébé ? Je me sens en terre étrangère.
Je sors de la douche quand elle sonne. Un pantalon, une chemise et je vais ouvrir. La pénombre du palier adoucit ses traits. Elle paraît beaucoup plus jeune. Robe rouge à corolle, collants noirs. Dans l’entrée, elle tapote le clavier du piano désaccordé. Elle me tend une bouteille de vin. Pas un mot. On s’embrasse dans la salle à manger. Par la fenêtre, la lumière du réverbère hachure la pièce. La bretelle de sa robe glisse, je lui caresse l’épaule. Sa main sous ma chemise. Elle dit que j’ai la peau humide.
– On reste là ?
Je la serre fort contre moi. Elle embrasse de tout son corps. Je l’entraîne vers la chambre en lui tenant la taille. Dans l’embrasure, elle s’arrête : le miroir de l’entrée renvoie notre image. Elle murmure :
– C’est notre portrait à l’envers.
Une autre image revient de cette nuit avec la conductrice.
Elle se lève du lit. Pense que je dors. Se dirige vers la fenêtre qu’elle entrouvre. Le réverbère l’éclaire à contrejour. Très belle. Ses cheveux sombres dénoués, jusqu’aux hanches. Tout à l’heure, je lui ai dit :
– Vous êtes dodue.
Elle a fait mine de se fâcher. Peut-être l’était-elle vraiment.
Elle regarde quoi ? Soupire. Referme la fenêtre. Avant qu’elle tire les rideaux je vois qu’elle pleure. Pleure en silence. Sa poitrine est secouée de sanglots qu’elle maîtrise. Elle se lisse le visage. Noir dans la chambre. Elle se recouche. J’ai failli lui parler. J’ai fait semblant de dormir.
Au matin, elle paraît en pleine forme. Nous faisons l’amour. Elle a faim. La robe rouge s’étale sur une chaise.
– Maintenant, il faut que j’y aille.
Je veux la retenir. Elle sourit, secoue la tête.
– Il faut que je parte. Vous comprenez : je dois partir, sinon…
– Sinon quoi ?
Elle enfile sa robe.
– C’est bien aujourd’hui que vous quittez Nice ?
Je réponds oui. Reprendre le travail.
– Vous voyez bien : vous aussi…
Ce désir de ne pas la quitter. Ce désir de la voir disparaître. Toujours.
Dans la rue, des chiens aboient. A droite, vers la pente douce, ciel léger, présence de la mer. La robe rouge danse devant mes yeux. Cette histoire va prendre fin sans que j’y comprenne grand-chose. Souvent, dans ma vie, les êtres disparaissent, parfois ils meurent. Amours ? Un cheveu sur la soupe. La conductrice ouvre la portière de la Fiat. Elle s’assied, met le contact. Signe de la main, sourire. Adieu, donc.
Assises en bord de mer sur des pliants, deux femmes en ciré jaune contemplent l’horizon. L’écume lèche leurs bottes. Un type, mobile collé à l’oreille, arpente la grève en rigolant. Il téléphone à une fille accoudée au parapet, à une vingtaine de mètres. De temps en temps, il lui fait de grands gestes. A la fin, la fille vient le rejoindre et ils s’embrassent longuement. Des avions plongent au dessus de la baie. Certains descendent très bas : je peux lire le nom des compagnies. Le raffut des réacteurs se mêle à celui des vagues avant qu’ils virent puis disparaissent derrière le Cap Ferrat. Je ne me souvenais pas du tout que Nice était comme ça. Les néons du Negresco luisent en plein jour. La phrase valdingue : Ici ce sont les chambres de bonne, mais il n’y a plus personne. Qui la prononce? Elle cogne dans ma tête. L’odeur de la chevelure de la conductrice. Galets sous la pluie. Une ville d’accessoires. La conductrice appuie à fond sur l’accélérateur. Nous avons baisé, bien baisé, à cause de l’autoroute, du choc sur l’autoroute. Je ne sais pas. J’ai été attiré par ça. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être aussi à cause de la peinture. Du bleu. Des couteaux de Tinguely.
(2005)