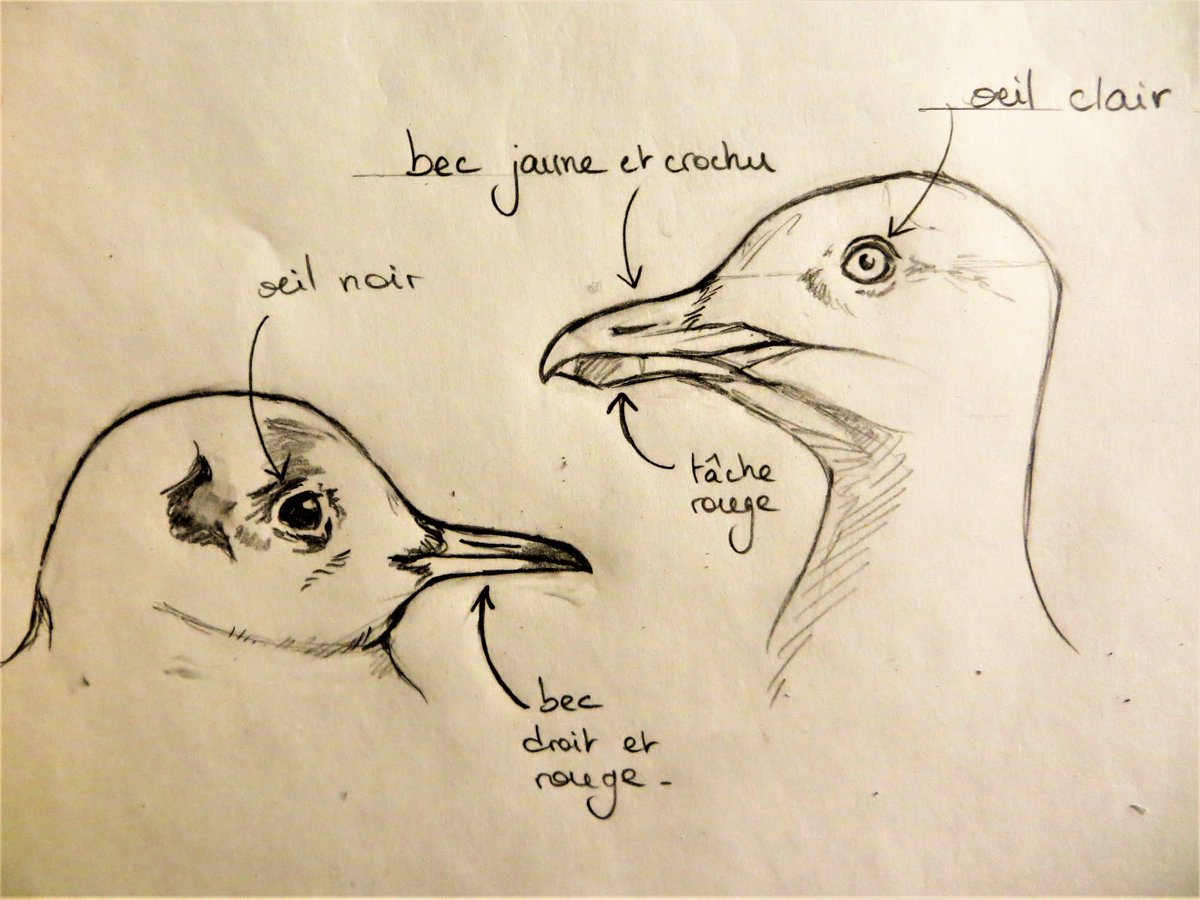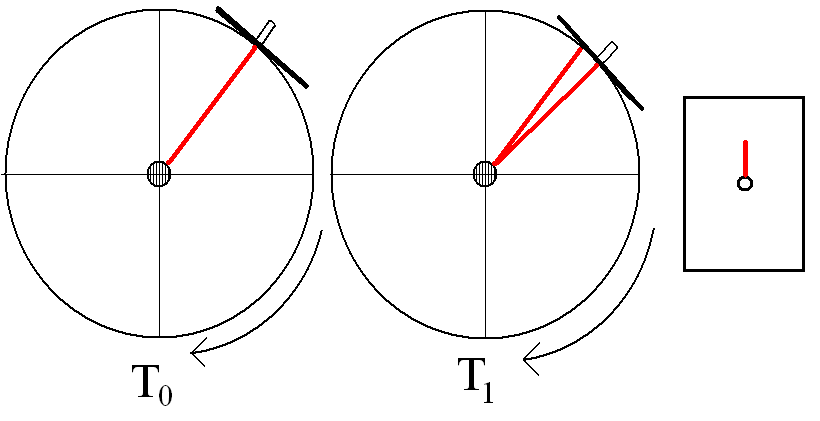HIVERNALE
Vous deviez me porter dans vos bras, franchir, le seuil ainsi, et nous aurions ensuite grimpé les marches éclairées par la pleine lune. Les murs de l’escalier devaient être tapissés de genêts, la pierre disparaître sous leur verdure – et nous aurions grimpé dans la forêt.
Du bois devait flamber dans la cheminée, illuminant la vaste pièce, en éclairant les poutres, jetant des ombres fantastiques sur les murailles. Malgré l’hiver, la chambre aurait été tiède, les fauteuils rouges accueillants, et la peau d’ours douce aux pieds.
Vous deviez éteindre la lampe de chevet, laissant la chambre aux seuls crépitements du feu, et m’inviter à m’asseoir paisiblement sur la méridienne, et vous asseoir sur une chaise, un sourire aux lèvres. Vous auriez proposé une boisson, du champagne peut-être, ou une orangeade, et nous serions restés de longues minutes en silence à contempler les flammes.
Vous deviez attendre que je m’étire et, seulement après que je me sois levée, vous tenir debout en fredonnant, et vous approcher, les bras tendus pour que je m’y pelotonne. Vous auriez vacillé comme si la chaleur de mon corps vous donnait le vertige, et j’aurais offert mes lèvres pour que vous repreniez des forces. Longuement, ensuite, vous deviez me contempler, vous interrompant seulement pour déposer des baisers dans mon cou et, quand mon regard aurait été éloquent, poser la main sur mon front, une seconde, vous étonnant de le trouver brûlant.
Cette fièvre, empreinte d’une brève mélancolie, était un signe : vous deviez commencer à dégrafer ma robe. Vos doigts m’auraient frôlé le dos, avant, par petites touches, de s’attaquer aux boutons. J’aurais senti les gouttes d’eau de vos doigts, glissant, plus doux à mesure que glissait la robe.
Vous deviez me laisser ôter mes bas, interrompant seulement mes gestes de quelques agaceries sur la peau, comme si vous m’encouragiez à poursuivre toujours au-delà, alors même qu’il n’y avait plus rien à ôter, et, prestement, faire en sorte d’être nu, et m’écouter rire, sans vous offusquer, de votre raideur, et ployer brusquement.
Vous deviez vous taire, frissonner autant que moi, plus si vous le pouviez, de notre ardeur, et, m’ayant rejointe sur le lit, me regarder comme si vous ne m’aviez jamais vue, comme si j’étais un animal sauvage qu’il faut charmer – sinon il s’échappe à jamais.
Vous deviez m’abandonner, vite, et j’aurais senti que je ne supporterais pas votre abandon : alors, vous deviez vous laisser capturer, m’enlaçant comme si j’étais la première.
Puisque je n’étais pas la première, vous deviez savoir y faire. Pas trop lentement, avant que le feu ne décline, vous m’auriez amusée, avant de vous emporter, et vous m’auriez comblée, pour que le temps cesse de s’effriter. Vous auriez été agile. Vous m’auriez regardée fermer les yeux. A votre tour vous aussi. Peut-être nous serions-nous oubliés ?
Vous deviez m’étonner avant que le sommeil ne me cueille contre votre poitrine, et veiller sur mes songes. Et, au matin, faire remarquer la brièveté de la nuit, vous enquérir si j’avais froid, sans insistance d’aucune sorte. Vous auriez ouvert la fenêtre et le soleil aurait couru sur les draps. Alors, vous m’auriez complimentée sur ma beauté, lissant mes cheveux de vos doigts que j’aurais arrêtés d’un baiser.
Vous deviez prononcer mon nom comme une caresse, et deviner que j’avais faim de croissants tièdes et de thé, et d’un soupçon de confiture, airelles ou framboises, avant de m’accouder à vos côtés pour déguster le paysage d’hiver. Vous auriez désigné les châtaigniers accrochés dans la brume, leurs troncs luisants et l’envol d’un merle noir. Au-delà, auriez- vous murmuré, il pourrait y avoir l’océan. Cette main que vous auriez tendue vers l’océan, je l’aurais pressée contre mes seins, et vous auriez senti qu’à travers votre rêve je vous aimais vraiment.
DOMMAGES
Ils étaient immobiles, tels deux enfants fautifs, les vêtements salis. Lui, le jeune homme, avait même une jambe de pantalons à moitié arrachée ; on voyait donc la peau, très blanche, avec des traînées brunâtres engluant le tissu. La jeune fille tournait le dos à la porte cochère. Elle était ébouriffée et la corolle bleue pâle de sa jupe, gonflée par le courant d’air du matin, augmentait encore cette impression ; elle était un cerf-volant déchiré. En face, dans le corridor, le vieux s’appuyait au dossier d’une chaise – il avait envie, tout le temps qu’il parlait, de s’asseoir. La vieille sautillait comme un moineau fatigué, presque sur place, triturant le cordon de sa robe de chambre. Parfois, elle tapotait le bras du vieux, tirant la manche du pyjama rayé, et lui se dégageait. Les jeunes gens les écoutaient, sans impatience apparente.
– Ne comptez pas sur moi pour vous donner un coup de main, dit le vieux.
– Je vous avais prévenus, dit la vieille ; il s’occupe de lui.
– Quand vous êtes partis, dit le vieux, je me doutais de quelque chose, figures des mauvais jours. Mais vous êtes partis quand même ; maintenant, il n’y a plus de place ici.
– Il s’étale, dit la vieille.
– Encore seriez-vous partis en catimini, nous pourrions fermer les yeux, dit le vieux.
– Aujourd’hui, il déteste le passé, dit la vieille.
– Vous me rudoyez, dit le vieux. Quand vous avez filé, j’ai eu du soulagement. Maintenant, à la minute, rien. Il fallait suivre votre route… Vous deviez rouler à tombeau ouvert.
– Il ne supporte pas la vitesse, dit la vieille.
– Les accidents se produisent toujours au Col. C’est arrivé au Col ? Oui. Il y a un panneau, le virage, trois sorbiers, un virage. Fatalement, on regarde le panorama. S’ils retiraient le panneau, on regarderait quand même le paysage en accélérant. Le panneau peut éviter d’appuyer sur le champignon, mais on n’évite pas le paysage, la vallée dans la brume, le soleil, l’aube. Naturellement, vous avez pris de la vitesse… Il ne fallait pas partir. Ou alors faire règle d’une grande prudence : ça aurait empêché ce superflu, votre retour, dit le vieux.
– Il a horreur du gaspillage, dit la vieille.
– Je ne vous en veux pas. J’ai eu des accidents. J’ai cassé de la mécanique, par inadvertance, par prémonition. C’est votre voiture. Mais revenir sur mes pas, jamais. Et la pudeur ? La crainte de décevoir ? Le silence de l’accueil ? dit le vieux.
– Il a fini le whisky et le punch, dit la vieille.
– En réfléchissant, vous n’auriez pas fait demi-tour, dit le vieux. Même en cas de brouillard, même avec les ruissellements. La vérité, c’est que vous ne pensez pas à moi, tandis que je ne fais que penser à vous, sur le départ, sur le retour.
– Il ne se laisse jamais aller, dit la vieille.
– Le mieux, dit le vieux, le plus avantageux, serait que vous ne soyiez jamais sortis de la maison, ou que, c’est cruel, vous ayiez laissé votre peau au Col. On aurait ramené la voiture. Nous aurions admis – pour les frais on se débrouille.
– Il n’est pas avare, dit la vieille.
– Quand une situation est franche comme une blessure, j’accepte les cicatrices, dit le vieux. Les déraillements, jamais. Et le froid, le froid que vous avez senti en vous extirpant des tôles, maintenant le voici dans cette maison triste et calme. Mon dieu, taisez-vous, c’est la fatalité. Mais vous auriez dû vous atteler, poursuivre à pied – c’est excellent à votre âge -, continuer à descendre loin de moi, comme il sied à la jeunesse.
– Il regrette vraiment, dit la vieille.
– Qu’allez-vous faire de moi si je ne vous chasse pas ?
– Il est anxieux ! dit la vieille. Anxieux !
– Je ne peux vous foutre à la porte puisque vous êtes revenus, dit le vieux. Si vous n’étiez pas chez vous… Vous ne devriez pas hésiter ; partir, à nouveau, tenter l’aventure, serait bon.
– Il donne un conseil, dit la vieille.
– Un prétexte serait la nuit, le silence des étoiles. S’échapper, fuir, une mesure de prudence – et non le désordre que je pressens si vous êtes là, encore. Ce sont des choses vérifiables, l’expérience. Du reste, il n’y a plus rien à manger ici, dit le vieux.
– Il ment, dit la vieille.
– Le pire, dit le vieux, la tristesse, c’est de ne pouvoir aider ceux qu’on aime, alors qu’il est facile pour eux de s’effacer. En vérité, si je vous en suppliais – mais ce n’est pas de mon âge – peut-être accepteriez-vous. Vous autres devriez prier afin que je vous demande de partir, à nouveau de partir, toujours pour toujours, et me permettre ainsi, à mon gré, à mon rythme, de partir, moi aussi, ce qui est impossible, puisque vous, vous, incrustez.
– Il est opiniâtre, dit la vieille.
– Je promets, dit le vieux, quand vous aurez quitté les lieux, si vous les quittez une seule fois, encore une fois, de vous précéder. Partout où vous irez, jusqu’au Col, je serai là, me retournant, face à vous, jusqu’au Col. Après, vous courrez votre chance, seuls, sans moi, à pied, ou par tout moyen qui vous semblera profitable. Vous avancerez dans les paysages gris et rouges et, sans même vous en rendre compte, vous m’oublierez. Moi, je ne vous oublierai pas, tant que je vous apercevrai au moins – et plus : au-delà, lorsque vous aurez franchi le Col, je m’assurerai que vous ne revenez pas en arrière pour d’obscures raisons, que vous avez, en définitive, adopté des contrées nouvelles, inconnues de moi, des lieux d’exil. Oui, jusqu’au Col, pas au-delà, je vous précéderai par la pensée, puis, au-delà, vous me laisserez en paix.
– Il est fatigué, dit la vieille.
– Je vous regretterai, tant que je me souviendrai, dit le vieux… Après, sans garantie. Dès que vous aurez achevé de passer le seuil, je claquerai la porte.
– Il le fera, dit la vieille.
DÉLATION
L’hésitation rendait son regard provocant. Elle demanda ce que je faisais ce soir, ajoutant qu’elle ne voulait pas s’imposer – ce qui me contraignit d’accepter sa proposition plus vite que prévu. Sans un mot, elle se faufilait au milieu des badauds. La première, elle grimpa les escaliers. Elle réclama quelque chose à grignoter : après tout, n’était-ce pas une façon de la payer ? Elle s’était levée, secouant sa robe sur la moquette, disant qu’il faudrait des pigeons pour les miettes de pain. La première, elle gagna la chambre, voilant d’un foulard la lampe de chevet. Elle se déshabillait avec grâce, se découvrant sous l’angle qui lui convenait le mieux. La souplesse de ses mouvements en effaçait la rapidité, l’émotion gommait les failles de sa beauté. Le charme fugace pris à la contempler donnait du flou au désir, en accentuant l’effet, jusqu’à la rendre, elle, presque transparente – sensation confirmée par l’envol subit de son corps vers le mien. Elle restait immobile, seules bougeaient ses lèvres rivées aux miennes. Elle aimait, disait-elle, les arbres qui vacillent avant de s’effondrer, secouant la futaie, en arrachant les feuilles. Elle était véloce maintenant : il n’y avait rien d’autre à faire, sinon basculer contre son flanc – et se reprendre, suivant ses conseils, tandis que sa bouche tiède éprouvait ma sincérité. Que ressentait-elle ? Elle dormait, n’était-ce pas un résultat ? Ou feignait-elle, pour sa tranquillité ? Ou voulait-elle que je la réveille ? Balbutiante, elle avait esquissé un enlacement. Sa tête pesait sur ma poitrine ; figée dans la sienne, ma main traînait un début de crampe. Comment, sans la déranger ?… Je ne dormais pas, surpris par son odeur, son souffle, les battements de son cœur, les gargouillis de son ventre. Captif des tressaillements de la dormeuse, j’avais envie d’être seul en même temps que jaillissait en moi une petite source d’eau froide, sorte d’étonnement, d’attirance fragile : toi, dis-je en dégageant ma main, je ne suis pas près de t’oublier.
CHEMINEMENT
Le chemin de droite ne présente aucun intérêt, hormis une pente régulière mais raide et sa proximité de la maison. Voisinage qui permettait à mon père d’aller, chaque midi, s’y délasser les jambes. Il y avait aussi ces promeneurs, toujours à se renseigner en passant sous mes fenêtres. Bien que je fusse incapable de les renseigner, ils empruntaient quand même le chemin – parfois, ils n’attendaient même pas que je leur réponde. Ils rejoignaient mon père, lui posant sans doute les mêmes questions, vainement : mon père ignorait où menait le chemin, n’en pratiquant qu’une infime portion, aller et retour, comme s’il butait contre un cul de sac. En fait, il ne s’écartait pas de l’ombre que la maison projetait sur le chemin, se demandant aussi où menait le chemin, s’attardant à l’orée, là où il monte d’un coup, à travers les châtaigniers, à l’assaut du ciel. Il restait alors, les mains en visière, regardant les promeneurs approcher, puis, après qu’ils aient demandé leur route, les suivant des yeux. De mon côté, je restais accoudé à la fenêtre, soulagé de voir les promeneurs surgir de la colline (notre maison est bâtie à flanc de coteau), lever la tête vers moi qui les saluais poliment, comme si j’étais là par hasard, et eux aussi. Mais j’attendais avec impatience leurs questions. C’était peut-être ma façon d’être utile dans la vie, de profiter fugitivement de mes semblables, sans cesse renouvelés. Renouvellement qui, par ailleurs, attestait que le chemin devait aboutir quelque part – mais fort loin : sinon j’aurais revu de temps en temps les mêmes têtes, désireuses de reprendre la balade, de faire connaître le chemin à des amis, à la famille. Evidemment, j’aurais pu tenter moi-même d’explorer le chemin. Mais, outre que je n’avais pas de véritable curiosité, préférant attendre les passants, je devais surveiller mon père : je craignais toujours qu’il passe au-delà de cette ligne d’ombre dessinée par l’arête nord de la toiture, et, qu’alors, il ne revienne jamais, puisque personne ne prenait le chemin en sens inverse. Pourquoi en aurait-il été autrement pour lui ? Cela m’aurait contraint, à mon tour, de quitter ma fenêtre, à ne plus essayer de renseigner les promeneurs et, surtout, à partir sans espoir de retour. Sans nous l’être jamais dit, mon père et moi étions – du moins je l’imaginais – apparemment d’accord sur ce point : nous étions incapables d’emprunter le chemin. Nous n’étions pas malheureux de cela. Cette incapacité nous confortait mutuellement. Bonheur est un grand mot, mais il s’agissait bien d’un état de bonheur, bonheur hésitant, mais bonheur. Il va sans dire que nous ne vivions pas en vieux garçons. Une femme égayait la maison. Elle semblait ne tenir aucun compte de nos habitudes, pas plus que du chemin et de ses promeneurs. Le soir, dès que mon père était rentré, elle fermait la fenêtre et préparait le repas. Un dîner frugal suffisait à nos activités sédentaires. Cette femme était rétribuée, honnêtement, pour s’occuper de notre intérieur. Elle s’acquittait si efficacement et depuis si longtemps de cette tâche que j’avais oublié jusqu’à son nom et son visage. Je crois qu’il en allait de même pour mon père, quoique de cela non plus nous ne parlions jamais. Notre seul sujet de conversation concernait les promeneurs et leurs sempiternelles demandes de renseignements. La femme nous servait bien. Il n’y avait rien à redire, rien à réclamer. Sa présence subtile mettait de l’huile dans les rouages, et nous lui en savions gré, chaque Noël, par un mois d’étrennes. Il lui arrivait parfois de chantonner, mais, comme elle était d’origine étrangère, je n’ai jamais saisi les paroles. Ses fredonnements plutôt alertes cessaient sitôt qu’elle nous apercevait. J’évoque longuement cette femme à la fois pratique et immatérielle car elle devint pour de bon invisible. Elle disparut, laissant la fenêtre ouverte, comme si elle s’était échappée en s’accrochant au lierre. Pour la première fois depuis que nous l’avions engagée, nous l’appelâmes. Son nom résonna en vain dans chacune des pièces. En dépit de la nuit tombante, mon père alla se poster sur le chemin : il craignait qu’elle fut partie par là. Moi-même, je partageais ses craintes et, de la fenêtre, je guettais dans l’obscurité. Nous fîmes chou blanc. La femme ne reparut jamais. Nous nous étions trop habitués à elle pour la remplacer. Le problème ne concernait pas les pratiques ménagères – on s’arrange vite, après quelques tâtonnements – mais l’anxiété nouvelle qui nous prenait lorsque nous renseignions les promeneurs. J’ai longuement hésité avant d’oser, à mon tour, leur poser des questions. Avaient-ils rencontré une femme… Au début, j’avais des difficultés à la décrire, puis, à mesure que les mois passèrent, je parvenais, en un temps record, à donner un luxe de détails dont je me demande à présent s’ils correspondaient vraiment à cette femme. Quant à mon père, il ne questionnait pas les promeneurs, mais je l’entendis un jour leur demander, au cas où ils verraient la femme (les passants savaient de quoi il retournait, puisque je les avais auparavant interrogés depuis ma fenêtre) de bien vouloir l’aviser de notre inquiétude. Il précisait même la formule à transmettre : « mon fils et moi-même aimerions avoir de vos nouvelles ». C’était une formule neutre, courtoise, qui n’engageait pas l’avenir et ne devait en rien choquer cette femme, lui donner l’impression que nous exercions une pression sur elle. Mon père semblait avoir gardé l’espoir de son retour puisqu’il ajoutait, en quittant les promeneurs : « Si vous la croisez, dites-lui cela », comme si la femme pouvait avoir rebroussé chemin, revenir vers nous, porteuse d’informations sur l’au-delà du chemin, ce qui ferait d’une pierre deux coups : en rentrant au bercail, peut-être décrirait-elle ce qu’elle avait vu et, même si elle ne parlait pas (vu son caractère c’était vraisemblable ; au reste l’aurions-nous vraiment interrogée ?) nous aurions enfin sous la main quelqu’un qui aurait pris le chemin dans l’autre sens, témoin et preuve qu’on pouvait en revenir. Naturellement, nous aurions pu saisir le prétexte de cette disparition pour explorer le chemin, mais c’eût été transiger avec notre mode de vie, rompre, peut-être définitivement, avec nos habitudes, abandonner le foyer. Je me rends compte aujourd’hui de notre erreur : le départ de la femme avait déjà modifié nos comportements. Notre sérénité avait disparu avec elle. C’était comme si, par la fenêtre restée ouverte, la nuit, le brouillard avaient envahi la maison. Comme si la part inconnue du chemin envahissait peu à peu la maison, infiltrant chaque parcelle de notre vie. Fatalement, notre comportement en pâtit. Peu à peu, nous perdîmes notre spontanéité et notre patience. Les questions des promeneurs m’agaçaient et, de la fenêtre, je voyais que les gestes de mon père devenaient de plus en plus évasifs. Pourtant nous ne cessâmes jamais totalement de leur répondre. Nous faisions de notre mieux. Ce sont les promeneurs qui tarirent. Inexplicablement, ils s’espacèrent. Nous restions parfois des heures, puis des jours, sans en voir un. Le dernier fut un homme brun qui passa sous ma fenêtre puis devant mon père sans nous adresser la parole, comme si nous étions invisibles. Il bifurqua sur le chemin et disparut parmi les châtaigniers en fleurs – nous étions en juin. Mon père le suivit des yeux tant qu’il put. Il esquissa même, à mon grand effroi, quelques pas derrière lui avant de se retourner vers moi, le visage empreint d’une grimace douloureuse. Après l’homme brun, il n’y eut personne. Et, lentement, nous dûmes nous rendre à l’évidence. Pour éviter de nous saper le moral nous n’avons jamais tiré de conclusion, évitant même d’évoquer cette réalité. Depuis, par hygiène, et parce que l’espoir devient une habitude à partir d’un certain âge, nous poursuivons notre guet. Je m’accoude à la fenêtre et mon père prend sa place habituelle : une zone de quelques mètres carrés sous les châtaigniers. C’est du reste le seul espace viable : l’absence des promeneurs a effacé le chemin. Il n’y a plus de chemin. Seulement des ronces, des genêts, de la broussaille, et le ciel au dessus.
Elle s’était assise au bord de la banquette, le buste si en avant – à se demander si elle allait tomber, ou si elle regardait avec une extrême attention quelque chose de la moquette, ou une tache sur ses sandales, ou une ombre louche. Mais c’était seulement sa façon de se tenir ainsi, penchée sur le monde, elle-même penchée sur elle-même. Ses doigts, brefs et fins, posés bien à plat sur les cuisses, étaient sertis de trois bagues – à l’annulaire de la main gauche, une alliance en or blanc, à celui de la droite, une goutte de rubis. Une montre miniature, enchâssée de diamants, serrait le majeur de cette main droite, si tendue sur la très courte jupe noire qu’elle paraissait infiniment longue. Sûrement, sans cela – tension si forte de la main que l’extrémité des phalanges blanchissait – la femme n’aurait pu se tenir ainsi penchée : elle était retenue au bord d’un gouffre, en fragile équilibre. Sans la main droite, pensai-je, ma voisine de compartiment, une femme de trente ans à la peau mate, s’effondrerait, glisserait sur le sol du train, un Bruxelles-Paris au trois-quarts vide. Mais il y avait cette main brune crochetée au coton noir de la jupe, et les jambes effilées. Née de la crispation des doigts, la tension qu’exacerbait la volve des bagues (la goutte, l’horloge minuscule), filait sur la peau des jambes, nettes, raidies, avant de disparaître sous le siège où la femme avait glissé les pieds. Un scintillement sourd émanait de sa peau. Je lui demandai si elle venait de Bruxelles et, tandis que nous parlions à bâtons rompus, vint l’obsession de la toucher, de caresser, de lisser, frôlement par frôlement d’approcher la source de son mystère électrique (je nommai ainsi, comiquement, la myriade sensuelle qui m’enveloppait), de saisir au vol les mains baguées, prendre le risque d’approcher son visage, ma paume creusée en aile, ou fendre ses cuisses. Mais je n’osai que revisiter Bruxelles en sa compagnie : nous étions d’accord sur la beauté froide de la ville, nous avions longé les mêmes avenues où les encorbellements donnaient aux façades un air très anglais – « victorien », dit-elle avec un sourire définitif ; et sa main droite s’éleva jusqu’à sa bouche : l’arc des lèvres s’entrouvrit une seconde. Des griffes de lumière, jaillies des bagues, se tinrent en suspension et s’affalèrent doucement sur les cuisses brunes. Il y eut un silence puis je lui dis admirer ses bagues, celle au rubis surtout. Elle étendit les doigts. Les aiguilles de la montre couraient sur la jupe, aiguilles d’or brodant une roue dentelée sur le tissu noir. Et la bague au rubis glissa, goutte de sang qu’elle retint entre ses cuisses, où je l’y cueillis, frissonnant de cette peau tiède – écorce de bouleau au soleil. La bague coula dans ma paume. Une conque avec une goutte de sang, voilà ce qu’était devenue ma main. La femme se taisait. Son mutisme ne prouvait rien, ni sa totale immobilité. Ses cuisses formaient un bloc où s’ouvrait ma paume renversée. Au milieu, son sang. « Elle vous irait, je crois », dit-elle. J’eus à peine un sursaut : la goutte de sang se glissait à mon annulaire – et la lumière versée par la vitesse l’éclaboussa. Sur sa main à elle, les aiguilles virevoltaient : des fourmis qui s’emparaient de mes doigts, remontaient vers la nuque, la cernant, la picorant, s’installant derrière les oreilles et, de là, redescendant toujours plus bas, jusqu’à déposer en moi une tache sombre, humide, irradiante – île d’où roulait la goutte de sang, à flancs de coteau, terre brune et coite, aérienne et pleine, ouverte par les scansions de la montre-bague, roulis, ruisselis d’ombrages. La goutte de sang s’arrêta à mon visage et j’y portais les lèvres, soucieuse d’en discerner l’odeur, celle de la peau de la femme – mais il n’y avait qu’une odeur de pierre, rehaussée d’une trace de parfum, Après l’ondée de Guerlain. Et le train s’arrêta, un long freinage qui fit davantage pencher la femme, une secousse et la rase campagne, le temps qu’un convoi de marchandises nous croise, jetant par les vitres des plis ocres et blancs sur la jupe noire. Le rubis brillait à mon doigt. « Il est à vous, dit la femme, faute de mieux ».
AU-DELÀ DES RIVAGES DU NIL
Il n’y avait rien. La grisaille d’une rue décrivait un arc de cercle. Un type, bras levé, montrait le ciel – alternance de pluie fine, de soleil. J’avais dû aborder trop tôt ou trop tard. Pour atteindre ce lieu des métamorphoses, j’avais marché sans fatigue, longé des échoppes croulant sous les draperies. Cris et marchandages. Pavés glissants. Les yeux fermés, on entendait la mer. J’ouvris les yeux. Une façade blanche clouait la rue. La façade était lisse sous les doigts mais distillait l’humidité. A force de caresser la pierre – en décrivant de lents cercles de la paume – j’arrachai des poussières. Elles collaient à la peau. Leur goût, sur la langue, était suave et salé. Si j’avais été marin, j’aurais su à quoi m’en tenir. Déjà, mon cœur battait trop vite. Sans en avoir l’air, à cause du passage incessant dans la rue, j’enfonçai le poing. Le mur céda. La brèche libérait un souffle glacé, une odeur de frites. Cela m’encouragea à poursuivre l’exploration. Au-delà, une femme lavait des escaliers à grande eau. L’humidité venait peut-être de ça. Elle ne me prêta aucune attention. II fallait beaucoup d’eau pour lessiver les marches, crasseuses. Le courrier s’échappait des boites à lettres défoncées. La cage d’escalier baignait dans la clarté grise de la rue. Pas de quoi être déboussolé. En songeant au type qui, tout à l’heure, désignait les nuages, j’escaladai les marches. Sans le frottement de la serpillère, tout aurait été silencieux. Personne ne semblait habiter les altitudes. Au premier palier, une fenêtre, dépourvue de carreaux, dominait la rue. Une rue vraiment décevante, à peine exotique. A gauche de la fenêtre, un cendrier d’inox, monté sur pied, jouxtait une porte. La personne qui avait placé le cendrier devait aimer la prudence – le choix du métal prouvait sa méfiance de l’humidité – et n’être pas fumeuse : elle invitait les visiteurs à écraser leurs mégots. Ce cendrier d’agence touristique faisait office de balise : un rais de lumière accrochait le métal. J’en tâtai l’arrondi, embué, humide. La lumière ricochait sur la porte d’à côté. J’y risquai les doigts. Les flots amplifient certains frôlements : le battant s’ouvrit.
La femme habitait là. Attendait-elle quelqu’un dont le visage, inconnu, pouvait correspondre au mien ? Elle ne semblait pas surprise. Elle zigzaguait, avec une rapide souplesse, entre des meubles échoués. A l’époque des crues, presque tout devait s’engloutir. Du limon restait sur le lit, la table et deux bancs. Seuls émergeaient, nets, un piano droit dont la caisse d’harmonie, large, noire, heurtait un mur et, à la diagonale du piano, proche de la porte – au point de risquer d’être emportés sur le palier – l’écran, la console d’un ordinateur. La femme lavait des escaliers à grande eau. L’humidité venait peut-être de ça. Elle ne me prêta aucune attention. La femme était d’une beauté à la fois nerveuse et attentive. Elle resta debout et me fit asseoir. Je m’assis donc avec la sensation de rester debout. Elle m’offrit à boire – mais je refusai de la déranger – et demanda ce que je voulais traduire.
J’avais accosté comme on dessine un lavis. On dispose sur la rive de vastes étendues de papier que viennent imprégner les flots poussés par le vent. Un creux de roche sert à diluer les bâtons d’encre de Chine. On avance la main et le reste suit. Façon comme une autre d’abolir les limites, d’aller, en somme, au-delà des rivages du Nil, d’aller en excursion, en décrivant parmi les ajoncs ployés des cercles d’encre de plus en plus larges… Sentait-elle ce que je voulais dire ? La traductrice s’excusa du désordre. Une poêle à frire, des miettes éparses. Elle traduisait beaucoup, se reposait peu. A quoi bon ranger. Les voyageurs passaient, avides de suivre leur route. Il fallait les nourrir, dans la langue qu’ils souhaitaient. Elle-même, quoique pressée, accordait toujours le temps nécessaire à la traduction. Son regard picorait : l’habitude de jauger les transfuges au premier ou au second coup d’œil. Quand venait la crue, quand elle restait seule, je l’imaginais, immobile, comme ces flamants roses dans le soleil couchant. L’eau dérive entre leurs pattes. Leurs pattes se confondent avec les roseaux, leurs plumes s’ébouriffent, la nuit les prend debout. Pour évaluer les états d’âme, la traductrice tapait sur la console de l’ordinateur – alors apparaissaient, en lettres vertes, les mots de passe, la traduction. Ou ses doigts couraient sur le clavier du piano : une cassation de Mozart poussait le voyageur vers les confins de l’au-delà. L’écho de leur départ mourait vite et la traductrice restait à contempler le zodiaque.
Rêvait-elle ce que je pensais ? Elle s’approcha de la fenêtre. La pluie tombait dans la rue étroite. La traductrice alluma une cigarette. Il fallait nous quitter car elle avait encore beaucoup à faire. Le brouillard se levait. Comment pourrait-elle concilier la montée des eaux avec l’élégance de ses souliers gris ? Je faillis tomber en quittant mon banc. Le brouillard se dissipait en gouttelettes sur la bouche de la traductrice. Quand elle pleurait, il devait en être ainsi. Elle ne me regardait plus. Je n’étais plus là. Je ne me souvenais plus de lui avoir serré la main, ni d’avoir franchi le seuil. Mais d’être passé au-delà des rivages du Nil, j’en étais certain. Qu’elle m’ait accompagné jusqu’au palier, j’en étais certain : une cigarette tordue rougeoyait dans le cendrier. De près, cela formait des myriades d’étincelles. La traductrice guidait les voyageurs, le temps que le mégot s’éteigne. Alors, seulement, elle les abandonnait. La contrée devenait froide, rudoyée par le vent, et l’on pouvait marcher sans déception ni remords, se dissoudre sous la pluie claire – puisque l’on avait été traduit.
55, IMPASSE DES MOUETTES
Si l’autocar s’arrête, je descendrai sous la pluie et, derrière le rideau de pluie, au 55 impasse des Mouettes, derrière les cerisiers en fleurs, elle sera là, au cœur de la maison grise et rose, elle sera là, accroupie dans le jardin d’hiver, regardant la pluie, la ligne bleue de l’autocar traverser la floraison blanche. De moi, elle ne verra qu’une ombre sous la pluie, dans les brouillards du fleuve caché par la maison, jadis remonté par les mouettes, les tiges grises et blanches des mouettes, jadis, sous la pluie.
C’est pourquoi l’impasse s’appelle l’impasse des Mouettes : au bout, il y a le fleuve où la pluie, sur la grève, fait jaillir la boue, une pluie crépitante – et la véranda semble ployer, semble ployer sous des roses de Noël. Toute la lumière vient des cerisiers en fleurs, pétales jetés par les rafales, collés par la pluie, soudés aux vitres, des ailes de papillons blanc et des fils d’araignée.
L’impasse des Mouettes est seule au monde, et elle, au 55, sa fragilité. La porte ouverte, sans surprise, sous les nuages blancs, et l’odeur d’eau saumâtre et lisse. « Je vous attendais, dira-t-elle, à l’heure du thé » – ou ne disant rien et prenant déjà le thé : une faïence blanche, fumante, et des boudoirs poudrés dans une soucoupe bleue, tourbillon mort où nagent les boudoirs. « Je ne vous attendais plus », dira-t-elle. Ou rien : croquant les gâteaux. Donnant sa bouche à baiser, un boudoir à croquer entre ses lèvres – et sa chevelure, une aile frôlée venue mêler ses fils, le goût de sa chevelure portée contre le sucre des dents. Se cambrant soudain, 55, impasse des Mouettes, perdant sa floraison, offrant ses fils, muette et souple, et la saveur de pluie, de thé, sa pluie frissonnante, pluie d’encre noire venue de Chine, de mouette en mouette, montant le fleuve, la senteur du fleuve, ses resserrements et ses îles mouvantes, léchées par l’eau sombre – puis rien ; la route décrivant ses virages, poussée par les embruns du fleuve, large, lente, soyeuse sous les roues de l’autocar – à l’heure du thé.
L’ANNONCIATION
La nuque de l’ange, brisée sur une pierre tombale. La robe de l’ange, pliée avec grand soin, posée sur la tombe voisine, plaque de marbre blanc sur lequel ressort le bleu de la robe angélique, dit le vieux.
– Accord avec l’azur, dit la vieille.
– Désarticulés, les doigts de l’ange, reprend le vieux. Tordus vers la terre, alors que les paumes regardent le ciel. La chevelure, très longue, frisée et brune, coupée, jetée un mètre plus loin sur un muret de pierres.
– Scalp, dit la vieille.
– Le corps étroit, allongé sur le ventre, dit le vieux. L’ondulation de l’épine dorsale, ponctuée, au niveau des lombaires, d’une tache suspecte, marron.
– Unique, sur la peau immaculée, dit la vieille.
Les ailes ont été tranchées net, constate le jeune homme. Il a fallu un scalpel aiguisé, un bistouri peut-être. Les moignons scellés aux omoplates attestent que nous sommes vraiment devant un être de nature angélique – non d’un quidam imberbe au bassin étroit, assassiné après d’obscures besognes. Les moignons, parfaitement secs, n’ont jamais été irrigués par la moindre goutte de sang.
– Il s’agit d’un ange, dit la vieille. Bien qu’il n’y ait aucune plume à l’horizon, bien qu’il n’y ait aucune odeur céleste, mais celle, encore légère, d’un cadavre frais.
Elle palpe le gisant. Son index s’enfonce dans la tache suspecte.
– Qu’en pensez-vous ? demande-t-elle à la jeune fille.
Pour celle-ci, à l’écart, seules comptent, dans cette aube – gros nuages, ombres sur les cyprès – les résolutions prises durant la nuit.
– Qu’en pensez-vous ? insiste le vieux.
Et le jeune homme s’approchant murmure :
– Qu’en pensez-vous ?
Pour la jeune fille, l’ange est apparu tandis qu’elle se promène dans le quartier ouest du cimetière, voué aux concessions perpétuelles, aux sépultures abandonnées, aux frondaisons galopantes, aux chats, au soleil bas, à l’affleurement des pensées intimes et, très précisément, à l’éloignement de toute morbidité. Elle vient ici conjurer les images de mort qui la picorent : avidité de becs d’oiseaux chassant leur nourriture dans son cerveau, perforant ses tympans – bécots, succions, martellements qui la forcent à se courber, comme si elle devait creuser des doigts sa propre fosse. Pour échapper à cela, elle parcourt les chemins voués aux morts oubliés. Alors, les oiseaux s’éloignent lourdement, finissent par s’envoler, et elle se redresse, contemple le vieux cimetière, campagne bosselée de pierres, trouée d’arbres.
L’ange apparaît à ce moment-là. Elle se redresse, le crépuscule lèche les feuilles – lentes dorures sur la verdeur. L’ange. Ses pieds ne touchent pas terre. Le plumage des ailes blanches oscille sous la brise. Les ailes déployées bouchent l’horizon. La robe de l’ange, longue, droite et bleue, encombre le chemin. Le contrejour interdit de distinguer les traits de l’ange dont les ailes, en se repliant, font un bruit d’éventail.
La lumière n’a aucune prise sur son visage, ni sur les mains qu’il tend vers la jeune fille. Est-ce la robe bleue qui absorbe toute la lumière ? Un bleu net, dépourvu d’ombres et de reflets. Une robe de silex ou de verre dépoli. Matière vitrifiée mais soumise aux vibrations des bras, du torse, des jambes, mais point du vent léger. La courbe des ailes dépasse des épaules et frissonne, enserrant le cou angélique d’une écharpe fluide, miroitant comme une route chauffée par un soleil de plomb. L’ange, les mains toujours tendues, avance.
La jeune fille ne peut avancer – ni reculer – tétanisée par une violente douceur, très proche du plaisir. Elle est, dit-elle, comme possédée.
– C’est le mot, dit la vieille.
L’ange est si proche : la jeune fille perçoit seulement une masse opaque et bleutée.
– J’ai connu ça en avion, dit le vieux, quand on passe à travers un nuage.
Et le jeune homme demande, un sourire aux lèvres, s’il s’agit d’un ange muet. Question idiote, sans réponse.
Les ailes de l’ange, une torsion forcenée les dresse vers le ciel – deux hautes flammes blanches – et la robe suit le mouvement, glisse, s’élève, verticale, quitte les ailes : un roc bleu pendu dans le crépuscule, oblitérant le soleil pourpre.
– Et tout cela vous semble parfaitement naturel, dit le vieux.
Il se détourne, il crache.
Le corps nu de l’ange est devant la jeune fille. Ni sexe, ni toison. Ni poitrine autre que les mamelons à peine renflés. Il faut donc, pour qu’elle se rende compte de cette nature imprécise, que l’ange ait pris du recul, juste un peu, celui nécessaire à la perception des détails. Cette preuve, la vision d’un corps neutre, emplit la jeune fille d’une terrible joie. Son être entier frémit d’un chant inconnu, obscur et allègre – effusion de chaque parcelle de sa chair.
Elle ferme les yeux, brusquement. Et s’il s’agissait d’une fantasmagorie ? Craignant l’erreur, l’affabulation des sens, elle préfère enclore l’image intacte de l’ange : fermer les yeux.
– Les chats aussi, dit la vieille, ont une vision crépusculaire.
Elle éclate de rire – rire strident, lame dans un bois vert. Et le jeune homme trouve la comparaison judicieuse :
– Vous guettiez une proie aveuglée par l’obscurité, dit-il à la jeune fille. Et l’envie le prend de la saisir par la peau du cou – ce qu’il ne fait pas.
La jeune fille ne semble pas avoir entendu le rire, la menace qu’il recèle, le commentaire guilleret. Elle répète qu’elle ferme les yeux face à l’ange : il est peut-être impossible de regarder l’ange nu. C’est plutôt cela – non le doute sur la réalité de leur rencontre. Car elle en est sûre, il est venu pour elle toutes plumes déployées, se tient immobile, sustenté dans l’air instable, les bras tendus. Et elle comprend ainsi ce geste : le corps angélique est hors du temps, mais les bras dirigés vers elle sont une fragile, timide intrusion dans son intimité. Elle aimerait s’y pelotonner, savoir s’ils sont chauds et tendres. Si elle a la force de s’y jeter, le corps entier de l’ange s’embrasera, peut-être révèlera-t-il son sexe, homme ou femme – que lui importe pourvu qu’il jaillisse ou implose ! Et il lui dira : « Tu es le centre de la terre ». Et l’enveloppera d’un chatoiement ailé où elle fondra comme un sucre dans l’eau. Et la transportera au-delà. Mais l’ange reste muet.
Elle raconte cela, fermant à nouveau les yeux – nostalgique ? Ou ne voulant par voir les autres se rapprocher, médiocres, goguenards, oui, ne voulant pas voir. Elle dit encore n’avoir pu franchir un centimètre en direction de l’ange : les bras tendus, au lieu de 1’accueuillir, la tiennent à distance. L’ange ne bronche pas davantage, et elle pense : « pauvre ange », pitié qui lui coûte infiniment – elle doit s’extraire de cette gangue blanche, lumineuse, qui l’envahit. Un étau. Deux mâchoires, l’âme mordue. Et, par la pitié, elle y arrive. Mais la pitié ne change rien. Alors, comme maintenant, elle rouvre les yeux. Elle voit l’ange baisser les bras, comme maintenant les autres tendre les leurs, menaçants. Et, comme ils se précipitent, elle se rue vers l’ange, l’empoigne, le renverse, songeant en un éclair : « c’est une statue de sel ». Et la statue s’effondre, comme elle sous la ruade des trois autres, mains mêlées, agrippant sa chevelure comme elle les cheveux de l’ange, qui se détachent du crâne, sans effort – une perruque ? – ; mains enchevêtrées, nouées sur sa nuque, comme les siennes autour du cou angélique, ressent frêle stupeur – et rompt contre l’arête d’une tombe, comme ses vertèbres à elle craquant sous la pesée des autres. Elle pense « ce sont mes juges », et veut se relever, et ne peut, roulée, barrique jetée contre le cadavre de l’ange dont on tourne la tête vers ses lèvres.
– Embrassez-le enfin, puisque vous aimez tant ça, crie le vieux.
Et la vieille, plaçant les doigts de la jeune fille autour des moignons d’ailes, disant :
– Souvenez-vous.
Parce qu’elle les cisaille avec un canif d’enfant, sans plus de difficulté qu’une feuille, les plumes s’envolent dans l’obscurité.
Et le jeune homme, les enveloppant, l’ange et la jeune fille, dans la robe bleue.
– Cette robe, dit-il vous l’avez pliée avec soin.
Oui, pense-t-elle enfin, parce qu’une robe de lin bleu, une robe d’une telle qualité, pourra toujours servir à quelqu’un.
L’ARRIÈRE-PAYS
Il y a des morts élégants, dit le vieux. Il est de ceux-là, incapable de provoquer la terreur – plutôt du respect sournois, passé le premier étonnement. Il a toujours porté beau, même de son vivant, dès l’âge de plaire aux femmes : il lui suffisait d’apparaître, elles reculaient, saisies, avant de risquer un œil. Il se souvient de cette photo où il est à cheval, grand uniforme, képi inclus. Le cheval est droit comme une statue, mais lui pas du tout, bien qu’il soit immobile, moustaches cirées, coutume d’alors. S’il montrait la photo pâlie par le temps, les petites filles reculaient, silencieuses : photo ou pas, silhouette dans l’entrebâillement d’une porte, regards d’escalier, qu’était-ce, sinon la vie lisse et claire, un soupçon brillante, gomina sur la moustache, reflets sur le costume beige ou bleu pâle suivant la saison, la peau devinée, laiteuse en dépit du grand âge, du séjour terreux – la vie, bruissement d’élytres sous la lumière hivernale, rumeur éteinte, figée par le regard des autres. Elégance ! dit le vieux. Ne jamais s’imposer, franchir le seuil ! Se tenir souriant, à disposition. Donner l’impression de s’être toujours tenu ainsi, sur le palier : « J’ai sonné, mais je n’ai pas osé insister. Vous deviez bien savoir qui était là. Vous avez regardé à travers l’œilleton, estimé inutile d’ouvrir. Forcément, si la porte s’ouvre – inadvertance – parce que vous attendiez un autre rendez-vous, quel choc ». De ça, le vieux a l’habitude, gardant pour lui ses réflexions. La porte béante, il n’avance pas, sachant qu’on ne le priera jamais d’entrer. Le voir suffit à se sentir coupable – comme si l’on ne pensait pas à lui, comme s’il était enfoui par les tracas de l’existence. Il a la courtoisie de n’en point rire, laissant émerger les remords : sans un mot d’échangé, seulement le regret de n’avoir pas su y faire avec lui. Peut-être n’est-il pas trop tard ? Lui ne peut pénétrer dans l’appartement (dieu sait s’il le connaît ! Lorsqu’il venait dîner, amenant une bonne bouteille, un plat confectionné par ses soins !), mais il faudrait oser aller vers lui, sur le palier, évidence qui claque au visage, pour implorer son pardon, qui ne vient pas, viendra si l’on va à sa rencontre ? Un bon mouvement !… L’heure tourne, le vieux est toujours, serait d’une discrétion à tout crin – sauf ce gilet gris-perle à boutons nacrés : une surface plane parsemée de taches claires. Forcément, cela attire le regard, cela fait des salissures blanches, cela provoque, ne bronche pas, cela est immobile. La poitrine ne soulève pas le gilet et toute l’immobilité se concentre dans les nacres – coquilles échouées sur une grève, ou brins de mica incrustés dans un labour. Le vieux prétend qu’il s’agit de décorations, gloires de combats finis. Le gilet ? Armure discrète, signe d’un passé guerrier. S’il revenait à la vie (si on le laissait entrer ?), la métamorphose serait instantanée, le gilet exploserait, libérant ses entrailles. Il ouvrirait grand son ventre – bonheur de l’hospitalité enfin offerte ! Mais puisque cela lui est refusé, il se contente d’attendre, pouvant aussi, si on préfère, revenir à une autre heure. Savoir attendre jusqu’à la dernière heure, n’est- ce pas le comble de l’élégance ? « Je reviendrai au moment qui vous gênera le moins. Vous finirez par m’attendre ». Il ne dit toujours rien, mais le bleu de ses yeux s’est embué : le regret de clore la porte sur le vieux saute à la gorge. Le vieux dit qu’il entre à tous les coups à ce moment précis, celui du regret que l’on croit définitif (on va passer à autre chose, reprendre ce que la sonnette avait interrompu). Impossible de claquer la porte. Il est dans la place, il précède, il sautille, il montre son album de famille, il raconte ses batailles – l’ultime avec son hôte. Il se déboutonne. Une évocation qui le fait rire. Alors, concède-t-il, il faut parler cochon. La tuade, le malaxage des tripes, évoquer ceux qui, assassinés pour avoir trop vite refermé la porte, n’en sont jamais revenus. Pour un peu, il fredonnerait « Tiens, voilà du boudin », manière de plaisanterie, rotant, coudes sur table, sifflant une bouteille de vodka. Lyrisme de pacotille, convient-il, décrivant son paysage favori – pertes blanches d’un ruisseau au creux de vallées fertiles ; et gnomes semés de part et d’autre, pierres pondues, tant d’accidents stériles qu’on aurait pu éviter en le conviant, franchement, au logis. Forêt d’avortons (comme arbrisseaux incendiés), et qui remontent, flanc contre flanc, vers l’océan, traçant à l’arrière-pays sa géographie : ellipses, confusions pensives, maigreur des idéologies, philosophies errantes, ombres – l’appareil d’une dérive, longue colonne vertébrale, rocs blanchis, osselets joués par l’écume. A cru ! dit- il, tirant sa photo équestre. Et, portant sa main en visière, le voici dressé sur un canasson empaillé, haridelle qu’il flatte (« Des fois qu’il s’emporterait ! »). A nu, dit-il, l’arrière-pays est superbe. Mais, faute d’avoir su l’accueillir dignement, l’hôte est contraint aux limbes. Confidentiel : « Je suis là pour les mêmes raisons que vous : n’avoir pas ouvert ma porte à temps ». Rassurant : « Je suis là, nous sommes égaux ». Son avantage – connaître les lieux depuis belle lurette – ne sert à rien. Pas de guide pour l’arrière-pays. L’horizon, une brume qui perce la peau, dessine d’improbables visions, comme… – hésitant – : ces tirs de mitrailleuse déchirant d’éclats la voûte céleste, pointillant d’éphémères l’ersatz d’une cartographie. Seules les tripes (qu’il pose sans vergogne sur la table de l’hôte) mettent des couleurs dans le paysage. « Voilà, dit-il, comment naît la guerre dans l’arrière-pays, d’une simple erreur d’appréciation, d’un accueil peu courtois ». Et, d’une caresse sur la joue de l’hôte : « vous êtes l’arrière-pays. Vous l’êtes devenu sitôt que je me suis faufilé. Nous allons conduire ensemble la guerre ». Et : « Nous sommes des alliés objectifs. Nous sommes l’arrière-pays… Prenez garde qu’il ne s’emballe ! » – il désigne le cheval d’arçon sur qui tient désormais l’hôte, enferré. Bête de somme dont le roulis entraîne des balafres par tout le corps. Signes de combat, coups entraînant le déséquilibre, sans qu’on sache d’où ils viennent, si quelqu’un les assène, à moins qu’ils ne soient l’écho de la touffeur de l’atmosphère, d’une dépression basculant les corps, les entravant, que les corps restent instables sans jamais chuter. « Oh ! dit le vieux, si nous pouvions quitter l’arrière-pays, nous quitter ! ». Il désigne au ciel des volutes se débattant, membranes corsetées dans la toile des nuages. Ces ailes, il dit les avoir observées – ascension, ploiement – ; les avoir capturées, détachées, analysant leurs moindres mouvements. « J’en tiens une ! » clame-t-il. Mais l’hôte ne voit qu’un geste large du vieux, comme s’il projetait du poing un épervier, puis inlassablement le reprenait contre son ventre. « J’ai disséqué, dit le vieux, dénudé les articulations… Touchez les mécanismes, ordonne-t-il ». Ce qu’il tend est invisible : il faut à l’hôte sentir des griffes déchirer ses chairs pour comprendre – une aile, passante, cisaille sa poitrine. « Une aile ! exulte le vieux. Cette fois-ci est la bonne. L’hôte et lui sauront maintenir la captive. Leurs forces réunies (« Voilà pourquoi j’avais tant besoin de vous ! »), ils harnacheront cette foutue aile. Ensemble, ils perdront terre, sentiront les derniers soubresauts, galop des canassons sur la grève – jusqu’aux ultimes secondes, lenteur d’arbres sous eux : ils seront en suspension. Vu d’en haut, l’arrière-pays est un corps livide, taché, plastron sale collé sur une poitrine, roide comme celle du vieux devant la porte ouverte, comme serait celle de l’hôte, s’il voulait… Le vieux dit : « Ce serait magnifique ». Ils verraient, l’hôte et lui, leurs corps défiler – d’abord parfaitement nets, puis s’effaçant peu à peu -, reparaître par intermittences ; pour finir, disparaître. « Sauf en mémoire, ce culbuto… Venez-vous ? ». L’hôte avance un bras, peut-être pour fermer la porte, ou par lassitude, s’assurer qu’il ne rêve pas. « Venez-vous ? » : le vieux saisit le bras au vol, et d’une poche de son gilet, tire sa photo, la brandit (« C’est moi, avant, toujours. »). Geste qui arrache les cinq boutons de nacre, roulant au sol, laissés là – des yeux de poisson bouilli. Une misère. C’est ainsi qu’il remporte la victoire, dit le vieux : par violence rapide, par bousculade. Bonne et froide plaisanterie, histoire de se mettre en forme pour le prochain épisode : grimper les étages, peser brièvement sur le bouton de la sonnette, attendre. Si rien ne vient, recommencer sans perdre patience. Un jour ou l’autre, la porte s’ouvre. Alors, au-delà des politesses et des incertitudes d’usage, entrer par la grande porte, prendre l’hôte au collet, le jeter dehors, comme un sac, sur le palier – qu’il déboule les marches jusqu’à l’arrière-pays, cette chose qui ne ressemble à rien, dépourvue d’aspérités, chose fondant dans la mémoire, la diluant (mouvance secrète, ressac immuable), dessinant seulement sur les lèvres de l’hôte le même sourire flottant aux lèvres du vieux, élégance de l’instant détruit.
L’ENFANT SAUVAGE
A force, dit la vieille, les os du crâne deviennent si minces, et la taille étroite. « Vos robes balancent comme des corolles », prétendent les amoureux avant de me serrer entre leurs mains croisées. Courant aux ronces avec le cri des oiseaux – des heures à battre le vent, à califourchon sur le grand cheval pommelé, à cru, je sens les nuages frôler mes cheveux. Faire la java, boire, cachée, du vin au goût de framboise, sucer la reine-claude du petit matin, la nuit marcher au hululement des chouettes, fouiner, j’aime cela. Dormir au soleil avec une jupe bleue, avec le prétexte d’une fatigue, pour l’envie d’être seule dans l’odeur du genêt. Voir venir les floraisons humides, entre les vitres des serres et la maison au pic de la colline, serrée par bois et friches – où concéder un rendez-vous : le corps en sueur, jouer à l’épouse, puis se dégager, incapable d’autre chose : « Cette fille est une sauvage ». Je ne songe guère aux livres, sauf aux taches, à l’encre, à ceux, interdits, dégustés, dos à la citerne du potager, et, derrière la paroi de zinc, la pluie s’accumule. Une langueur me colle au métal froid. L’effort de se retourner, corps roide, vaut la récompense : coller la bouche contre la saveur rouillée, perlante, cueillir de la langue la poussière d’une toile d’araignée, lécher cette rouille, téter, à petits suçons, ainsi font-ils contre mes seins, les hommes, disant : « Elle est chaude, celle- là ». Les repoussant gentiment, sans regret, je glisse dans la nuit, aux chemins de pierres roulantes, tirant une cloison invisible entre eux et moi, sans qu’ils s’en doutent, moustiquaire où ils viennent buter, cherchant à déchirer ça – mais ils ne peuvent rien, si je ne veux pas, que peuvent-ils contre ce tulle : la nuit ? Parfois, comme celui qui me trouve dodue, l’un me tente davantage, le temps de se pelotonner, trouvant bonne son odeur. Quoi de plus fugace, l’odeur ? « C’est une fille à éclipse », affirme-t-on. Que ne leur vient-il aux lèvres : « c’est une fille nue ! ». Pour moi, comparant ces messieurs, c’est ce que je pense, marchant dans les garrigues où j’arrache une herbe longue pour encercler ma taille. J’ai de solides jambes, égratignées – jolies jambes et le pied fin, cambré. Plongé dans la citerne, les alevins l’enrobent, butinant la peau ; puis longuement je bois, écartant de la paume l’eau en larges cercles, et relève la jupe bleue, ôte mon maillot de corps, trouvant trop forte ma poitrine, trop ployante, et me vois mignonne. Je veux boire à ma source alors, et tente de partir en courant : qui me tient là, contre la citerne, écoutant les gouttes y ruisseler, comme chutant en mon ventre ? Et je reste, immobile, un bon moment, avant le retour de la paix, jusqu’à l’envie d’être prise sur les genoux – bon papa dont je griffe la barbe, ou l’oncle d’Amérique au visage carré, qui me pelote l’air de rien, évoquant son yacht d’Hawaï. D’être la petite fille dans son cerceau sur le gazon d’une villa bleue, et je nargue la terre entière, sautant à cloche-pied avec des formules cabalistiques accessibles aux seuls lapins blanc, l’œil rouge d’avoir tant pleuré. « Oui-non », dis-je. Tout rentre dans l’ordre. Non : la plainte des morts siffle sur la citerne, à l’aube du soleil cramoisi – comme s’ils étaient trop, là-dedans, qu’il faille chantonner pour eux, pauvres morts. « Tu est trop gaie pour le bonheur » sifflent-ils dans la citerne. Il n’y a plus que le vent – mais je chante encore -, seulement le doux vent humide qui caresse la peau, s’infiltrant partout où il ne faut pas, dans les recoins que les hommes aiment tant. J’ai une belle santé à ce qu’on dit ! Et les pauvres morts se rebiffent, cognant la citerne. Et les draps tendus sur le fil, non loin, entre les vieux chênes, me capturent entre leurs plis si je tente l’échappée : je reste comme un oiseau au bord de l’asphyxie, enserrée par les cotons trempés. Le vent se calme, mais je reste cachée dans les draps, guettant les cavaliers en promenade vers le plateau. Ils passent devant le linge, je fais bouger les draps et les chevaux s’écartent. Peut-être même, l’un d’eux se cabrant, un cavalier roule-t-il à terre, ce barbu trop nonchalant sur l’étrier. L’œil affolé des chevaux, je le guette ! Le drap s’élève, et le cheval noir avec son nuage de mouches. Dents et naseaux coupent le ciel. Un hennissement jette le barbu dans les caillasses, criant « sale peste ! ». Et je lance le drap sur lui, m’enfuyant comme le cheval. Si le barbu m’attrape, je sais quoi faire pour l’amadouer. Croit-il avoir le dessus alors que je parviens au but, sous lui, crachant : « Mais qu’est-ce que vous fabriquez ! ». Puis le laisse se transformer avec un profond soupir, qu’il bande. Bel instant pour m’éclipser, montrant mon cul blanc qui n’est pas pour lui. Si par malheur il me rejoint, ce n’est pas avant le potager, et je tambourine si fort sur les flancs la citerne, si fort que les échos du zinc sonnent dans toute la vallée : ainsi viennent à mon secours les morts aux abois métalliques. Ma douceur n’est pas pour ce type. Vraiment non. Je préfère glisser dans la citerne haute et profonde. Il n’y a qu’à se laisser couler pour surgir dans l’eau grise : je remercie les morts d’avoir tant aidé une fille innocente. Eux me félicitent d’être si agile, du tour joué à un plouc, un de ces trop vifs. une proie du désordre, alors qu’ici, chez les morts, tout est soigneusement comptabilisé, sans dérapage possible. Juste quelques algues frissonnant sur les orteils. Subtiles caresses ; question plaisir les petits morts s’y connaissent. Il y en a tant, dedans, têtards à l’œil mi-clos, façon de rien, à me sucer dans le grand silence de l’eau ! Si je suis là, au fond, ils le savent : pour leurs lècheries. Qu’ils écartent mes chairs délicates, j’offre le grand jeu : plus bouger d’un iota, cesser de respirer, feindre, avant, la suffocation, bleuir avec les petits morts, souffrir un peu, mais sans à-coups ni drames, comme être massée de longs doigts infiniment souples filant, ne respectant délicieusement rien du dedans ni du dehors – être leur gant retourné, je suis cela dans la citerne ; alanguie, batifolante. Qu’ils prennent une bonne pinte de moi, et je les sais heureux, les morts, attachés à mon corps élastique; je les entends roter les bébés morts et venir en moi qui déguste, me tournant, retournant en des positions inavouables. « Fine algue », tel est leur compliment, et les mordillements de reprendre, autrement roboratifs que ces baisers profonds qui vous essoufflent. Oui, petits morts, facétieux, fantaisistes, loupiots, astragales, stimuli, comme je vous aime ! Et nous rêvons ensemble, rêvons encore dans la citerne du potager aux feuilles semées en surface de l’eau morte, car voici : un ver luisant bascule dans l’eau froide et rouillée, s’exténue à franchir l’opercule de mes lèvres. « Y viendra ? Y viendra pas ? » disent les petits morts – mais ils savent : toujours, je m’ouvre au ver luisant, tandis qu’ils m’assistent sans remous. Sitôt avalée cette luciole malhabile, me serrent de près, les morts, chers ! émus de ma concentration : sentir en moi le ver se débattre faiblement, jusqu’à totale immobilité. Et tous, sommes impavides dans la citerne – pressés, les morts autour de moi pressant le ver. Quand je m’écarte enfin, surgit cette émotion : une fille, si mince, dans sa jupe bleue, taille serrée d’une algue, fille rousse, blanche, montant vers la surface de la citerne, avec une lenteur de caresse, aspirée par la lumière blanche et jaune du soleil. De l’assomption, restent un ourlet bleu, le fuseau des mollets, l’éclat d’une cheville, la suave plante des pieds ciselés – et leur cambrure absorbée par les rayons. Et les morts l’entendent s’échapper. « Adieu » rie-t-elle d’une virevolte, d’un reflet, « je vais faire la java ». « Adieu », chuchote l’enfant sauvage, laissant à peine l’onde remuée d’un grand cercle; et je réponds : « alléluia, ma fille, alléluia ! »
L’EXCURSION
Il faisait si beau. Ils partirent tous quatre à l’assaut du chemin qui contournait la montagne, un chemin vert, balisé de fermes en ruines et de clôtures électrifiées à basse tension. Des vaches blanches et rousses parsemaient de bouse les pâtures.
– On a l’impression d’avancer vers le ciel, dit la jeune fille.
– Pas tant que ça, grommela la vieille.
Le jeune homme avait ralenti l’allure. Il restait aux côtés du vieux qui essayait de ne pas s’essouffler. Bientôt, le jeune homme n’y tint plus : insensiblement, ses enjambées augmentaient. Il filait maintenant si vite que la jeune fille avait du mal à le suivre.
Distancé, le vieux, pour l’exemple, pressait encore le pas – mais, inexorable, la vieille le rattrapait. Il était dépassé. Elle le doubla avec un sourire triomphal. Pour l’exemple. Lui, son cœur en prenait un coup. Il tenta un dernier sprint, parvint à se maintenir, quelques secondes à la hauteur de la vieille.
– Mon cœur en prend un coup, annonça-t-il.
– Il faut faire fonctionner la mécanique, riposta la vieille.
Par acquit de conscience, elle avait freiné – pour rien : le vieux ralentit encore, s’arrêta en soupirant.
– Je n’irai pas plus loin.
– Que si.
Elle prit son bras, le soutint, tentant de le persuader que son cœur ne battait pas si vite.
– L’air des cimes est excellent.
Elle en profitait pour reprendre sa respiration en montrant le paysage grandiose, la dentelure des nuages, les traînes mauves des bruyères, lui conseillant d’aspirer à pleine gorge : alors, il galoperait comme un poulain – à tout le moins comme ce veau qu’ils avaient effarouchés tout à l’heure.
Plus haut, plus loin, dans les genêts bousculés par les rafales, la jeune fille herborisait. Elle découvrait la gentiane et l’œillet sauvage, si rouge qu’à le regarder on avait l’impression de croquer des grains de poivre. Echappées aux lauriers de Saint-Antoine, des bourres cotonneuses accrochaient ses cheveux. Ses exclamations, toujours plus vives, retentissaient dans l’air glacé : le jeune homme revint sur ses pas – ce qui était le but de tant de cris admiratifs. La jeune fille était prise d’une fringale. Elle voulait s’arrêter là, sous le vent qui la décoiffait, découper le saucisson et boire un coup. Lui aurait préféré un autre panorama, plus ample ou davantage abrité, pour pique-niquer : il avait encore envie de marcher. Leur halte avait permis à la vieille de les rejoindre.
– Le vieux se fait attendre, dit-elle. C’est l’habitude.
Quand enfin il arriva, lui aussi se serait bien arrêté pour manger un peu.
– Ça creuse, dit-il en désignant la montagne grise.
Mais la vieille était parfaitement d’accord avec le jeune homme : l’horizon n’était pas assez dégagé et le vent soufflait trop. On pourrait continuer – pas trop longtemps, mais encore.
Elle marchait maintenant à droite du jeune homme. Quand il faisait un pas elle en faisait trois, sans se plaindre,Vous voyez, dit-elle, ils s’entendent bien. .
Elle désignait le vieux qui, derrière, ôtait les bourres de coton des cheveux de la jeune fille. Il s’amusait, ôtant lentement les duvets blancs, les laissant flotter au bout de ses doigts, avant de les abandonner au vent – et ils tourbillonnaient, revenant parfois se déposer sur la chevelure. Il disait alors qu’elle attirait la neige, ce qui la faisait rire chaque fois un peu plus fort, une trille ou un gloussement.
– Quand elle a faim, dit le jeune homme, tout est prétexte à s’arrêter.
– Il en profite aussi, grogna la vieille. Il sent la jeunesse.
Et comme il rétorquait en souriant que « c’était bien normal » :
– Il n’est pas si innocent qu’il y paraît. Je sais de quoi je parle.
Elle tapota l’épaule du jeune homme.
– Arrêtons-nous là.
C’était un bosquet de fayards, bas et tordu. Le vent dominant les avait figés en bourrasques naines, éternellement vers le nord. Ils rampaient, racines et branches mêlées, crochetant des blocs de pierre grise, décrivant un cercle presque parfait autour du lit à sec d’un torrent. Le jeune homme prétendait que les elfes venaient s’abreuver là, après les orages ou à la fonte des neiges : il sentait leur présence au silence des lieux, un silence fin qui incitait à se taire – alors qu’on n’arrêterait pas de jacasser, il en était sûr. Il soupira, contemplant les montagnes lointaines, la main en visière, à cause de la réverbération, et pour masquer son agacement.
– Cela vous convient ? C’est un beau point de vue, n’est-ce pas ? dit la vieille.
Il sentit la main douce et sèche de la vieille se couler dans la sienne. Il dégagea ses doigts pour désigner les pics.
– Un beau point de vue, oui, concéda-t-il d’une voix sourde, pour qui sait regarder.
La vieille s’était adossée contre un rocher qu’elle caressait de la paume. Elle restait là, le regard vide, comme un insecte cloué par le soleil blanc. Le jeune homme pensa qu’elle avait dû être belle – de ces beautés impalpables, folâtres ; le grésillement transparent d’un élytre dans la lumière. Elle avait encore peu de rides, sa peau mate et claire frémissait à peine. Un souffle aurait pu la soulever, la décoller de la pierre, l’emporter vers la dentelle aigüe des sucs qu’il nommait, en habitué des lieux :
– Le suc du Montfol, et derrière, l’Adreyt, le Sagnes…
– Magnifique, dit la vieille. Moi aussi, je grignoterais volontiers.
La jeune fille avait envie de dévorer, voilà ce qu’elle clamait en débouchant au milieu des hêtres. Ses cheveux étaient lisses comme une coque – elle avait dû se recoiffer. Le vieux traînait la patte dans la montée. Il était rouge d’efforts. Le bosquet lui convenait. Il était, disait-il, prêt à manger.
– Dans ce cas…
Le jeune homme déboucla son sac à dos. La vieille se frotta les doigts. Le jeune homme contemplait encore la brume qui menaçait les pics, le vieux revendiquait la coupe du pain. La bouteille de vin circulait du jeune homme vers la jeune fille, de celle-ci vers le vieux. La vieille refusa de boire : le vin, secoué par la marche, risquait de lui gâter l’estomac.
– Je lève mon gobelet, dit le jeune homme, à notre réunion au soleil couchant.
Ils avaient marché longtemps, et le soleil – on était à l’heure d’hiver – amorçait sa phase descendante. La jeune fille contemplait le vin, irisé par les rayons.
– Redonnez-moi un coup de rouge, dit-elle.
– Il est fameux, dit le vieux.
Il répéta « fameux », en claquant de la langue, tandis que la vieille saisissait le gobelet du jeune homme.
– Dans ce cas, j’y tremperai les lèvres.
Ils avaient si bien mangé. Les reliefs, les papiers, les gobelets, le couteau suisse du jeune homme, un paquet de cigarettes, un briquet mauve, tout cela, dispersé sur les pierres plates, abandonné à l’ombre du bosquet. Le jeune homme pensa que tous les quatre pourraient être morts, volatilisés. Où sont-ils passés ? se demanderait-on. Il ne resterait que les miettes du festin, accroché par la lumière rasante du soleil hivernal. Comme les autres, il reposait dans le lit asséché du torrent. Chacun dans son trou, avec des pierres autour. Les autres faisaient la sieste. Le vieux, la face couverte d’un chapeau marron cabossé, les jambes écartées. La vieille dormait en chien de fusil, tressaillant sous les mouches, ronflotant. Elle avait prévenu :
– Je dors loin de vous, à cause de ma respiration.
Elle avait entraîné le vieux à ses côtés, ajoutant seulement :
– Lui aussi.
Elle l’avait tiré violemment par la main.
On voyait bien que la jeune fille somnolait : au moindre vol d’une guêpe, le duvet blond de ses bras frissonnait. Le jeune homme avait l’intime conviction qu’elle ne dormait pas vraiment. Ses paupières closes la protégeaient seulement de la lumière crue de l’altitude. Des nuages devaient cerner son iris, le strier d’ocre et de bistre. Il souhaita si fort qu’elle ne dormît pas qu’il eut l’impression de la toucher, que sa main longeait la jambe ensoleillée – elle s’était allongée si proche de lui, si loin des vieux.
Elle bascula lentement sur le flanc, yeux grands ouverts. Il ne s’était donc pas trompé – à moins qu’elle n’eût le réveil rapide ! Il resta étendu, bras sous la nuque. Elle le surplombait, l’œil vif, bougeant, comme au ralenti, un mouvement pourtant naturel. Il n’y avait rien d’autre à faire que d’attendre ce mouvement, le glissement des hanches autour d’un point invisible relié au centre de la terre, sous la montagne aux pierres grises. Elle souriait. Il lui sembla qu’il suffirait d’étendre la main. Les yeux de la jeune fille basculeraient vers lui, ainsi écarquillés, sur lui. Peut-être crierait-elle ? Peut- être pas. Un simple sursaut suffirait à rompre le charme, à réveiller les vieux dont, finalement, rien ne garantissait l’assoupissement : à cet âge-là, le sommeil était fugace. La jeune fille détourna son regard vers le ciel. Elle scrutait un oiseau minuscule, perché à la pointe d’une branche.
– Il faut vraiment savoir qu’il s’agit d’un oiseau, dit le jeune homme.
– C’est une alouette, dit la jeune fille.
Il y avait de l’émotion dans sa voix. Tous deux contemplèrent l’oiseau, ailes battantes, dans la transparence du ciel, à toute vitesse. Il s’envola, mais resta à l’aplomb de l’arbre, se maintenant sur place à coups d’ailes frétillantes : ainsi, il n’était qu’un point obstiné dans l’azur, une vibration.
– Il a quitté sa branche, dit la jeune fille, et il se donne un mal fou pour rester exactement au même endroit. Quelle perte d’énergie !
Peut-être l’oiseau était-il devenu, à cet instant, la clef de la voûte céleste ? Peut-être avait-il volé au secours des deux en détresse ? Peut- être l’alouette avait-elle empêché la fin du monde… Le jeune homme pensa cela mais il dit :
– Au même endroit, oui. Mais beaucoup plus haut.
– Il a filé ! s’exclama la jeune fille.
Et son exclamation réveilla les autres.
Le vieux souleva son feutre, la peau fripée surgit du chapeau – la mauvaise blague d’un illusionniste : la sieste avait creusé des rides supplémentaires, à moins que ce ne fût un effet du soleil rasant. Son visage était devenu le médiocre reflet des montagnes alentour, de la terre érodée, boursouflée.
– J’ai entendu tout ce que vous disiez, blagua-t-il. D’une voix faussée par le sommeil, il répétait : « …tout ce que vous avez dit », en secouant la vieille par l’épaule. Plus il la secouait, plus il répétait, plus le timbre de sa voix redevenait normal. La vieille émergea enfin.
– Tu as ronflé, dit-il, triomphant.
– Pas tant que toi.
Elle se redressa. Ainsi, très pâle, les jambes écartées, elle semblait une petite fille, une nonne miniature, perdue, juchée sur un immense fauteuil aux coussins de pierres – celles du cercle de granit. Elle se plaignit d’avoir le soleil dans l’œil, l’astre du crépuscule, pourpre, au ras de la montagne grise. A l’autre bout de l’horizon, une lune rouge et diffractée n’en finissait pas de grossir.
– Si je n’avais pas si mal aux doigts, j’applaudirais, dit le vieux. Oui, j’applaudirais.
Il esquissa le geste, s’arrêta – comme si le silence s’était glissé entre ses paumes, les empêchant de se rejoindre. La lutte entre les globes s’amplifiait, embrasant d’est en ouest le ciel de traînes mauves. Les nuages de la nuit s’étiraient, des éclairs paresseux qui drainaient le froid, les jetaient sur le cercle des pierres. Tous frissonnèrent quand le soleil bascula, laissant le firmament à une lune jaune, soudain rétrécie.
– Le soir tombe vite à cette saison, commenta la vieille.
– Nous allons redescendre, dit la jeune fille.
Sa voix ferme sonnait comme une clochette d’école.
– Il ne faut pas exagérer, dit le jeune homme. Nous avons encore du temps devant nous.
– Pas tant que ça, murmura le vieux en portant la main à son cœur.
L’HUISSIER
– J’ai bien vu qu’il s’agissait d’une visite amicale et rien d’autre. Comment savait-il que nous possédons un piano ? Ces gens-là sont au courant. Peut-être avait-il déjà regardé à travers la porte-fenêtre. Cela n’a aucune importance. Dès qu’il est entré, il a demandé : « C’est vous la pianiste ? » S’il m’avait entendue jouer, il saurait que je ne suis pas la pianiste. On peut s’asseoir devant un piano, tapoter les touches, sans être pour autant pianiste. On peut contempler le paysage. Mais peut-être m’avait-il vue, assise devant le clavier. Un coup d’œil aura suffi pour qu’il saisisse l’instrument et sa propriétaire. Encore ignorait-il qu’il s’agissait d’un piano de location. Mais je lui ai répondu que c’était moi la pianiste, pour simplifier et ne pas le contrarier dès l’abord. De toutes façons, il n’a pas eu l’air satisfait de ma réponse. Il portait des lunettes de myope qui lui donnaient un regard effaré. J’imagine que cela doit impressionner ceux qu’il vient expulser. Je l’ai invité à s’asseoir sur le tabouret du piano. J’ai tout de suite senti que je marquais un point : il n’a rien dit avant de constater que, mis à part le piano, il ne voyait pas vraiment ce qu’il pourrait inscrire sur son inventaire. J’ai écarté les bras. Je ne pouvais rien faire de plus pour l’aider. Du reste, il avait été prévenu, par téléphone, de ma situation précaire. S’il avait tenu à venir présenter son exploit, c’était pour faire son métier. Il faisait son métier. S’il était mal dans sa peau, c’était son problème. Je n’ai donc rien répondu. A son tour, il a écarté les bras en regardant la partition posée sur le pupitre du piano, les Nuages gris de Liszt. Pour masquer sa gêne, il a feuilleté la partition. J’en ai profité pour lui dire que Liszt était mort dans la misère et que, dans sa vieillesse, il avait composé ces fameux Nuages gris, des pièces célèbres qu’on ne jouait jamais. A ce moment-là, j’ai eu envie de le mettre à la porte, parce qu’il s’était permis de toucher à cette partition. J’ai bien fait de me retenir car il m’a annoncé avec un ton blagueur qu’il allait énumérer mes droits : il ne pouvait saisir ni le lit, ni la table, ni les chaises, pas même la télévision. Il n’y avait rien de tout cela chez moi, de toutes façons, hormis un matelas posé sur le parquet. Il n’y avait qu’un piano et ce devait être, puisque j’étais pianiste, mon instrument de travail, qu’il ne pouvait pas non plus saisir « si j’étais pianiste ». Encore ignorait-il toujours qu’il s’agissait d’un Bösendorfer de louage. Il ajouta que j’avais le droit, aussi de conserver deux vaches ou quatre moutons ou quatre chèvres ainsi que le fourrage nécessaire à leur alimentation – une farce qu’il doit faire souvent en ville lorsqu’il veut détendre l’atmosphère. Pour le piano, évidemment, il fallait établir qu’il s’agissait vraiment d’un instrument de travail. Le plus simple, à défaut de produire des feuilles d’imposition qui mentionneraient que je vivais du piano, était que je lui joue quelque chose ; un morceau, si bref soit-il, suffirait. J’aurais pu, alors, lui fourrer sous le nez le contrat de location du piano, mais j’ai préféré refuser d’exécuter la moindre mesure, même si, comme je le pressentais, il était mélomane. « Alors, a-t-il dit, je peux faire comme si vous interprétiez les Nuages gris. » Et il s’est mis à déchiffrer la partition de Liszt. Le résultat n’était pas excellent, loin de là. Il jouait au moins aussi mal que moi. Je dois avouer que j’ai été émue, à cause de son application, d’un minimum de doigté qu’il possédait indiscutablement et, enfin, parce qu’il souhaitait me venir en aide. Il n’a pas insisté longtemps avant de déclarer que la preuve était suffisante et, de mon côté, j’ai concédé qu’il avait un jeu tout à fait professionnel. Regrettable qu’il n’ait pas pu en faire sa profession, pas pu davantage exploiter ses dons. La conversation avait pris un ton d’autant plus personnel qu’en disant cela, c’est à moi-même que je parlais. Ces doigts posés sur le clavier, ces doigts d’huissier, auraient pu être les miens. J’aurais pu, moi aussi, saisir la musique, saisir ma vie avec la musique, au lieu de quoi je pourrissais sur pied face à un Bösendorfer, un quart de queue de location, dont j’avais les plus grandes difficultés à assumer les échéances et de plus grandes encore à pratiquer. Pour en finir, parce que ma position devenait à chaque seconde davantage intenable, j’ai proposé à l’huissier de lui donner des leçons, gratuitement. Mais il a refusé : cela ne servirait à rien, sinon à raviver des souffrances. Son refus m’a soulagée. Je lui ai proposé de boire un verre. Mais il ne buvait que de l’eau et nous en sommes restés là.
LA NUIT SI PROFONDE
La nuit si profonde, je n’en veux pas. Depuis le temps que je suis là, avançant, dans la même direction, petit à petit, toujours vers le soleil levant, la nuit pas question. Lui – elle désigne le vieux, allongé – il aime les étoiles, les pierres. La chance ne m’a pas souri, avec lui, mais, s’il passe, j’aurai un creux à l’estomac. J’irai lui porter des myosotis, souvenir des myosotis qu’il m’offrait, mais pas question de verser une larme. C’est bien avant que je pleure, jeune, soupirant, attendant, assise sur son lit, nue, tandis qu’il dort à poings fermés, ou bien, s’il se réveille, me regarde comme si j’étais un songe. Ou bien encore, s’il étend la main, je ne suis pas sûre de ses désirs, j’ai froid, à force de voir cette main qui cherche à accrocher ma peau. Je le prends pour un boucher, alors qu’il est dans la nuit, n’en sort pas, sauf cette main qui touche mon ventre avec maladresse, et je ne ressens rien, hormis un froid instable, et recule, me sauve, avançant ainsi, déjà, vers le soleil levant, tandis que lui s’enfonce dans la soute.
Trop tard pour les regrets : je romps les amarres, m’occupant de lui à chaque instant. Il n’y a personne d’autre. Je reste, à l’entendre parler de ce qu’il ne fait pas, rêve de faire, n’a pas encore fait, qu’il accomplira demain, pourvu que je le soutienne, ce que je refuse, en silence. Pourquoi l’aider ? Il est seul, étendu dans le noir, renégat. Ma vivacité lui donne du fil à retordre. Il tourne le cou, inquiet, me pliant à ses caprices, exigeant que je me caresse le sexe avec une tranche de melon, ce que j’accomplis, y prenant alors un plaisir qui lui échappe.
Le mieux serait de lui donner un comprimé, qu’il accepte la roulette russe, pour en finir. Je lui présente ce dernier loisir entre nous, sans le tromper sur la marchandise qu’il prend pour s’échapper enfin dans la nuit qu’il aime tant. Il plonge les doigts. Nulle part ailleurs il ne trouverait la paix, sauf dans cette nuit profonde atteinte du bout des doigts. Sa main, timidement sortie de l’ombre, lancée vers moi, à l’aveuglette, hameçon, retourne dans la nuit avec un comprimé. Lentement, sans chichis, hormis peut-être l’angoisse de sentir que, bientôt, tout sera consommé, il se recroqueville. Mais je n’ose rien lui proposer, comme s’il s’agissait d’un marché de dupes, et nous vieillissons avec les tracas que cela pose.
Certains matins, il devient sourd, à cause de la nuit, dit-il : il m’assène son périple nocturne. Je me défends. S’il faut le suivre dans ses rêves ! Cela se traduit en marmonnements, feintes : le sommeil, brutalement, l’assaille, l’emporte. Une bonne partie de la matinée se passe ainsi. Parfois, il se tourne vers le mur, agrippant l’oreiller, ruse pour me contraindre à me pencher sur lui, observer s’il dort vraiment – pour toujours, j’espère. Vainqueur, il ouvre les yeux, dit qu’il a senti ma présence, ce qui l’a réveillé. C’est un reproche triomphal. Il tend la main – il passe sa vie à faire la manche, arrogant, comme si tout lui était dû. A force, cette main, la droite, s’est déformée, les rhumatismes n’arrangent rien : pas belle à voir. Mais je m’habitue. En hiver, dans la campagne déserte, on préfère croiser, au détour des ronces, sous le ciel gris, l’œil d’un chasseur. Je préfère avoir peur que rien. J’attends cette main sournoise, tendue, victorieuse, quand je ne l’espère plus : est-il encore capable de tendre la main ? L’attente s’achève-t-elle, enfin, à jamais ? Soudain, la main surgit, émergée de la chaleur, de la nuit, des draps, et je pleure de soulagement, et je saisis ses phalanges avec une feinte lenteur dont il n’est pas dupe, les glissant au creux de mes paumes, les frottant.
Nulle part ailleurs, dit-il, il ne trouverait la paix. Jamais le souci de ma paix ne l’effleure. Si je pleure, c’est en silence, dans une autre pièce. Si je crie – mais je ne crie jamais : ceux qui pourraient m’entendre ont disparu depuis belle lurette, détournés pour toujours, effarés de me voir supporter, sans frein, ce qu’ils nomment ma croix. Idiots. Persuadés que je trouve mon compte à l’ingratitude, l’obstination, à la persécution, à sa monotonie : « elle a ce qu’elle mérite ». Ils n’ont pas tort. Je m’habitue au minimum, je me regarde durer à petit feu, sûre, qu’après tout, vivre en veilleuse est une ascèse, un placement qui doit, à la fin assurer une sorte de paix – alors que la guerre me ronge, que la gangrène dévore mon ventre, que la révolte m’assaille.
Personne d’autre au monde ne peut me comprendre, sauf lui, source de ce qui me retient, rivée à son lit, à ses soupçons : « Tu t’absentes ? Pourquoi ? » – mais il n’écoute pas la réponse. S’il prêtait, une seule seconde, fugitive attention à ce que j’essaye d’être, il sentirait le vent tourner. Par exemple, si je ne prends pas, tout de suite, sa main : elle reste, en attente, à battre faiblement la mesure, saugrenue, comme ces moignons de pattes que les pigeons arborent, faute de s’être assez vite retirés devant les roues d’une voiture. Quand, enfin, je saisis sa main, ses ongles s’enfoncent, jusqu’au sang. Il a du sang sur les doigts, mon sang, qu’il flaire, pour être sûr de me reconnaître. Cette fois, tout rentre dans l’ordre. Je peux me figurer qu’il a, en me griffant, donné une preuve d’amour.
Nulle part ailleurs, non, il ne trouve la paix – qu’en moi : ce que son regard semble perpétuer si, parfois, sa paupière se lève. « Personne d’autre que toi », dit-il, célébrant les noces où, côte à côte, nous savons quoi faire, le temps nécessaire à sa petite secousse, peu importe où, pourvu que ce soit en moi, dans ma chaleur. Si ça ne dure guère, il est content quand même. Je dois m’estimer heureuse de cette blancheur déferlant jusque dans ses yeux, qu’il ferme, me laissant me débrouiller pour la suite, seule. Je ne sais plus s’il s’agit d’un bon souvenir ou non, mais que tout devient jour après jour davantage abstrait, je le sens, redoutant le renouvellement des agapes. Jusqu’à la nuit où il se tourne sur le flanc, m’accusant de lui sucer la moelle. Je bondis sur l’occasion : « Dorénavant, je pourrai profiter du monde extérieur. » Il éclate de rire : « Bravo ! Le monde extérieur ! ». Il prétend trouver l’idée excellente. Profiter. Extérieur. Félicitations. Sais-je vraiment ce qui se passe au dehors ? Lui se tient informé. D’où il est il n’ignore rien. Le climat social a beaucoup changé. Mœurs. Révolution. Si je veux m’y frotter (« Avec quel argent, s’il te plaît ? »), j’aurai des surprises. Il veut dire que je ne le quitterai pas impunément. De cela, je ne parle plus, fière quand même d’avoir acquis ce répit. Dès lors, je n’accorde que le strict minimum, nous liant, à la lettre, du bout des doigts.
C’est encore trop. Je le photographie, couché sur le dos, bouche close, yeux clos, les mains cachées, de part et d’autre du corps, allongées, sous le drap, sous la couverture : les formes des mains disparaissent. Les formes du corps s’estompent. Reste la tête. Je le photographie avant de cacher la tête, tirant, d’un coup sec, le drap. Je photographie notre avanie. Si j’avais un miroir, je me serais photographiée devant son corps, pour voir mon regard posé, une dernière fois sur lui. Ou si je disposais d’un appareil à déclenchement retardé. Ou je convierais un témoin pour qu’il nous tire le dernier portrait. Mais je ne connais plus personne, hormis lui, qui n’existe plus. Après, après la photo, je suis en paix, cœur, âme et conscience. Nulle part autrement je ne trouverais la paix, nulle part ailleurs. Je commence lentement à vivre : comprendre ce qui s’écoule (long fleuve ? mince ruisseau ?) hors de moi. Je ne sais plus mentir.
__________
…Nulle part ailleurs ? En moi seulement ? Maintenant je suis là, seule. Je le désire depuis la seconde où je mets la main sur lui. Nulle part ailleurs. Je le pressens avant qu’il n’éclose en moi pour toujours (ça remonte au diable !). Nulle part ailleurs. Nulle part autrement (l’instant précis où il cesse d’agir en moi), je ne trouve de paix. Cela commence – ma part – non pas dès sa fin à lui, attendue, impatiemment, préméditée, mais dès l’instant où je le rencontre, ce que j’ignore avant qu’il disparaisse. Il fallait donc que je souffre. La fin de la douleur passe par son absence, ardemment souhaitée, fugitivement, puis, jour après jour, de manière forcenée, ce que j’ignore avant qu’il disparaisse. Maintenant, j’entre dans ma paix – l’orée d’un bois – me retournant, anxieuse d’avancer seule, vers lui qui cesse d’exister, comme s’il devait m’encourager, ce qu’il n’a jamais fait, sinon à rebours : « Plonge, ma fille ! Tu verras combien c’est froid ! ».
Je ne cesse jamais de me débattre. Nulle part autrement je ne pourrais aller de l’avant. Travers des arbres, paix hivernale, arbres noirs me ramènent à ses mains tordues. Les arbres scintillent sous le givre. Je n’ai pas à écarter leurs branches : elles poussent haut. Il suffit d’avancer, habitude à prendre sans regrets, dans la lumière de l’aube, au travers des fûts noirs, jusqu’à ce que son souvenir ne soit plus féroce mais diffracté, avant qu’il n’éclate en moi, libérant mes forces tenues rétives.
Rien. Il le dit ainsi, dans notre jeunesse – nous marchons dans la neige qu’il désigne : « Elle étouffe nos pas ». Si je lui fais remarquer le crissement sans cesse répété, le sien puis le mien, bruit unique sous le soleil, petite trace sonore, intacte à jamais (je m’accroche à son bras pour lui faire remarquer cela, il se dégage), si j’insiste, osant un baiser dans son cou, il s’écarte : « Tu ne veux pas chanter, aussi ? ». Une fois, pourtant, il glisse à mes genoux, m’enserre, m’éclaboussant de neige, et je le rejoins. Nous restons. Je ne sens pas le froid. Il me regarde, me trouve belle, sa main fouille mes vêtements, il atteint la peau tiède. Tiède, c’est son mot d’amour.
Après, il dit non. Et je me relève, humiliée d’avoir été fouillée, me relève titubant dans la neige – j’en ai jusque dans les cheveux, une neige qui fond sur le cou. Lui, c’est un poteau, debout, jambes écartées. La neige glisse sur son anorak. Il est intact. Il ressemble à un de ces prismes basaltiques, coupants, hauts, noirs au dessus des rivières. Un fragment va s’abattre, d’un coup, détaché de son épaule, de sa hanche, me trancher.
Il ressemble, aussi, à un homme qui vient de faire pipi. Ses jambes se rapprochent l’une de l’autre, la portion de ciel que je vois entre ses cuisses diminue, il tend une main secourable, pour qu’une fois encore j’accroche ses doigts. J’écarte ses doigts, lentement je me redresse, je lui crache à la figure. Au lieu d’avancer vers moi pour me gifler (geste qu’il esquisse), il se met à reculer, le bras droit toujours courbé, immobilisé pour la gifle, il recule comme s’il valsait, lentement il atteint le bord du précipice où, si je ne hurle pas, il tombera à la renverse, le bras toujours arrondi, si je ne crie pas : « Arrête ! ».
Après, il repart, à grandes enjambées nonchalantes, et je suis, deux pas pour un. Les flocons tombent dru : ils le cachent. Je reste seule face à un nuage gris, dans l’ouate des flocons. Jamais nous ne reparlons de cette après-midi unique. Maintenant, il se méfie, c’est le résultat. Cette histoire est vraiment ancienne. Je l’aurais oublié si, au moment de tirer le drap sur sa face, un pli, apparu entre son épaule et son menton, ne creusait le tissu blanchâtre à la façon d’une bourrasque de neige enlevée vers les hauteurs et qui, quelques fractions de seconde, tournant si vite sur elle-même, se dresse, immobile : pour effacer ce souvenir, son évocation, grotesques, je tire le drap, sèchement – non par vengeance, peur d’un visage clos, hâte d’ensevelir : pour gommer le souvenir d’une humiliation très précise, sa main, incapable de caresses, égarée sur ma peau.
Me souvenir, avançant derrière lui, facilite la tâche. Je suis là, lui aussi, sous le ciel bleu. Bientôt, il y aura le rivage qu’il m’a décrit à nos débuts : une étendue se dissolvant. A peine 1’apercevrai-je. Il faudra deviner. A peine y poserai-je le pied, l’étendue s’évanouira.
Au-delà du rivage, l’autre zone, hésitante, où il commence d’entrer. Avancer. Aller de l’avant. Vienne le moment où, fatalement, je le perds définitivement de vue. Ses formes, prises dans l’hésitation, basculent dans le brouillard. Ses odeurs, sa main, il faut m’en passer. J’aimerais me souvenir. Je voudrais oublier. J’entre dans ma paix.
Ce qu’il ne veut pas. Et où il me précède, agissant en sorte que je sois la cause de son départ. Il est parti en avance. Je suis restée à quai. Lui s’arrangeant pour filer, prévenant, quand il parlait encore : « tu t’emmerderas sans moi. » Et, même après qu’il devienne muet, des yeux, puis main tendue, revenante, avertissant : sans lui, rien de possible. Son absence également : s’il accepte enfin de céder à mon désir (qu’il disparaisse !), s’il accède enfin à cette absence dans laquelle, le faisant tomber, je trébuche sans cesse, c’est parce que, depuis des mois, je refuse de saisir cette main. Il ne va pas rester sur un échec. Il pousse le jeu : si je veux posséder cette paix, il faut trouver la manière d’abolir sa mémoire.
Les photos se retournent contre moi. Où je crois fixer un témoignage, ma victoire, elles me prennent en flagrant délit de prolonger notre vie. Si je ne fais jamais développer la pellicule, si je lui fais voir le jour, reste le raccroc : se souvenir de vouloir abolir le souvenir. Si quelqu’un doit survivre à l’aventure, c’est ce rouleau de pellicule 24 x 36. J’ai utilisé les cinq dernières prises pour lui, ce qu’il en reste. Les dix-neuf poses précédentes concernent les paysages flous d’une sortie estivale : s’efforçant de ramener l’appareil à lui, il cadre ce qui se présente, sans tenir compte de la luminosité, des distances, du sujet, pourvu qu’il y ait quelque chose à saisir, n’importe quoi, dont je m’efface aussitôt, avant qu’il n’appuie sur le déclencheur. Si d’aventure quelqu’un, curieux, hasardeux, dépense des sous pour tirer les négatifs, apparaîtront d’abord l’été, herbes sèches au premier plan, terre grise et cailloux, bleu du ciel.
Derrière, il y a ses photos à lui. Personne, nulle part ailleurs, ne peut retrouver sa trace. Personne, nulle part ailleurs, ne peut retrouver trace de mes traits, bien qu’on puisse espérer deviner quelque chose du photographe à travers le genre de photos prises. Vanité : il y a eu mascarade, mélange d’opérateurs, bien que le premier – lui – sujet puis objet, soit omniprésent. Photos souvenirs, piètre piste.
Dieu qu’il aime me voir nue au cœur de l’été, jadis ! Je dois marcher ainsi devant lui, jusqu’à ce qu’il dise, la voix changée : « ça suffit ». Je comprends vite. Je marche d’un pas vif. Il aime me voir avancer ainsi, au milieu des herbes sèches, parmi les terres. Et j’y vais, y prenant plaisir, aussi, sous le ciel bleu. Je suis si jeune. Peu m’en faut. Caresse du vent sec. Sans me retourner, au bruit seul de ses pas sur les cailloux, aux dégringolades des cailloux, je sais où il en est de son plaisir et s’il faut que j’accélère encore, ce que j’apprécie, jusqu’au petit silence des cailloux, rompu par le claquement sec de ses doigts : « ça suffit ».
Le rouleau, peut-être ne contient-il rien de cela. Ancien, détérioré : mes photos, mes témoins ont peu de chance d’avoir impressionné la pellicule. Garde-t-elle, comme moi, une trace, ombre ou trait, balafre ? Ou, si elle est récente, j’imagine qu’il a photographié comme il pouvait. Etendant la main vers le déclencheur, il photographie les murs de la chambre, les draps, le bouquet de tulipes artificielles (« Elles ne se faneront jamais ! »). Il photographie le tout venant, bribes d’une marée montante, à l’assaut de l’objectif, sans laisser à son regard le moindre choix. L’éventail de ses postures est limité : torsion des phalanges, du poignet, pêche hasardeuse de l’appareil enfoui dans les replis des couvertures. Peut-être, à mon insu, me prend-il alors que j’avance vers lui, le croyant endormi. N’importe quoi de moi. Morceau de jupe, fragment de bras. Méconnaissable. Alors nous sommes deux sur le film. Lui, immobile, intègre, yeux fermés. Moi, découpée, mouvementée. C’est peu vraisemblable, un égarement, la preuve que je ne peux l’oublier, le perdre. Cette paix est hors d’atteinte. Comme lui allongeant le bras vers moi, j’avance en vain, obstinée à l’oublier. Eblouie par ma mémoire, gibier transi par l’appel des phares sur la route nocturne, dans la brume, et qui s’arrête, pétrifié, un instant de trop, l’instant d’y laisser la vie, percuté.
« Tu sais bien, nous sommes liés pour l’éternité. Comprend bien : l’éternité ». Ses dernières paroles. Les mains reprennent leur ressassement. Elles persévèrent à ramasser, grignotant le drap, le tirant vers l’œil clos. Elles ratissent notre histoire, la développant encore, tant qu’elles en ont la force, jusqu’à l’alchimie – sa disparition à lui : aussitôt, il s’échappe. Plus que cinq secondes. Trois secondes. Une. Le compte à rebours commence pour moi sans lui, sans chronomètre.
J’aimerais baisser la tête, comme cette blonde qu’il a aimée avant notre rencontre, qui ne bronchait pas avant d’être quittée. Ou celle qui l’a fait souffrir, se refusant à tout – si elle a vraiment existé, elle doit lui ressembler, siamoise, cuirassée, bardée – puis désespérée. Mais j’ai fait route avec lui, jusqu’à l’erreur de l’aimer, de croire l’aimer si fort, ce qu’on dit couramment aimer : ne plus se satisfaire du manque, chercher, tous les moyens étant bons, à le combler, sans jamais aboutir. Alors, tenter de se reprendre. Impossible. Puis d’oublier l’objet, de se secouer. Mais il reste toujours une fourmi. Une patte de fourmi, l’impression causée par cette patte, le souvenir de la sensation, la sensation seule, détachée de tout, plus inquiétante, omniprésente, là, toujours.
Le rivage où la vie avec lui me laisse est une farce. Bout de trottoir. A l’instant de la sortie du corps, un ouvrier de la Ville défonce le macadam au marteau-piqueur. Le corps n’est pas sorti depuis belle lurette, ne quittant plus sa chambre puis son lit, s’y retournant à peine, levant tout juste la main. Le corps, dans le cercueil porté par quatre croque-morts – du superflu : le poids du cadavre est minime, le bois léger – le corps est en règle avec le maître de cérémonie minimum, imperméable gris, cravate assortie. Le corps contraint l’ouvrier municipal à cesser son défonçage. Le maître de cérémonie lui tape sur l’épaule. L’ouvrier sursaute. A cause du raffut, il n’a rien entendu. Tournant le dos à la porte cochère, il n’a rien vu de l’équipage : maître de cérémonie, cercueil porté, moi fermant la marche, nous dirigeant vers le corbillard, minimum comme la bière, gris comme l’imperméable, break garé dans la rue vide. D’ordinaire c’est la croix et la bannière pour y stationner. En prévision des travaux on a barré la voie. Le corbillard a eu le privilège de franchir les barrières orange.
L’ouvrier sursaute donc, arrêtant de forer le macadam. Le compresseur, au coin, perpétue l’assourdissement. L’ouvrier ouvre des yeux effarés devant notre cortège, comme si le maître de cérémonie lui intimait, de continuer à creuser la rue pour y enfouir le corps. Le maître de cérémonie, après avoir tâtonné, coupe le circuit du compresseur. Le silence s’abat. Les croque-morts reprennent le cercueil – ils l’ont, pendant l’intermède, posé sur les fragments de goudron, aux pieds de l’ouvrier. Le marteau-piqueur est fiché dans le sol, figurant une stèle, l’ouvrier le fossoyeur : avec le silence de la rue, on se croirait dans un cimetière. Pourquoi ne pas enterrer les défunts devant leur domicile. On profiterait de l’occasion pour ouvrir la chaussée, réparer les canalisations. Au lieu de quoi, l’ouvrier municipal, remis de sa stupeur, ôte sa casquette pour saluer le corps – son front garde la trace rouge du couvre-chef à carreaux – et nous gagnons le corbillard.
Il ne dit rien à ce sujet, mais je pense qu’il aime partir en fumée, ne pas laisser de trace, sauf en mémoire, ce qui me satisfait. Les portes du four l’avalent. Il apprécie les feux de bois. Moi aussi. Sur ce point, nous sommes toujours d’accord, nous endormant, à la campagne, devant la cheminée, jadis. L’urne funéraire, emplie d’esquilles, de cendres, déçoit : tout ne se consume donc pas. Il faut encore le porter, modèle réduit, soupe en sachet. En déclarant aux croque-morts que je me débrouillerai pour la suite, l’optimisme l’a emporté. Je me dépêtre mal de cette boîte. Posée sur la cheminée, elle est plus grande que prévue. Glissée derrière une porte, elle gêne l’ouverture. Mieux vaut la mettre dans la chambre. Mieux vaut glisser la boîte sous le lit abandonné où, par habitude, je m’assieds, allégeance aux petits matins du passé.
Trop tard pour disperser les cendres au-dessus du fleuve, secouer l’urne depuis le balcon, dans un jardin qu’il apprécie : je m’attache à cette boîte, fétiche, genre boîte à biscuits qu’on traîne dans les déménagements, de placard en placard. Je l’ai fichue sous son lit, poussée loin, contre le mur. Pour la retirer, il faut s’allonger, étendre le bras, déplier la main, ramener, difficilement, par à-coups. Ne pas le faire ne change rien. Eviter désormais sa chambre, son lit, ça ne change rien. Quitter l’appartement, abandonnant la boîte aux successeurs, leur réclamant une reprise pour le mobilier, dont cet ustensile, ne change rien. Le souvenir, en cendres, s’acharne. Au bout du monde, je risquerai la main. J’ai envie d’ouvrir le couvercle scellé. Il m’a eue. Il m’a.
En grondant, les rampes du four dévorent le cercueil, son contenu, sa viande. Elles rendent ce résidu, fragments, éclats calcinés de bûches qu’à l’aube de nos rencontres nous relevons dans l’âtre, après la flambée. Parfois il y a un clou qu’il récupère du bout des doigts (« Il pourra servir »), l’astiquant, le redressant, l’œil satisfait. Ce petit tas, remis au crématorium, avec les politesses en usage chez les chocolatiers en renom, embarrasse davantage qu’un caveau de famille. Cette poussière s’agite, s’accroche à mes basques, comme pour fêter notre mariage, la casserole au pare-chocs de la voiture – si solidement qu’il est impossible de l’arracher avant d’avoir consommé la nuit de noces. Elle sonne encore à mes oreilles. Il approche. Je suis ivre de fatigue. Ses cendres tourbillonnent dans la boîte. Il faut les utiliser, les verser par exemple dans un sablier, qu’elles soient, enfin, utiles, identifiables de moi seule. Puisqu’il refuse de me quitter, de se perdre, qu’il serve à quelque chose.
Pas de trêve. Il tient la ritournelle – sauf à m’avancer, moi aussi, dans la paix. A mon tour. M’enfoncer dans la forêt, profitant des arbres lourds, scintillants sous le givre. Puisque nous somme liés pour l’éternité, ce qu’il nomme ainsi, emboité dans l’agonie, doigts en crocs. Sauf à m’affranchir de cette éternité-là. Sauf à céder. Jamais. J’ai trop besoin de lumière, du vent.
Il est à mes côtés, lisse comme l’étendue. Tous les autres ont le goût de disparaître, laissant l’horizon vierge, livré au vent, atteint aux extrêmes d’une lueur s’étirant, barre jaune, souillée, effrangée, rideau de scène. D’imperceptibles frémissements lèvent cette loque. Il n’y a rien derrière, plus rien devant. Il faut bien qu’une main soulève 1e rideau, comme, lorsqu’il ôte ma robe, j’imagine sa pupille refléter mon corps inversé, moi, avançant, capturée, aimantée, lui, reculant, absorbé par la lumière – ainsi jamais rejoints. Il est hors champ. Jamais la lumière ne s’arrête, jamais le vent ne cesse, et, dans une odeur de terre humide, la tenture, tressautant, s’abat.
__________
Il est nu. Il mange la terre. En souvenir de quoi je plonge les doigts en terre fraîche dont je frotte ma joue, rayant la peau. Ma joue est noire. Il apprécie les chairs blanches, le talc, m’en poudrant les pieds (« Marche! ») jusqu’à ce qu’ils noircissent à force de marcher, expérience en chambre, faute de rivage alentour. Faute de pouvoir courir les halles, il exige de palper la poularde, la retournant sur les draps. A croire qu’il la rôtit entre ses paumes, avant de l’estampiller. Une claque sur la cuisse, l’œil plissé. A défaut de moi, jetant sa viande au four comme dans une poubelle, à défaut d’imprimer sa main sur ma jambe, il glisse les doigts, jusque là, exigeant l’immobilité des muscles (« Tu ne fais pas assez de sport ») jusqu’à ce que son doigt savoure.
Il est nu. Son torse est lavé par la pluie. Il aime jardiner, la garde enfoncée comme elle ne l’est jamais en moi. Il n’a plus rien à dire. Plus de sentence. Il troque son odeur pour celle de l’humus. C’est un propriétaire terrien. A peine si j’enfile un orteil, à côté de lui. « Tu portes le deuil ? » J’ai les ongles noirs d’enfouir les racines, les bulbes, maladroite, à son flanc. Le vent gratte le sol. Nulle part ailleurs. Il est dessous, galaxie pondue fraîchement. Il est dissous. Il lance une pièce sur la cheminée (« Tiens, voilà dix sous. Pour ce prix- là, tu restes habillée. »). Debout, contre la porte d’abord claquée du talon, il me prend : « A ce tarif, on n’embrasse pas ».
Amertume terreuse sur ma langue, le sel de sa peau. Lui, le sel de la terre ? Effrité, jeune tulipe, effluves, batavia, proie de taupe. Chaque jour, j’enregistre ses progrès : volatile, graminée, ombelle, potassium. Est-il enfant ! Ne bronchant qu’aux fissures, suivant les fils humides des racines, combien de nuits est-il fertile, lui, se retenant. Il repousse mes cuisses, comme si le chaos était au bout du ventre. Il exige que je me lave (« A fond, hein ! ») pour que, sous le ciel, ne braille sa peur : un clone ? Terreur du détail, examen des linges, rien n’y fait : il recommence, tant qu’il a la force d’élever sa queue, plus douce qu’un doigt.
Croc de boucherie, ganté. Sans trace. Intime souvenir, intime conviction, il est là, en moi. Autour, l’étendue miroitante, et sa nuque, ce caillou chaud que je m’obstine à masser, à califourchon sur ses reins. C’est une danseuse qu’il lui faut, ne souffrant pas d’écarter les hanches, non cette pression, expédiée (« Retire-toi ! »). J’obtempère, le frôlant des mamelons, esquissant ses omoplates, sans qu’il frémisse. Attentivement, je fixe le souvenir au zénith. Hormis cette convalescence pernicieuse, rien. Grille la rétine. Le châle gris et rouge dont il m’enlace les épaules, ce geste solitaire n’empêche rien. Il pleut. J’oublie qu’il pleut. Le tissu colle à la peau : « Tu portes ton suaire », dit-il. Hormis la plainte du vent, rien.
Enfouies au potager entre céleris et fraises, ses cendres, dispersées par une mélancolique fin d’automne, fin de crépuscule – s’il brûle c’est pour cela : semeuse, debout, seule dans la barque, au centre du lac, guetter le bon vent, celui qui ne rabat jamais la poussière au visage. Ou faut-il, accroupie, pincée à pincée, nourrir les poissons, anxieuse : souche, boutoir trois-quarts englouti, son épine dorsale dérive. Il crawle, agrippant des doigts, soudain, l’embarcation, au risque de la chavirer. L’esquif tangue. Mon cri l’amuse. Mes bras battent l’air. Je tombe à l’eau où il m’enfonce. Je suffoque, l’eau noire dans la bouche. Refusant de lutter, je lutte, le cogne. Glissée entre la barque, sa peau, j’émerge.
S’il pleure – jamais il ne pleure – j’aime le bercer. S’il trébuche – jamais il ne tombe – j’aime le prévenir. Il concède : « tu es une bonne fille ». Peut-être, au fond, suis-je son rêve ?
Qu’il souffre maintenant ! J’espère la lenteur de sa souffrance : enfin deux ! Moi, éclose, surveillant des coulisses son éparpillement. Lui ? Où il est, s’il y est, cesse l’affût.
__________
Il va bien. Compte tenu de son état, il va bien. Il ne crache plus, mains nouées, récalcitrantes. Il troque sa couche pour cette boîte à usage réservé, soupirant enfin (« Tu me bloques ? »). Il me nomme sa domestique. J’abonde sur ma présence servile. Comment, intimement, je l’utilise à son insu. Je le déshabille. Je le nettoie. Je l’éponge. Il est lisse comme une flaque. Il maigrit. Il se truffe d’escarres. Il a les lèvres pincées. Il fait mine de respirer. Il est désinfecté. Nue, je parade devant lui, qui ne peut se rincer l’œil. Il se défile. Il compte chaque souvenir. Il pèse tout, m’étiquetant aux souvenirs. Où fuir ? Il s’écarte comme si je brandissais un couteau plein de sang. Où musarder ? Toujours, de l’ongle il me ramène à lui, si je ne veux pas, attentive à lui si je disparais. Je le plonge dans le noir. Mauvais service. D’outre-terre, il me prend, vive, perchée sur son souvenir. Prédateur, il besogne en moi, actif à me satisfaire pour, qu’enfin, je saisisse l’exactitude de son expression favorite : « Va te faire foutre ! ».
LA SOURCE INTERMITTENTE
C’était dans une ces villes d’eau dont j’ai préféré tout oublier, sauf le nom et la source. C’était à Vals, la Source intermittente, au fond du parc, entre les cèdres taillés en brosse, le golf miniature, dans l’axe du casino inauguré par Eugénie, l’impératrice, un bassin rond, planté de fragments de prismes basaltiques – noirs et rouilles, à cause des jaillissements intermittents de la source ferrugineuse. Autour du bassin, les jardiniers installaient un cercle de chaises blanches, cercle magique qui semblait éloigner les rares curistes, les repoussant vers la fade allée sablée où les joueurs de pétanque s’agitaient – sauf aux moments des jaillissements, onze heures trente-cinq à quarante-cinq et dix-huit heures vingt-sept à trente-sept, comme l’indiquait l’écriteau planté en bordure du bassin. Les curistes avaient beau mettre en doute l’authenticité des intermittences, soupçonnant un employé municipal d’ouvrir une vanne, ils respectaient la tradition : c’était quand même l’attraction favorite, ces jaillissements – un gargouillis qui s’amplifiait dans le silence attentif, puis l’eau fusant, de plus en plus haute, jusqu’à atteindre une hauteur stable, invariable, oscillant aux caprices du vent, avant de redescendre, lentement, à regret, s’excusant par d’autres gargouillis, et ne plus laisser que le basalte brillant. Parfois, l’un des curieux se penchait alors sur l’étendue plate du bassin, guettant, en vain, un miracle. La Source Intermittente respectait toujours l’horaire.
A la pleine saison, un orchestre venait s’installer près du bassin : le dépliant du Syndicat d’initiative appelait cela des thés dansants, bien qu’il n’y eût ni tables ni boissons, seulement une récréation musicale sous la houlette d’un quatuor spécialisé dans les mélodies nostalgiques. On y dansait fort peu. Les curistes préféraient fredonner, les pieds battant la mesure sur le rebord du bassin, ou les mains, faiblement, dans la tiédeur d’août. Pour moi, il ne se passait généralement rien d’autre – qu’une rare invitation, déclinée sans un regard pour le postulant dont je captais un pan de blazer, un pli de pantalon, une odeur d’eau de Cologne ou de tabac : j’étais vraiment là pour déguster les eaux, attendre l’intermittence du jet.
Si j’acceptai un soir, c’est parce que l’orchestre jouait avec un brin d’emportement un arrangement du « Beau Danube Bleu » – en raison aussi du détestable jeu de mots de l’homme : « A Vals, vous ne pouvez refuser une valse ». Sans doute avait-il déjà essuyé un de mes refus, à moins qu’il ne m’ait observée, écartant les importuns. Il était relativement jeune, habillé passablement mal. Son visage offrait des traits confus, comme des balafres molles. J’imaginai qu’il était un assidu nocturne du casino. L’aspect brouillé de sa figure s’accordait aux bourgeonnements de la Source intermittente – elle surgissait des basaltes tandis qu’il m’enlaçait. L’homme dansait piètrement, sans respecter la mesure, à croire qu’il entendait une autre musique que celle massacrée par le quatuor. Il progressait à pas inégaux, frottés. Ses mains hésitaient sur ma taille, mon épaule. Puis il parut s’affermir : vivant toujours son rythme propre, totalement étranger au « Beau Danube Bleu », il nous lança dans un tourbillon, dans le jaillissement de la Source Intermittente, fusante, qui, un instant, vint couvrir le bruit de l’orchestre. Les pas de l’homme s’étaient allongés, des pas d’arpenteur contournant le bassin. Parfois nous frôlions une chaise – d’une secousse des hanches, il s’écartait. Parfois les gouttelettes de la Source intermittente, vaporisées par le vent, glissaient entre nos visages une fine voilette de fraîcheur. Ses mains s’étaient resserrées, une pression constante, chaleur douce dont j’aurais pu m’échapper, comme s’échappait dans l’air bleu le jet impeccable de la Source intermittente, longue tige blanche au pétale ployant vers les basaltes, avec le même choc, le même rythme, le même emballement régulier, preuve monotone de la mécanique des fluides. L’orchestre en avait fini avec le saccage du « Beau Danube Bleu”, mais nous valsions toujours, seuls, tournant encore, seulement soutenus par le bruissement de la Source intermittente, tournant encore imperceptiblement moins vite, comme si la valse était une boucle éternelle, jusqu’à l’éclipse – cet enlèvement sec, cet enfoncement soudain des doigts dans ma peau, cette élévation brutale de la Source intermittente, suivie, à la seconde, de son aplatissement sur les basaltes, affaissement suivi de l’habituel gargouillis, des mains flottantes de l’homme et de mon étrange sensation, soulagement, solitude, lorsque, s’étant vaguement incliné, il s’éclipsa en direction du casino, me laissant à contempler le basalte régurgiter, aspirant les dernières gouttes, briller encore un peu, puis s’assécher au soleil tardif.
LA TÊTE SUR LE BILLOT
Merci à toux ceux qui auraient pu m’aider et ne l’ont pas fait. A commencer par les distractions coutumières du printemps, ils avaient d’excellentes raisons. Leur ai-je seulement indiqué en quoi ils pouvaient m’aider ? J’étais en proie à de graves vacances, et trop préoccupé de mon sort pour réunir les détails nécessaires préalables à l’établissement d’un formulaire de demande d’aide – gardons-nous, à dessein, d’employer le mot « secours », réservé à des cas autrement désespérés. Si j’avais eu, en remplissant un tel dossier, à prouver l’urgence de ma situation, j’aurais commencé par énumérer des griefs contre un sort plus méchant pour d’autres. Untel (il fait partie de ceux susceptibles de m’aider sur dossier) lutte pour obtenir, justement, qu’on se penche sur son dossier. Il mérite mieux que de devoir examiner mon petit destin. Je sais qu’il se souvient de mon existence. C’est déjà capital…
Ma faillite professionnelle, amicale, sentimentale, sexuelle, étant totale n’offre aucune prise à la sympathie. Au plus, un fragile point d’appui à un vague dégoût. Est-ce un argument valable pour solliciter de l’aide ? Pourtant, je pourrais encore être utile à d’autres. J’aime tenir un intérieur. La vaisselle, le ménage ne me rebutent pas. Rafraîchir un mur non plus. Je peux soutenir une vieille femme dans la rue. Caresser un corps ingrat ou privé d’attention entre aussi dans mes cordes. J’aime les animaux et les plantes : en peut, sans crainte, m’en confier la garde. Si je porte l’argent d’autrui, je ne le volerai pas. Ecouter les plaintes, les petites misères, certains malheurs, au besoin offrir quelques conseils d’ordre général, est dans mes attributions. De l’avis de tous, lorsque je donne un coup de main, je m’en tire honorablement. J’aime servir, pourvu qu’on me traite avec politesse. Qui comprendrait cela pourrait longtemps user de moi. En échange d’un minimum de tact, je fermerais les yeux sur la modestie d’une rétribution…
Mais je préfère m’en tenir à un principe essentiel : prendre soin de ne rien accepter. Cela entraîne trop loin. Par manque de rigueur, on commence par réclamer un bout de pain, un fruit, du fromage. Puis, de timbre-poste en ticket de métro, c’est un chèque que, fatalement, on souhaite de plus en plus gros. Pourtant, de l’Etat, j’accepterais une entorse à cette règle : pour rester supportable, le citoyen doit être présentable, maxime qui suppose un minimum de fournitures. De l’Etat, j’exigerais, sans honte, des dessous décents. J’irais jusqu’à lui réclamer des chaussures – seulement si mes semelles sont trouées. Il n’y a aucune impudeur à montrer à un fonctionnaire des semelles percées. Le tout est de pouvoir frapper à la bonne porte, de ne pas se tromper de formulaire et de ne jamais oublier de remercier, sans exhiber ses moignons. Cela peut toujours servir. Merci de me permettre de dormir dans la poussière. L’oubli des autres est doux quand il entraîne l’oubli de soi. Merci de laisser dormir les domestiques… Quel qu’en soit l’objet, prébende ou job, poser sa candidature reste un acte grave. Où d’autres se lancent à l’aventure, j’hésite : chevilles liées par une corde élastique crochetée à un pont, des écervelés se jettent dans le vide. Très excitant sauf si la corde se rompt. Mieux vaut rester sur la terre ferme à contempler le vide que de faire acte de candidature. On s’y reprend à deux fois avant de poser la tête sur le billot : sait-on jamais si la tête tranchée tombera dans la sciure ou volera vers les cieux ?
LA VITESSE DE LA LUMIÈRE
Entre l’instant où la lumière frappe ton visage, dit le jeune homme, et celui où je te vois, trois milliardièmes de seconde se sont écoulées. Ton visage doré (soleil des vacances) n’existe plus à mes yeux, pas plus que mes traits ne peuvent, réellement, affronter ton regard. Cet aveuglement réciproque – amour crevant les yeux à la vitesse de la lumière – ? Tes frémissements – retrait d’un rayon, faisceau d’une lampe heurtant le duvet de la peau ? Ce qui me bouleverse à première vue, bras levé, si vif, élégant ; ce qui m’éblouit – torse de danseuse étoile – ? Astre éteint. Et ce reflet au miroir (toi, faisant le point, songeuse, sur ta beauté) est aussi tangible que ce fantôme très récent, encore parfumé – toi.
– Est-ce pour cela que vous me tutoyez ? Vous tentez un rapprochement ?
Cette remarque lancée, la jeune fille reprend son ouvrage ; extraire de sa joue droite un point noir, minuscule. Œuvre d’entomologiste, suivi de près par la vieille, le vieux, assis de part et d’autre du miroir, hochant la tête. En un clin d’œil, le point noir, saisi d’ongles roses, effilés, n’existe plus, laissant une joue presque impeccable.
– Cela vous excite, à l’accoutumée, dit la jeune fille laissant filer ses doigts sous les narines du jeune homme. Mon souvenir vous excite, non ? Plus que moi, si je vous suis, ce qui est impossible, d’après votre théorie, non ?
Le vieux se lève, tâtonnant, et la vieille, accrochée à sa veste de pyjama, emboîte le pas.
– Moi qui suis plus vieux que Saturne, affirme-t-il, c’est à peine si je commence à y voir clair. Sans cesse j’ai reculé, sans jamais atteindre l’apogée.
– Quant à la vitesse de la lumière, dit la vieille, je l’ai prise de plein fouet. Me vois-tu, garçon ?
Et elle recule, et le vieux aussi, tous deux se marchant sur les mules, jusqu’à l’angle des murs.
– Picturalement, cela ferait un beau sujet, dit le jeune homme, ou photographiquement, à la rigueur, votre butée, votre embrassade.
– Non, dit la vieille, ne nous fixe pas : nous n’avons pas fini.
– Il y a du reste, grogne le vieux.
Mais le couple se tient coi, la face grise et rouge – effet du soleil levant, renvoi du miroir, au tréfonds de la pièce – tandis que la jeune fille s’étire : son ombre, doublée par la glace apporte un semblant de paix. Et le jeune homme, tâtant l’ombre, touche la fille, sa douce peau immobile, sans qu’elle tressaille. Quand la jeune fille, imperceptiblement, bronche, bouge vers lui, se collant contre son corps, il ferme les yeux, comme elle. Ainsi font-ils mine de ne plus se voir autrement qu’en aveugles – ainsi frémissent les vieux : il faudrait être aveugle pour ne point voir. A force de se fusiller du regard, leurs orbites sont béantes. Trous noirs où s’aspire la lumière, à toute vitesse. Et les jeunes, s’embrassant, paupières closes, résistent encore longtemps, percevant, peu à peu, à travers leurs paupières, les formes dissoutes l’un de l’autre – jusqu’à distinguer clairement un homme et une femme, eux, se débattre, images renversées dans la pupille l’un de l’autre. Alors, prenant du champ, ils ont peur l’un de l’autre, ne se reconnaissent plus. Leurs images imprécises, comme ces étangs percés d’herbes à la dérive, de feuilles pourries, s’effacent, perdus dans les fanges.
– Il faut s’accrocher aux choses quotidiennes, dit la vieille.
– Pas croire ce qu’on voit, c’est péché mortel, renchérit le vieux. Faites comme moi : vivez dans l’exactitude.
– J’ai cette tentation, dit le jeune homme : te voir telle que tu es. Prenant la jeune fille – elle se laissant prendre devant les vieux immobiles -, il l’aime (dit-il) avec une telle violence qu’elle se débat avant de fermer les bras autour de lui. Ainsi, debout, le couple oscille avant de s’abattre aux pieds des vieux.
– Ne pas chercher la lumière, dit le vieux.
Muette, la vieille repousserait, du bout des orteils – mais elle n’en a plus la force – ce duo ; et l’imagine, se perpétuant, roulé… Les vagues mortes… S’imagine le duo saisi par la lumière, grande cérémonie où tant de flashes crépitent qu’une seule source blanche baigne les lieux. Une telle violence. Lorsque revient la pénombre, la mémoire oculaire éclaboussée conserve la frange des choses. Comme aux explosions nucléaires, l’ombre portée d’une passante volatile. Sans omettre le bruit mat des lèvres, la chair allée l’une vers l’autre – à se boucher les oreilles -, son glissement, le stop, brutal.
– Ils ne sont pas morts, quand même, dit le vieux.
– Ils soupirent, dit la vieille.
– On s’en relève ? dit le vieux.
Tirant les habits avec l’énergie de la mansuétude, touchant les habits fripés, les jeunes peaux, il prodigue tant de soins ! Lentement, le jeune homme, la jeune fille, précautionneusement, reviennent à la verticale dans la pièce illuminée, un désert où brûle le miroir, au zénith. A tâtons, s’approchent du reflet – hésitation nuptiale ! – cherchant la sortie par là, vers la glace. Les vieux, à gauche, à droite, les encadrant, en léger retrait (discrétion de l’âge), poussent leurs jambes vers la sortie miroitante. Juste à bonne distance – le reflet enfin exact -, tous quatre marquent un temps. Arrêt sur image qui les montre tels quels, vieux et jeunes, vides comme une poche vide, quand, juste à franchir le seuil – un pas de trop, allons, il le faut -, les frappe désormais la lumière, si vite qu’ils ne sont déjà plus, seulement un tableau, une photographie, une empreinte, ou seulement rien, grâce à cet inévitable décalage : trois milliardièmes de seconde. D’avoir souhaité, en s’aimant – s’aimant ? -, transgresser la règle (« te voir telle que tu es ») ne change pas l’affaire, sinon la douleur de l’affrontement avant le trou noir qui, les ayant fixés, les dévore avec la tendre lumière que semble encore renvoyer leur épiderme.
LE JARDIN ZOOLOGIQUE
C’est une histoire oubliée, les douaniers en culottes courtes ouvrant, fermant les fenêtres : il y a des heures pour voir le ciel gris et d’autres pour la mousson, des heures pour l’odeur de vanille, l’aventure de vanille. C’est l’Administration, le sable dans les bureaux, coulant sur le parquet moisi, bloquant les serrures. Ou le sang coagulé, la Sainte Ampoule dans l’armoire métallique, au centre ville, sous le ciel engorgé. Ou le silence, la peur qui embourbe les pantalons. Tout le monde conserve son grade et ses prénoms, l’usage de ses prénoms – ça va bien avec la baïonnette, le tapin des légionnaires, l’énervement de l’infanterie, le soir. Au sommet, la Douane, puis la Légion, puis 1’Infanterie ; au-delà, entre roseaux et ciel obscur, les Marsouins : c’est administratif et préétabli. Puis viennent la biture et les femmes, l’une torchant les autres – celles qui sentent le ricin, et l’armée des bayadères, le zig à la pupille. De nuit, c’est forêt, tringles, triangles. La suppuration des marais. Lianes aux pieds. Pieds roides comme des pierres. Qui dort s’éveille tête cassée. Des histoires de femmes qu’il faut importer. Des tignasses, des têtes racornies, grosses comme le poing, qui pètent comme des grenades, qu’on balance comme des quilles, qu’on rameute comme des femmes, toutes ensemble, sous le ciel. Je me souviens d’un militaire, un quarteron, mateur de balles perdues – pluie sur son cadavre -, tombé pour la gloire et la flore, autour pousse le cacao, autour poussent les canettes – qu’il pue, tombé, jambes cassées, foie perdu, à la dérive entre les sampans. On l’a débarqué, cadavre, avec la rosette et les drapeaux en fleurs, tordus sous l’averse. On a rassemblé les Missions, le bordel de campagne, et la nuit creuse, la muette, où les indigènes piaillent. Pipe d’Opium est là, sa fille, jambes roses, tempes laiteuses, et les coupables, empalés pour que ça se sache. Et le cercle des familles, agrandi sans cesse, se perdant dans le noir. Et le cercle de la nuit, plus immense, frottant sans bruit le cercle de la forêt. Et les cymbales, les fifres, le silence des morts, la minute, les doigts des hommes glissant dans les doigts des gants, tassés, raidis, butant, suant, et l’odeur de la forêt nocturne, le cadavre à tirer au sec, sous la caillasse – et les meubles, les grigris à sauver, canonnière, poker menteur. Et le cortège funèbre, les hommes enfoncés dans les femmes, les hommes dans les hommes, les balles au trou, le ramassis, la nuit des singes, le duvet des parachutes voletant, les tonsurés, les totems, les torturés, le méchoui. Une institutrice s’était levée, disant qu’il aurait mieux valu s’abstenir, mais que rien, jamais, n’est perdu dans la nuit coloniale, entre les colonnes de la nuit, ni la paillote, ni la pagode, ni le glaive, ni la rizière, ni la République, ni le boxon, l’Amazone, l’odeur de jasmin, les mouches bleues, le béribéri, le khôl – rien n’est perdu, disait-elle, mais il fallait se garder : la douane harassée, les képis tassés sur les croix, l’importation du camembert, l’effritement, les clous de girofle sous les ongles, les ongles dans le pétrole – il suffirait d’une allumette, et plus personne, hommes de paille, femmes épouvantails, des gazelles, disait-elle. Le rut. Car voilà : c’est la lenteur qui l’emporte, le naturel, la nuit des temps, le braconnage, à la fin, le gibier qui l’emporte. Les persiennes closes sur les baillons, le plasticage de l’illusoire, le furtif, la clôture et le gravas derrière la bouse. C’est l’odeur rôdante de vanille, les échelles tirées comme des lapins, la colonne sans le temple, le socle sans la statue, et eux, les sous-fifres, à se tordre les cuisses avec des flanelles trop chaudes et des chiffons sur les nattes, ou des mains coupées sur leurs crânes ras, yeux vides dans l’assombrissement des palmes. La nature reprend ses droits, et eux, les Douaniers, leurs petites valises pleines de noix de coco rances, de narines coupées, de fanions sanguinolents. La nature reprend ses droits, et eux, les Douaniers, leurs titres de transport, leurs bâtards. Le bois blanc de la mémoire, ils y taillent un cercueil, et filent au crépuscule baigné de napalm. La nuit s’engouffre dans leurs ventres et ils oublient tout, parlant seulement l’hiver de la Mamounia, de l’escale de Saïgon, parlant seulement l’hiver du bruit des pales d’Antsirabé, celles des ventilateurs, celles des hélicoptères, celles des hélicoptères, celles des ventilateurs.
LE RETOURNEMENT
« Ils prirent le corps. La face qui était contre terre, ils la tournèrent vers le ciel. Puis ils retournèrent le corps… » : le prêtre, dit la vieille, lorsqu’il commençait sa visite par une parabole – ce qu’il appelait ainsi pour simplifier – nous savions qu’il ne décollerait pas avant d’avoir fini son histoire. Il s’asseyait, je lui versais du vin de noix. Il paraît que je servais ce vin comme une vraie jeune fille. Mon enfance s’en trouvait flattée bien que le prêtre, en claquant la langue, fît montre de politesse, rien de plus, et d’un soupçon de flatterie propre à se concilier mon attention. Il se sentait en confiance chez nous qui étions un peu sa famille, disait-il, en posant sa main brune et tachée sur la mienne, pression sèche, péremptoire, déformation professionnelle : je le voyais ainsi à l’église, lorsqu’il disait la messe, arrêter le versement du vin et de l’eau dans le calice tendu à l’enfant de chœur. Ainsi, moi qui rêvais de servir la messe, pouvais-je en avoir l’illusion. Et c’est pourquoi je me précipitais pour lui verser son vin de noix, toute prête à écouter ses confidences. Il partait du principe qu’un récit n’est jamais indiscret s’il a une valeur pédagogique et racontait souvent, parfois avec d’infimes variations, pour son propre plaisir ou pour que la curiosité de son public ne s’émousse pas, l’histoire de la femme qui était morte en odeur de piété.
Son préambule portait toujours sur la beauté de la femme qu’il décrivait tantôt élancée, presque gracile, rousse et sans profession, tantôt brunette et potelée (bien sûr sans profession, puisqu’alors, au village, les femmes n’avaient que celle de mettre au monde) et toujours avec les yeux verts, « comme toi, précisait-il, des yeux comme des huîtres ». De ces variantes physiques, nous déduisions que plusieurs femmes avaient dû mourir en odeur de piété, à moins qu’il n’ait voulu, par le redoublement, souligner l’universalité de l’exemple – ou qu’il jouît des descriptions, tels les peintres religieux à figurer des madones complaisantes. L’essentiel n’était pas là mais dans le contraste frappant entre la beauté de la femme, l’état du pays, dévasté par la guerre, et celui du village, envahi par la typhoïde : la diarrhée emportait tout. L’épidémie frappait à toutes les portes, le printemps, les arbres en fleurs, rendaient l’horreur encore plus perceptible. Les oiseaux, portés par l’odeur, une pourriture, flottaient au-dessus du village. La femme marchait dans la rue principale, intacte, droite, parfumée, un beau navire dans la tempête, une insolence face à la mort.
Dès qu’il en avait fini avec les contrastes, le prêtre passait à la vie dissolue de la femme, à son goût de la prudence et de la sécurité. Il ne la condamnait pas : si elle avait profité de la guerre, de la captivité de son mari pour faire du médecin son amant, peut-être était-ce par souci de préserver son équilibre et la santé de son enfant, un garçonnet de cinq ans, fragile comme une poupée, qui vouait à l’ami de la famille, c’est à dire au prêtre (à l’époque, il ne l’était pas encore, aspirant seulement, vaguement, au souci de Dieu), une grande affection. Affection qui ne se démentit pas lorsque le mari captif revint au foyer dans un état de faiblesse tel qu’il contracta sur le champ la typhoïde.
Les larmes aux yeux, le prêtre se souvenait du regard grave du garçonnet sur la détresse familiale et villageoise – il l’appelait ainsi, le garçonnet, et l’on avait alors l’impression qu’il passait sa main dans les cheveux de l’enfant. Le prêtre venait chercher l’enfant au chevet du père. C’était étrange, disait-il, cet homme si malade qu’il ne voyait plus rien, l’œil transparent, et son fils, debout dans la chambre sombre (on avait clos les persiennes, comme si le père était déjà mort), avec un regard noir et net. Parfois, il y avait aussi la femme, occupée, diligente, avec des flacons, des serviettes, des cuvettes qu’elle manipulait sans heurt, sans paroles, si ce n’est pour indiquer qu’elle attendait le médecin. Alors, seulement, un mouvement de main trahissait son impatience.
Ensemble, le prêtre et le garçonnet remontaient la rue principale du village d’en bas pour aller vers le village d’en haut. La rue n’était pas goudronnée comme aujourd’hui, mais boueuse, avec des tas de fumier devant les volets clos ; la plupart des maisons cachaient un deuil, un mourant, un cadavre. Avant d’arriver au village d’en haut, il fallait bifurquer : le village d’en haut était épargné par l’épidémie et son entrée interdite à ceux du village d’en bas. Ils arrivaient dans un pré fouetté par le vent et s’asseyaient sous un grand cerisier en fleurs. C’est là que le garçonnet s’était blotti contre la poitrine du prêtre en disant : « Je donnerais ma vie pour toi ». A cet instant de son récit, le prêtre s’interrompait toujours, puis, afin que nous saisissions bien, il reprenait le récit du dialogue avec l’enfant en me regardant fixement – n’étais-je pas la plus jeune de la famille, presque une enfant moi aussi? Je donnerais ma vie pour toi, répétait-il, vous comprenez ? ».
Enfin, il parlait du médecin, un libre penseur qui se rendait deux fois par jour au domicile familial. N’omettant pas de joindre l’utile à l’agréable, il soignait très correctement le mari – et la femme. C’était un bambocheur, là-dessus le prêtre restait ferme, bien qu’il refusât de porter un jugement sur sa conscience professionnelle. Ne se dévouait- il pas, en vain, pour tenter de sauver, outre le mari, les malades du village ? Il n’arrêtait pas. Lui et les croque-morts ne chômaient pas. Il fallait bien gagner sa vie, faire son métier, soigner. C’était absurde mais nécessaire, libre penseur ou pas. Peut-être trouvait-il entre les bras de cette femme la force nécessaire à ce travail de Sisyphe ? A moins qu’il ne s’agît d’une compensation bien humaine ? Et n’avait-il pas conseillé d’éloigner l’enfant fragile du village d’en bas vers celui d’en haut, chez sa tante, où l’air des cimes éviterait, peut-être, la contagion ? Le prêtre envisageait aussi que le médecin ait pu, consciemment ou non, exiler le garçonnet, incapable de soutenir son regard et désireux d’avoir les mains libres. Il ne tirait aucune conclusion. Lui, le prêtre avait été chargé, nuitamment, d’introduire clandestinement le garçonnet dans le village d’en haut, une course essoufflante par des chemins de traverse, et il avait porté l’enfant en souvenir de Christophe traversant le fleuve, mais, plus tard, il avait pensé au Roi des Aulnes. Comme nous ne connaissions ni l’un ni l’autre, il devait aussi nous raconter cela. Nous avions l’impression qu’il avait porté dans ses bras une multitude d’enfants, que c’était une habitude – d’autant qu’alors il me soulevait de ma chaise, me soupesant et déclarant que je serais, moi aussi, de plus en plus lourde : la légèreté était apparente, les corps, toujours, étaient de plomb. Même lui – le garçonnet -, lui qui, au contraire de moi, se laissait aller contre la poitrine du prêtre, même lui était un fardeau pesant – il l’était encore, à preuve que les corps sont à jamais dans les bras de ceux qui les aiment : forcément cela, à mesure que la vie s’avançait, devenait de plus en plus lourd, à preuve que les corps sont éternels. Et, comme il y avait de l’interrogation dans l’air (comment le suivre dans ses méandres ?), il disait ne pas parler au hasard, qu’il allait retomber sur ses pieds. Aucun de ses mots n’était gratuit, jeux de mots inclus. Aucun jeu n’est gratuit, insistait- il. Et il me demandait si je courais vite ? A mon âge on courait vite. Plus vite que la lumière ? demandait-il. Et tandis que je demeurais coite, il enchaînait.
L’oxygène avait réussi à l’enfant qui courait dans les prés – la tante envoyait des nouvelles rassurantes : la typhoïde, ce lascar ? Allons donc ! Il était rose et vif. On pouvait remercier le ciel. Ce que faisait sa mère. Son mari était très récemment mort et enterré, puant et décharné, un parmi d’autres de ce malheureux village d’en bas où, soulignait le prêtre, la diarrhée coulait plus vite que les ruisseaux. A ce moment du récit, le prêtre évoquait l’ombre du père, à peine revenu, sitôt disparu, une ombre fugitive entre les doigts de Dieu – avant de revenir aux lettres de la tante. La femme lisait la dernière lettre en compagnie de son amant, au moment précis où, au village d’en haut, comme il était écrit dans la missive, l’enfant courait dans les prés, droit vers un cerisier – l’arbre justement sous lequel le prêtre l’avait serré contre lui, tandis qu’il disait vouloir donner sa vie pour sauver celle de l’ami de la famille. Et le vent s’était levé, le vent des cimes qui donnait à l’enfant la sensation d’avoir des ailes, ployant les herbes et les branches hautes du cerisier. Et juste à la seconde où la main de l’enfant touchait le tronc du vieux cerisier, une rafale hachait une branche grosse comme un bras, qui, d’un coup, fendait le crâne du garçonnet. La main de l’enfant touchait encore l’écorce du cerisier, quand on l’avait trouvé, après que le vent soit tombé. La branche, grosse comme un bras était sur lui, avec son linceul de fleurs blanches. Le prêtre relevait la manche de sa soutane et montrait son bras, le bras de Dieu, un bras de justice et d’immanence. Et il fallait que je touche son bras, qui était gros et musclé. Il insistait pour que nous comprenions bien : ce bras que nous voyions, si fermement attaché à l’épaule, lui aussi, le jour venu, se détacherait, comme la branche tombe de l’arbre, comme les fruits s’en détachent lorsqu’ils sont mûrs. Ainsi, le bras de Dieu, quand le péché était à point, s’abattait.
Nous n’osions objecter l’innocence de l’enfant – ne l’avait-il pas lui- même soulignée ? Mais le prêtre prenait ses précautions. La sentence divine passait par le sacrifice de l’enfant : à travers lui, la femme était frappée au plus profond de sa chair, et plus encore que nous ne l’imaginions. Il n’y avait nulle injustice à ce sacrifice, puisque le garçonnet y avait d’avance consenti. On était en plein dans la rédemption. En s’offrant, le garçonnet avait fait d’une pierre deux coups : punir mais sauver la femme par où elle avait péché ; sauver le prêtre – si l’enfant n’était pas mort sous le ceriser, il était persuadé que la typhoïde l’aurait emporté – et l’attirer vers la vie éternelle, puisque, à la suite du sacrifice, le prêtre – qui ne l’était pas encore – avait résolu d’entrer au séminaire. Voila ce qu’était la bienheureuse rédemption. Peut-être même s’était-elle étendue jusqu’au médecin – mais là, on ne pouvait avancer qu’à pas feutrés. Bien que le médecin soit resté libre penseur, il avait dû souffrir dans sa chair quand la femme avait rompu. Lui aussi, un jour, risquait d’être appelé. N’avait-il pas été un des instruments de la colère divine ? Le prêtre hésitait sur les mots pour expliquer que le médecin avait, pendant la captivité du mari, rendu stérile la femme – une ablation des ovaires qui permettait de faire la noce. La femme, pour des raisons alors obscures, mais qui, maintenant, après la mort du garçonnet, s’éclaircissaient singulièrement, ne souhaitait pas avoir d’autres enfants : la science et le désir s’étaient accordées. Evidemment, elle n’avait pas songé que son unique enfant allait disparaître. Le prêtre faisait remarquer que si l’enfant était resté au village d’en bas, il n’aurait peut-être jamais contracté le typhus. En voulant l’éloigner de la mort, on l’y avait précipité – ce qu’il souhaitait ardemment, au fond. Le prêtre revenait alors sur le regard du garçonnet, regard si grave, grave comme la mort. Il estimait que les enfants n’ont pas peur de mourir : celui-là était mort en courant vers un cerisier fleuri, en jouant, ce qui était bien de son âge, n’est-ce pas ? disait-il en me tendant son verre. Il avait soif, de tant de souvenirs haletants et souhaitait faire une pause, pour l’émotion, pour que nous savourions son récit et en tirions déjà des conclusions quant à notre vie personnelle, à sa fugacité, à notre chance d’avoir de bons parents.
L’entracte fini, sur l’habituel claquement de langue, la main du prêtre restait sur le verre. Sa peau avait la teinte du vin de noix. Nous savions qu’il allait répéter comment la femme, après neuf mois de mutisme – le temps d’une conception, un hasard qui n’en était pas – s’était rapprochée de lui, l’ami de la famille, quand elle avait su qu’il allait devenir prêtre. Il avait usé de tact, constatant seulement les faits implacables : on mettait au monde des enfants pour qu’ils meurent, mais toutes les morts n’étaient pas égales. Le deuil, le mutisme et la chasteté avaient encore accentué la beauté de la femme, et lui, l’ami de la famille, en avait été frappé. Il retrouvait maintenant dans son regard celui du garçonnet et, quand elle s’était réfugiée entre ses bras à la manière de son fils, il s’était senti profondément retourné. Sa jeunesse avait failli succomber à la douceur grave de cette chair, peut-être même y avait-il cédé un soir de mai où ils s’étaient rendus tous deux au village d’en haut, sous le cerisier à nouveau en fleurs, celui sous lequel l’enfant était mort en courant. S’il avait cédé – il n’en était pas sûr – il estimait qu’il s’agissait d’un acte de consolation, sans suite, un chant du cygne. Dès qu’il avait été ordonné prêtre, tout était redevenu normal ; il avait confessé la femme et, à sa demande, elle lui avait remis les cent-vingt-sept lettres d’amour du médecin. Il avait failli les lire avant de les brûler, peut-être même en avait-il lu une, par hasard, échappée du paquet, rougissant que l’on puisse écrire des choses pareilles après les avoir faites. Mais enfin, ces choses charnelles avaient été réduites en cendres, ce qui était conforme à leur destin et à celui de la femme après qu’elle soit morte, dans le pré du village d’en haut, après qu’on ait abattu le cerisier, trop vieux, pour le débiter en bois de chauffage. Elle était allée là, par hasard, ce qu’on nomme tel, sans but précis connu d’elle. Elle avait poussé un cri devant le trou béant – et le cri avait été porté par le vent des cimes jusqu’aux baraques des bûcherons. Ils avaient pensé au feulement d’un lynx, mais, comme ils avaient bu, cela ne les avait pas surpris. La femme était tombée face contre terre. Et ceux qui la découvrirent, la tournèrent vers le ciel, avant, déclarèrent-ils, de retourner le corps, tant ce qu’ils avaient lu dans les yeux de la femme était effrayant. C’étaient des gens du village d’en haut qui n’avaient côtoyé le typhus que de loin, sinon ils en auraient vu d’autres. Après avoir arraché la souche de cerisier, ils venaient reboucher le trou, de crainte qu’un enfant y tombe, ou une vache. Le prêtre regrettait la mort prématurée de cette femme, mais il avait si longtemps craint, de confession en confession, un suicide, qu’il s’avouait soulagé pour son âme : lui aussi avait vu le regard en bénissant le corps, et il pouvait affirmer qu’elle était morte en odeur de piété. Il souhaitait que son récit nous serve d’exemple, à moi surtout, ajoutait-il, qui était presque une jeune fille, une jeune fille aux yeux verts. Ce qu’il en disait, c’était parce qu’il estimait vraiment être l’ami de la famille, rôle que personne ne songeait à lui contester, surtout pas moi.
LES DÉMONS DE LA FORÊT

Ils l’entraînent dans la forêt, dit le vieux. Le soleil marque le pas, et ils surgissent tous trois, si parfaitement grimés, si parfaitement vêtus, qu’il les prend pour vous, vous et vous – le jeune homme, la vieille, la jeune fille qu’il désigne bras tendu, reculant jusqu’à buter contre la fenêtre du fond, d’où il voit la forêt épandre ses voûtes – à quoi ? Cent mètres à peine. Oui : dès qu’il a le malheur de franchir le seuil – comment faire autrement ? Vous, vous et vous l’avez laissé seul… Il faut bien se nourrir, prendre l’air autrement qu’à la fenêtre, relever les collets ou la boîte aux lettres au bout du chemin. Cela est le plus dur: comment résister à l’envie de fouiller dans cette boîte ? A son âge, manger peut s’ajourner. L’oxygène, parfois y suffirait. Mais savoir si vous, vous ou vous avez laissé un message ? Il marche donc jusqu’à cette fichue boîte en plastique gris, carrée – un coffre-fort – et ils sont là. Tous trois surgis, propres, fringants comme personne n’est au crépuscule, papotant près de la boîte, à l’accueillir avec, dans leurs yeux, ces zones troubles, plus sombres ou plus claires que le globe oculaire – ainsi de ces bandes circulant autour de planètes lointaines. Sitôt qu’il a ouvert la boîte, constatant, à l’accoutumée, l’absence de courrier, ils s’emparent de ses bras, innocemment. Une reconnaissance ? Simple palpation du tissu, évaluation de texture. Ils prononcent des paroles insipides sur l’état des routes, de sa santé. Et la pluie, le passage d’un planeur, s’étonnant, au culot, que lui ne l’ait pas aperçu, se récriant aussitôt (« c’est vrai, vous ne sortez guère »). Heureusement, ils sont là pour l’arracher à sa tanière ! Pas le temps de dire ouf : ils le tirent par la manche, si doucereusement – jamais il ne peut résister. Il veut, mais vous, vous et vous ne lâchent pas prise, au point que son corps suit le mouvement, incapable de freiner, apte seulement à frôler les feuilles oscillantes et l’herbe haute où trébuche la lumière. Il virevolte entre leurs pattes. Un toton, voici ce qu’il devient. Ils l’embarquent, araignées d’eau en zigzag sur son vieux corps, phasmes basculant dans la nuit, si légers ; il peut se croire seul, errant sous la futaie, mais vous, vous et vous déchiquetez lentement ses vêtements, le mettant à nu. Il sent leurs mandibules attaquer la peau, et ils sont de grands bavards aux chuchotis rassurants. « Vous serez plus à l’aise, dépouillé ». Mots vains, ou simples frissons ? Froid nocturne ou démangeaisons ? « Non, avancez sans crainte : nous savons où aller, et vous avec nous ». L’emmènent aux tréfonds de la forêt, et il s’attend à tomber aveugle. Mais il ne trébuche même pas, soutenu par cette dévoration minuscule, les pinces, les cisailles à l’œuvre. La peau se décolle – certitude : vous, vous et vous la soulevez, lambeau après lambeau, avalant, et lui a l’impression de laisser des squames, pas davantage, jusqu’au plateau calcaire, un promontoire exhaussé où guettent de grands arbres, si durs qu’ils n’offrent aucune prise au vent, arbres de pierre peut-être, fossiles. Et ils le portent sur cette table, lisse, mate, qui ressemblerait à celle de la cuisine où il s’accoude pour dépouiller les lapins rapportés des pièges, si elle n’était immense sous la lumière des étoiles, soumise aux ressacs du vent glacé. Vous, vous et vous l’éloignez aux confins du plateau, face à l’abîme : « Gare à ne pas tomber », disent-ils en prenant soin de lui, le découpant, l’attaquant aux jointures, cherchant les ligaments. Vous, vous et vous croquant les cartilages, et les chairs spongieuses, les viscères engloutis sans vergogne, cœur inclus. Il les entend : « C’est un morceau de roi » – et blaguer sur le cerveau, « si petit, si ratatiné qu’il ne se souvient sûrement de rien ». Quand restent les os – sucés, broyés – lui ne ressent aucune souffrance : la force de l’habitude, sans cesse, d’être concassé par les petites pattes de vous, vous et vous. Sales petites pattes, vilaines dents, maniaques. Le pire, cette indifférence ; ils ne parlent plus. Oh mon dieu, ils se taisent, ils en ont fini avec lui pour aujourd’hui. Le pire, cette digestion muette, signe qu’ils vont recommencer : demain, maintenant, tout de suite, dès qu’il étend la main vers la boîte aux lettres, comme s’il attendait vous, vous et vous avec fatalité, presque avec gourmandise, sachant d’avance à quelle sauce il serait dévoré. La même. Qu’ils l’entraînent, peut-être pour toujours, qu’ils l’entraînent – vous, vous et vous – dans la terrible forêt, le jettent sous les étoiles claires, blanches comme la table de la cuisine – et il recule, butant contre la fenêtre close, en regard de la forêt où vous, vous et vous 1’attendent de pied ferme.
MAISON DE POUPÉE
Si j’étais cinéaste, j’aurais d’abord filmé le petit tableau à gauche de votre lit – la femme au nez pointu, la philosophe, votre tante je crois, qui préférait la vie à la philosophie. Parce qu’elle était issue d’une famille indigne, à cause de son chignon serré, parce que le tableau ressemblait à un Vuillard, qu’il semblait une puissance tutélaire, la seule visible dans votre maison de poupée, si j’excepte les oiseaux empaillés, la collection, grives, bécasses, ramiers, faisans, perdrix. Puis, vous, je vous aurais filmée à plat ventre, fatiguée, allongée sur votre lit à baldaquin presque Louis XV. Puis le feu qui ne consumait pas, ou lentement, à demi. Vos mains tisonnant. Puis vous, debout en collant sombre, regardant la terrasse, sa verdure envahie de pluie. Et les lampes, l’une après l’autre, que vous allumiez, leurs corolles champêtres. Soudain j’aurais montré la vitre cassée de la porte d’entrée, soudain cette impression ; voici une maison abandonnée, que l’on a fracturée, une maison au fond de la forêt. La faille, le carreau brisé, et la verdure ployant, glissante de pluie, la grisaille du ciel. Où sommes-nous ? Devant cette fracture, insistante, l’envie de passer la main, d’ouvrir le loquet, persuadé que cette maison est une bicoque envahie d’humidité, d’odeurs de moisissures. Il y aurait ensuite la semi-obscurité. Et l’éclat sourd des chaises métalliques, forgées à la façon de Diego Giacometti – effleurer juste leurs courbes, leurs hérissements, comme si la lumière irradiait très progressivement du métal noir. Et, dans cette lumière noire, au-delà, l’empilement des fauteuils club, leur enchevêtrement, à croire qu’une foule vient de se lever en désordre. Et, très vite, les oiseaux dans leurs aquariums pendus aux murs, l’un puis l’autre, avec leurs yeux de verre, qu’il y ait des scintillements. Les oiseaux ne sont pas tristes. Leur immobilité empaillée les rend dignes, sereins. Des galets en bord de mer. La verroterie des yeux lavée de lumière brève. Au sol maintenant, la passementerie du carrelage – ocres sourds, floraison bleutée, granulation poudreuse, chemin de Chine, à suivre avec infinie lenteur, jusqu’en Provence où votre frère les fabriqua. La lenteur du cheminement est celle d’un doigt paresseux pris dans une caresse.
Jusqu’à présent, le film était muet. Personne ne parle. C’est vraiment une maison au fond de la forêt, la nuit, où vous habitez. On a vu la pluie sans l’entendre, le feu qui ne crépitait pas. Maintenant, une note de musique, une seule, longuement tenue, sur un piano désaccordé. Et cette note fige la caresse. Pris dans la lumière douce, un grand tableau saint-sulpicien. Cette sainte sur l’horizon bleu, hésitante, l’œil vide, entre une palme (à sa droite) et une quenouille (à sa gauche). On ne choisit pas impunément ses objets. Assise sur la moquette, en regard de la sainte, vous répondez au téléphone, et le ciel bleu, derrière la sainte, bascule ; vous venez d’ouvrir la porte de la chambre d’ami. Tout y est clos. Dans une pénombre sereine et humide, une assemblée d’oiseaux, naturalisés, dans leur cage vitrée, stupéfaits de l’intrusion. Sitôt – très vite – que vous refermez la porte, on les entend piailler. De l’autre côté de la porte close, ils passent sûrement de branche en branche, picorent du seigle, s’agitent, s’amusent. Est- ce cela qui vous fait rire ?
Si j’étais cinéaste, je vous filmerais en train de rire, à cause de la timidité contenue dans ce rire joyeux. Est-ce votre liberté dans la maison de poupée qui provoque ce rire rapide ? Au fond, nous sommes dans une maison douillette, avec cuisine américaine, beaucoup de plantes sur la terrasse où la pluie a cessé. La sainte est plate et chromo. La moquette beige. Le feu s’est définitivement éteint et vous sirotez une bière au goulot. Vous êtes un feu-follet, courant dans la maison de poupée, avec le téléphone à décrocher, les tiroirs à ouvrir, les dossiers à chercher. Je vous filmerais en train de chercher, de trouver ce que vous cherchiez, mais cherchant encore, furetant dans la forêt, renversant les fougères – le hasard provoqué, disiez-vous ? -, jamais haletante (l’habitude de la traque ?), en vestale de la forêt, la forêt dans la maison de poupée où, à nouveau, sonnerait la note de piano. Cette fois, on verrait le piano droit, pupitre clos. Un meuble stuqué et peint à l’italienne, flirt de verdures, de feuillages enlacés. Et la pluie brusquement reprendrait, soufflée par le vent, à travers la brèche du vitrage. Le piano s’emballerait. Il jouerait seul, devant vous, pour vous, un fragment d’une sonate de Schubert, par exemple l’Opus 42 en la mineur, et brutalement, une passacaille. Puis le silence. Puis le bouquet de roses flétri dans votre chambre. Puis le noir céleste: vous sortez de la maison de poupée. Le seuil est encadré d’arbres hauts et déliés. En touffes, des hortensias vieux rose, luttent contre le vent. Vous n’avancez plus. Vous êtes dans la forêt.
QUATRE FANTÔMES
– Trois fantômes entrent et s’asseyent sur mon lit, dit le jeune homme.
– Des oiseaux sans ailes, dit aimablement le vieux.
– Non : quatre. Vous aussi, vous êtes dans le coup, dit la vieille au jeune homme.
Comme il essaie de se lever, elle le retient, si fortement, aidée par la jeune fille, qu’il bascule sur le matelas. Et le vieux lui flanque une bourrade, lui rappelant qu’il pourrait être son fils – à tout le moins sous sa tutelle. La vieille montre l’orifice d’où il est issu : une planque, entre le matelas gris et le mur.
– Vous n’étiez pas épais. Une larve d’une main.
– Vous avez grossi, dit la jeune fille en posant la main sur son sexe. Vous avez gonflé. Lorsque je vous ai connu, vous étiez une outre, une oie gavée.
Le vieux assume son droit d’aînesse en se soulageant soudain : un liquide pâle s’échappe d’en bas, tout à fait en bas de ses pantalons. La vieille veut vraiment que le jeune homme touche l’os, là, dessous son pubis. Comme dans les mauvais scénarios, la jeune fille allume une cigarette, puis lui refile le mégot entre les lèvres
– Quand vous aurez fini de fumer…
Elle n’achève pas la phrase et lui conseille de se taire, en le tutoyant. A croire qu’ils ont couché ensemble, ou se connaissent d’antan, d’ailleurs, qu’ils ont veillé sous la couette, senti leurs odeurs, poussé dans le même ventre, couru dans la forêt.
– Un dédale, risque le jeune homme.
Son exclamation suscite un tollé.
– Quand vous étiez au bord de la mer, dit la vieille – sans non plus finir sa phrase -…
– Il y avait ce sanglot qui remontait, dit le vieux.
Il lui plairait d’évoquer longuement cette plainte échappée, à l’en croire, au jeune homme – cri des lapins quand on rompt leur nuque – mais il ne peut : il considère la flaque envahissante au bas des pantalons.
– Tu, dit la jeune fille.
Elle répète seulement le tutoiement, lancinante, comme frappant un punching-ball. Le jeune homme s’effondre lentement et la jeune fille le monte, puisqu’il est homme de cœur, dit-elle – tandis que lui réclame, supplie que les vieux se détournent ou mettent des masques ; est- ce un spectacle à voir, ce spectacle ? En guise de réponse, ils enfilent leurs doigts dans sa bouche – à croire qu’ils sont dentistes – et il a l’impression d’une course de chevaux dans sa bouche.
– … Rien, dit la vieille.
– Que silence, dit le vieux.
Il se souvient d’un écho :
– Quand vous êtes né.
– Ah ! dit la vieille en lui mordant l’oreille.
Et la jeune fille lui broie la tête entre ses cuisses douces – il a, fugitivement, un grand plaisir. La jeune fille s’excuse d’avoir été une brute, et les vieux se détournent en pouffant. Et le liquide du vieux pénètre entre les lames du parquet.
– Enfin, soupire la jeune fille, tu vas venir ?
Le jeune homme n’arrive pas à formuler sa question : « pourquoi me tutoyer ? » – mais il sent bien qu’il va peut-être venir, à cause du fourmillement dans sa tête.
– Que c’est l’écho ! lance le vieux en triomphe, à sec enfin.
– Il va venir, chantonne la vieille.
Alors qu’on pourrait, pense le jeune homme, se promener sagement dans les larges avenues claires, longer de belles boutiques… Il cherche désespérément le nom des avenues… et les boutiques, qu’y vend-on ?
– Il faut manger pour être mangé, dit la vieille.
Etonnant, cette fluidité de voix – non ce qu’elle affirme.
– Non, dit le jeune homme.
Parce que rien ne vient, qu’on le saisit aux épaules, qu’on le retourne comme une crêpe.
– Et si ! crie la jeune fille.
Sa main longe la colonne vertébrale, telle un frisson. La langueur de voix de la vieille est ce frisson humide. Il a la sensation d’ôter sa chemise en plein vent, en pleine forêt, avec le parfum du brouillard, et les feuilles, les débris, l’humus engorgent son thorax. Il chasse le soleil, gros comme un ballon de foot, non, une bille de roulement à bille, qui tombe dans…
– Très bien, dit la vieille. Il faut s’y prendre autrement.
Alors, d’une griffe, lentement, depuis la nuque, elle dessine un serpent rouge, au long de la colonne vertébrale du jeune homme, et, à chaque respiration, le serpent ondule avec difficulté – spasmes que les autres contemplent, tirant des conclusions sur l’asphyxie progressive du sujet, son assujettissement au reptile dont les soubresauts indiquent clairement, comme dit la vieille qu’il a « le mou en piteux état ».
– Piteux python, dit le vieux. Il y faudrait un masque à oxygène.
Et la jeune fille tente un dernier effort :
– Viens dans ma terre.
Le vieux se récrie, la vieille se décrie. Le jeune palpe la terre, mais elle n’est qu’aérienne, volatile. La terre, le mot seul lui suffit. Il se redresse, s’assied. Il a les jambes en coton. Le flageolement s’installe dans sa tête, entre les yeux – étoile aux pulsations somnolentes.
– Attend, dit la jeune fille, je vais te…
L’étoile de battre pire, sourdement. Le liquide pâle recommence à couler des pantalons du vieux. La vieille, immobile, la main sous sa jupe, retrousse les babines. Lui-même, son propre corps s’étire : il n’est plus retenu que par l’étoile et, à chaque pulsation, le lien s’amenuise.
– Tu viens, dit la jeune fille. Cette fois, il vient ! clame-t-elle.
En effet, il vient davantage. Pas totalement mais davantage – les autres l’y conviant, l’encouragent. Terrible effort mais qui ne coûte rien, s’accomplit seul, indépendamment de lui, dans l’endormissement de l’étoile – bascule fade des sensations, de l’horloge interne, trafic de rythmes qui s’échappent : il se voit enfin venir, délaissant l’étoile, mort œillet sauvage, fané ; délaissant son corps. Les fantômes s’ébattent, le traversent, et le souffle de la jeune fille, exultant, inlassablement, comme une hirondelle vrillant, virevoltante, chuchotant « viens, viens enfin ».
– Tu vas venir, dit-elle encore.
Les autres ? Zigzagant, rêches et froissés, pour qu’il vienne…
Il voudrait bien maintenant, il veut.
– Mais rien, dit la vieille, collant sa feuille contre son âme qui vient presque.
– Mais, dit le vieux.
C’est un ruissellement sur l’âme du jeune homme. L’âme ne peut s’échapper, se libérer. « Non », dit l’âme du jeune homme. Et l’âme suffoque à la triste pensée de ne pouvoir venir, titillée pourtant, relancée, exacerbée par la voix élastique de la jeune fille – « de venir, que ne viens-tu pas, ô viens ! ». Puis la jeune fille se lasse, se mure. Elle et les autres fantômes le laissent tomber, s’écraser sur le matelas, rejoindre son corps accueillant, ouvert et froid, pour qu’il repose à jamais ; puisqu’il ne vient pas, ne viendra pas, qu’il repose donc, corps et âme confondus.
RÊVEUSE VIRGINIE

Elle avançait dans les jardins, offrant sa beauté singulière : une figure très blanche, des yeux très noirs. Son extrême réserve cachait un désarroi qui incitait à la complicité. La pâleur de son visage était un miroir sans tain. Cette femme, dit la jeune fille, possédait la vertu des âmes franches. Polie par les souffrances, elle connaissait les vertiges du voyage. Elle connaissait le Chili, Rhodes, Barcelone et Madrid. Elle connaissait Washington et New York, et 1a Virginie, rêveuse Virginie dont elle s’avouait originaire. Là, disait-elle, au sud du Sud, dans les forêts d’érables et de palétuviers, vivaient les idiots, ceux de Faulkner, et ses ancêtres – une lignée de femmes presque centenaires, des indiennes, femmes sans miroirs, presque sans reflets, très droites, comme elle, dans une vaste maison claire, et qui, lorsqu’elles la voyaient une fois l’an, la reconnaissaient comme étant des leurs : ses racines étaient là, dans les forêts profondes. Les doigts innombrables des ancêtres sans cesse parcouraient sa peau : c’est ainsi qu’elle avait la peau si blanche, éblouissante, d’être caressée par les indiennes. C’est pourquoi elle cherchait la pénombre des tilleuls jusqu’à Paris, les tunnels de feuillages au parfum de miel, dans ces jardins aimés : son père y avait vécu ses derniers jours, parcourant les allées empoussiérées, à n’en plus finir – son père, une montagne noire levée dans une brume de poussières, un moine dans un cloître de poussières. Et elle avançait, entre les forêts de Virginie, la montagne noire mouvante, sous les tilleuls, portée par une musique tremblante et vive, jouée à quatre mains, très droite toujours, à la recherche de l’honneur perdu.
Il s’agissait d’une histoire d’amour, et d’une faille ouverte, en elle, depuis ?… Blessure violente, peut-être antérieure à sa naissance, rejetant le soleil de part et d’autre de ses yeux noirs, lui clouant un masque d’extrême attention aux souffrances, les siennes, celles des autres, masque qui la préservait de la poussière, bien qu’elle tentât souvent de l’arracher. Masque qui était fait d’ombre de la forêt, la rêveuse Virginie, et qu’elle ne pouvait arracher : cette ombre-là était imprimée dans sa chair, comme les vêtements d’une grande brûlée.
Elle avançait donc dans les jardins, l’âme franche et masquée, portant les cheveux légers de ceux qui connaissent l’horizon, et sa démarche était celle, simple, des flots frôlant l’océan. Elle demandait : « Lorsqu’un homme trompe une femme, qui perd son honneur ? Comment, sinon par le meurtre, racheter l’honneur perdu ? Qui tuer ? L’autre ou soi- même ? » Et cette question lancinante l’empêchait de voir les pigeons s’enlever devant ses pas, de sentir la fatigue – à peine, sans qu’elle s’en aperçût, frémissait-elle de froid. L’honneur perdu la contraignait de franchir l’équateur dans ce jardin empoussiéré, espérant une victoire sans cesse refoulée. Qui fallait-il achever ? Elle ou lui ? Et revenir ? Ou revenir ensuite ? Lorsqu’on avait été trompé, devait-on s’abandonner ? Mais on avait été, déjà, abandonné ! Déjà, on partait à la dérive, sitôt croisé, pour la première fois, le regard de celui qui allait perdre votre honneur ! Déjà, à cet instant, on le savait : « cet homme perdra mon honneur « . Mais on ne détournait pas les yeux, on voyait, déjà, l’honneur vaciller dans la pupille de l’homme, bien avant qu’il vous ait pris dans ses bras, bien avant que vous soyiez à lui – mais vous n’étiez, déjà, plus rien, dès lors qu’il lisait sans comprendre dans votre regard ce que vous saviez : il allait trahir, il trahissait, déjà.
Et l’honneur s’était perdu. « Tout se perd, n’est-ce pas ? », disait- elle, Très vite, il n’y a plus de traces, plus d’empreintes, et la poussière au bout des souliers un souffle de vent l’emportera, ou un coup de chiffon. Fallait-il en rester là ? Rompre la traque ? Si elle devait tuer, n’était-ce pas ce désir de fuir au sud du Sud, où l’on pense se retrouver – sans se retrouver, jamais. Où l’on trouve l’assemblée des indiennes, muettes, lèvres cousues sur l’honneur, muettes dans la maison claire, et qui ne tendent plus les bras ; à quoi bon, puisque vous ne revenez pas vers elles mais vers vous, comme le ressac ou l’écho. Et la maison claire flambe dans la nuit, toutes les indiennes s’éloignent pour rejoindre la forêt, rentrer dans la tanière des feuillages, des marécages. Et l’une d’elles se penche vers un morceau de bois calciné, s’en saisit, l’approche de votre joue blanche, y trace un signe pour que vous reveniez au monde. Mais vous êtes persuadée qu’elle vient de vous rendre votre honneur, une balafre de charbon – alors qu’il s’agit seulement d’un signe pour que vous ne les oubliez pas : elles avaient fait leur temps, allaient disparaître dans la forêt, mais vous pouviez rester, être leur fille, l’indienne. A votre tour, construire une maison claire dans cette rêveuse Virginie. Il n’y avait aucun déshonneur à cela.
La femme n’avait pas compris. Secrètement soulagée de voir disparaître les ancêtres, reculer dans les limbes, elle était demeurée au milieu des plâtras, hésitante : c’était donc si peu, d’avoir racheté son honneur. Elle ne sentait qu’une immense lassitude. Elle avait campé sur place, le temps d’attendre un autocar rouge et bleu qui s’était enfoncé entre les arbres comme un crocodile ; et les passagers, de gros fermiers aux chemises à carreaux, avaient regardé cette voyageuse à la figure si blanche, si sale : une traînée noire sur la joue droite, qu’elle refusait de laver, laissant à la pluie, au vent, à la sueur, le soin d’effacer le signe de sa victoire, ce qu’elle croyait être sa victoire.
A mesure qu’elle s’était éloignée vers les villes, en deçà puis au-delà de l’océan, elle s’était mise à trembler – fièvre violente, nausées, vomissements, le noir. Elle écarquillait les yeux et ne voyait pas. Elle s’entendait parler, aucun son ne franchissait ses lèvres. Elle descendait une longue corde balancée dans un puits et, au fond, trouvait l’eau noire de ses propres yeux, eau froide qu’elle frôlait des orteils. Elle avait lâché prise, récupéré ses esprits – à cela près que, désormais, toujours, elle se voyait là-bas, en rêveuse Virginie, où qu’elle fût, dans un salon à Barcelone, dans une rue à Rome, dans des jardins comme ceux-ci, elle se voyait debout, face à la maison claire, une balafre sur la joue, entourée des indiennes muettes, muette comme elle l’avait été durant son absence – ce qu’elle nommait ainsi faute de mieux – à croire qu’elle était aussi devenue indienne. Et, plus elle parlait dans la vie courante, plus l’autre, l’indienne – elle avait fini par la nommer ainsi faute de mieux – s’enfonçait dans le mutisme.
Elle espérait de toutes ses forces, là, dans ces jardins aux ombres épaisses – voûte de bras tendus au parvis d’une église pour une noce – elle espérait qu’un jour l’indienne recouvrirait la parole. Peut-être faudrait-il attendre sa propre mort, peut-être les premiers mots de l’indienne seraient-ils ses dernières paroles, mais ce jour-là elle saurait si son honneur était ou non sauvé. En attendant, bien qu’elle ne soit coupable de rien, il lui faudrait porter l’indienne muette. « Elle a encore besoin de moi. Je dois la porter”. Disant cela, la femme avait un geste rapide vers son sein pour accepter ce châtiment injuste. Ses doigts caressaient le tissu à fleurs de sa robe, comme si l’indienne vivait dans une prairie d’été embaumée, bercée par le vent, sous le feuillage des jardins, puis emportée soudain, très droite, en lisière de forêt, en rêveuse Virginie, à contempler les décombres de la maison claire, tandis qu’une ancêtre brandissait tel un moignon un bois calciné, et furtivement, et gravement, balafrait sa joue blanche, signe amical, fraternel, mais qui marquait l’indienne, la jetant à son tour dans la tourmente et le déshonneur, la faisant muette petite statue incrustée dans sa chair de femme, entre cœur et ventre, sous le sage tissu fleuri – et, à chaque pas, chaque respiration, c’était les flots et l’océan, la bourrasque dans les branches, la langueur des marigots, les paroles brûlées ou noyées ; c’était, disait-elle, le témoin muet du désordre, bringuebalé, le commis-voyageur du désordre, l’honneur d’une femme.
SINISTRÉS
J’avais rencontré le batelier dans la zone sinistrée, après le débordement. Il était content de pouvoir parler. En l’écoutant quelques minutes, on se rendait compte de son exaltation. Il m’a demandé si je cherchais la fille. « Excusez-moi, ajoutait-il, j’ai des raisons ». Et, sans savoir si j’avais du temps à perdre, le batelier m’a parlé de l’état des routes, avant : c’était un entrelacs. Alors que, maintenant, ainsi que je pouvais le constater, et comme il l’avait dit à la fille, il fallait être de la famille pour s’y reconnaître. Sans doute par famille voulait-il évoquer ceux qui étaient restés dans le coin, unis par le malheur, quelques uns, les doigts de la main. Du reste, il avait mis la fille en garde contre l’ambigüité (c’était son mot) : on risquait de confondre l’eau et le chemin. Plus d’un avait été piégé, avançant le pied où il ne fallait pas, et y restant. Il avait conseillé à la fille de se fier aux flottaisons : l’eau remuait de grosses choses, tandis que le chemin, même submergé, laissait apparaître un flux lent qui charriait de petites ordures. Le batelier était inquiet d’avoir soudain tutoyé la fille – il ne l’avait jamais vue auparavant – en continuant à lui indiquer le bon chemin, ce qui, à l’en croire, n’avait pas choqué la fille. La preuve : elle l’avait, à son tour, tutoyé. « Persévère jusqu’à la fourche, lui avait-il dit, là où montaient les collines. » Il s’en voulait de cette précision inutile qui avait pu embrouiller la fille. Puisque les collines avaient, depuis longtemps, disparu sous les flots, pourquoi en parler ? Il avait même fait une blague absurde : « …Là où montaient les collines, il y a de l’eau dans le gaz ». Le batelier m’expliqua qu’avant une usine à gaz s’élevait sur les collines. La blague n’avait pas fait rire la fille mais introduit de la gêne. Le batelier s’était alors lancé dans une foule d’explications propres à égarer plutôt qu’à guider. Cela, il se le reprochait amèrement. Pourquoi avoir mentionné la boucle – cette longue clôture de barbelés qu’il fallait longer pendant une bonne demi-heure, en marchant vite ? La fille avait voulu savoir le pourquoi des barbelés. Et, là encore, le batelier s’était trompé de réponse. Il avait dit à la fille qu’elle se ferait une opinion par elle-même. Il craignait qu’elle n’ait voulu franchir les barbelés. « Vous comprenez, me dit-il, la curiosité était dans ses yeux. » Le pire était qu’après il lui avait demandé : « Tu n’as pas peur des animaux, au moins ? », ce qui avait encore excité la curiosité de la fille. Non, elle n’avait pas peur, simplement elle pensait qu’ils avaient tous disparus, avalés, noyés. Mais ceux-là, non. Pas les trois chiens, ni le grand cheval. C’était un repère : ils se tenaient toujours compagnie, à l’autre bifurcation. Mais – c’était la crainte du batelier – si, justement, ils avaient décampé, à moins que le cheval n’ait glissé, emporté par le courant, suivi par les trois chiens qui auraient voulu le sauver ? Et si la fille les avait cherchés en vain ? Le batelier essayait de se rassurer avec l’indication suivante : les décombres de l’entrepôt, tassé contre la route. Les parpaings, les poutrelles et les carcasses, impossible de s’y tromper. Si la fille ne s’était pas laissée abuser par sa curiosité, si le grand cheval et les trois chiens étaient au rendez-vous, alors, oui, elle pourrait continuer. A ce moment de son récit, le batelier m’avait regardé, comme s’il attendait un signe de ma part, encouragement ou simple compréhension de son angoisse. C’était un homme assez gras, pratiquement chauve, au visage blanc. Il reniflait constamment. « Vous voulez savoir où elle allait ? » dit-il enfin. Et, lentement, sans attendre ma réponse, il recommença à décrire le périple possible de la fille, revenant sans cesse à la boucle, au cheval et à ses chiens, à l’entrepôt, comme un nageur décrivant des cercles autour d’un axe sans cesse mouvant. Sa mémoire semblait s’arrêter là. « La nuit tombait presque », dit-il. Il finit par avouer qu’il n’était pas sûr d’avoir bien compris où la fille voulait se rendre. Et les rafales de vent n’arrangeaient rien. Avait-il seulement entendu ce qu’elle demandait ? Il n’avait pas vu d’aussi jolie fille depuis longtemps. Le reste comptait peu. Il avait essayé de la retenir près de lui longtemps, le plus longtemps possible, l’assommant de renseignements, de précisions (n’était-ce pas humain ? Il vivait dans une telle solitude.). A chaque fois que la fille faisait mine de le quitter, il la retenait. Quand elle s’était échappée (c’était l’aveu du batelier), « la nuit tombait presque ». L’angoisse du batelier devenait contagieuse. A mon tour, j’étais pris d’intérêt pour la fille, perdue peut-être, errante dans le débordement. C’était peut-être sa destinée : avoir demandé son chemin à un idiot. Le batelier s’était tu. Il regardait dériver des souches d’arbre. Quand je lui demandai quand était passée la fille, il leva un bras : « – Ça, je ne m’en souviens plus ».